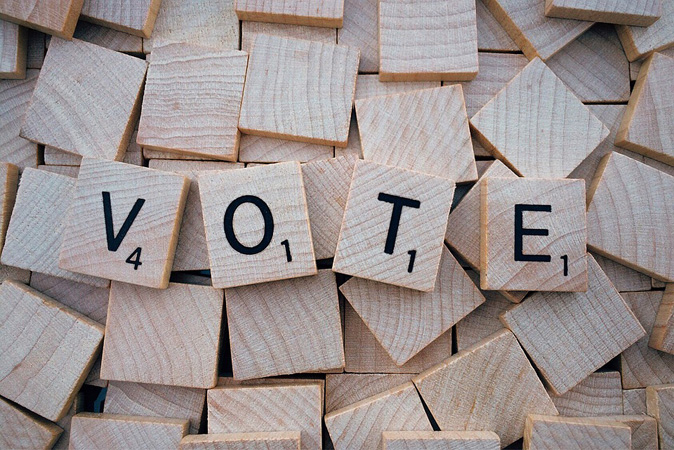Par
Le premier tour de l’élection présidentielle, le 23 avril, opposera onze candidats aux opinions très diverses. Ce pluralisme a été en partie éclipsé par les affaires judiciaires et par la place que les médias ont consacrée au bal incessant des sondages. Néanmoins, la perception de la nature profondément antidémocratique des institutions françaises et européennes gagne les esprits. Mais la traduction en termes électoraux de cette conscience nouvelle risque d’être dévoyée par le piège d’un « vote utile » qui choisirait comme opposant à l’extrême droite un adorateur de la mondialisation.
Nous entrons dans une ère politique où bien des phrases qui commencent par « Ce serait la première fois que… » semblent annoncer la réalisation d’une éventualité jusqu’alors inconcevable. En ce printemps 2017, l’élection présidentielle française marque ainsi la première fois que l’on ne s’interroge plus sur la présence du Front national (FN) au second tour : on pose l’hypothèse, encore très improbable, de sa victoire. La première fois que nul ne défend le bilan d’un quinquennat alors même que deux anciens ministres du président sortant, MM. Benoît Hamon (Parti socialiste, PS) et Emmanuel Macron (En marche !), participent au scrutin. La première fois aussi que les candidats du PS et de la droite, qui ont gouverné la France sans discontinuer depuis le début de la Ve République, pourraient être conjointement éliminés dès le premier tour.
On chercherait également en vain des précédents à une campagne aussi parasitée par l’information continue, les affaires judiciaires, l’incapacité générale à fixer son attention plus de vingt-quatre heures sur une question essentielle. Et on ne trouve assurément aucun cas antérieur d’un postulant important à la magistrature suprême poursuivi pour détournement de fonds publics alors qu’il proclame depuis dix ans que la France est en faillite.
Le renoncement du président sortant à briguer un second mandat risque de dissimuler le point de départ de tous ces dérèglements. Le quinquennat qui s’achève a vu M. François Hollande devenir le chef d’État le plus impopulaire de la Ve République, et ce juste après que son prédécesseur, M. Nicolas Sarkozy, eut déjà été répudié. Or, le président socialiste l’a admis lui-même, il a « vécu cinq ans de pouvoir relativement absolu [1] ». En juin 2012, pour la première fois de son histoire, le PS contrôlait en effet la présidence de la République, le gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat, 21 des 22 régions métropolitaines, 56 des 96 départements et 27 des 39 villes de plus de 100 000 habitants.
De ce pouvoir M. Hollande a fait un usage discrétionnaire autant que solitaire. C’est lui qui a décidé l’état d’urgence, engagé la France dans plusieurs conflits extérieurs, autorisé l’assassinat de simples suspects par voie de drone. Lui, aussi, qui a fait modifier le code du travail, contraignant sa majorité parlementaire à une réforme qu’elle refusait d’endosser (recours à l’article 49-3 de la Constitution) et pour laquelle ni elle ni lui n’avaient reçu mandat du peuple. Sans oublier la refonte de la carte des régions françaises, que le chef de l’État a redessinée de son bureau de l’Élysée.
Voilà qui pose avec acuité la question des institutions de la Ve République, que M. Hamon et M. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) se sont engagés à remettre en cause, mais dont M. François Fillon (Les Républicains) et M. Macron s’accommodent, tout comme Mme Marine Le Pen. Aucune autre démocratie occidentale ne connaît une telle concentration du pouvoir entre les mains d’un seul. Au-delà du danger, bien réel, de voir un jour en disposer un chef de l’État moins débonnaire que celui qui achève son mandat, les proclamations ronflantes sur la démocratie française, la République, butent sur un constat que la présidence de M. Hollande a rendu aveuglant : l’exercice solitaire du pouvoir conforte la faculté illimitée de piétiner les engagements d’une campagne qui pourtant devrait fonder le mandat du peuple souverain.
M. Hollande s’engageait à défendre la sidérurgie française, il a entériné la fermeture du site de Florange ; il devait renégocier le pacte de stabilité européen, il y a renoncé dès le premier jour de son mandat ; il promettait d’« inverser la courbe du chômage » avant la fin de l’année 2013, elle a poursuivi son envol trois ans de plus. Toutefois, si un sentiment de trahison s’est ancré aussitôt dans les esprits, c’est sans doute en raison d’une phrase qui a marqué sa campagne de 2012 et que chacun a réentendue cent fois depuis : « Mon seul adversaire, c’est le monde de la finance. » Or M. Hollande a pris sitôt élu un ancien banquier de Rothschild pour conseiller à l’Élysée, avant de lui confier les clés du ministère de l’économie.
L’actuelle faveur dont semble bénéficier M. Macron dans l’opinion est d’autant plus déconcertante qu’elle risque de propulser vers le pouvoir suprême le digne héritier, fût-il parricide, de ce président sortant à l’impopularité inégalée. « Emmanuel Macron, c’est moi, a lâché un jour M. Hollande, il sait ce qu’il me doit. » Assurément, M. Macron n’est pas socialiste, mais M. Hollande non plus. L’un le proclame, l’autre biaise. Les propos du premier tournent le dos à une tradition de gauche qui pourfendait « l’argent » ou « la finance », mais cela correspond aux convictions que le second exprimait dès 1985 dans un ouvrage, La gauche bouge, qui avait également pour auteurs l’actuel ministre de la défense et le secrétaire général de l’Élysée [2]
Dans ce livre, on trouvait déjà l’idée chère à M. Macron, même si elle est chez lui ensevelie sous des amas de mots cotonneux et creux, d’une nouvelle alliance sociale entre les classes moyennes cultivées et le patronat libéral, soudés par la volonté conjointe de se déployer dans un marché mondial. « Entrepreneuriat » plutôt qu’« assistanat », profit plutôt que rente, réformistes et modernistes contre extrémistes et passéistes, refus de la nostalgie « des chameliers et des porteurs d’eau » : entendre M. Macron, c’est réécouter ce que proclamaient M. William Clinton dès 1990, MM. Anthony Blair et Gerhard Schröder quelques années plus tard [3]. Et le suivre reviendrait à s’engager plus hardiment encore que M. Hollande dans la « troisième voie » du progressisme néolibéral. Celle qui a enjôlé le Parti démocrate américain et la social-démocratie européenne, les laissant dans le ravin où ils gisent en ce moment.
« Le projet d’Emmanuel Macron, c’est le marchepied du Front national »
« Mondialistes » et « parti de Bruxelles » contre « patriotes » : Mme Le Pen se réjouirait que l’affrontement politique se résume à cette dialectique. Député PS et pilier de la campagne de M. Macron, M. Richard Ferrand semble devancer ses désirs : « Il y a, estime-t-il, d’une part, les néonationalistes réactionnaires et identitaires ; et, de l’autre, les progressistes qui pensent que l’Europe est nécessaire [4] ». Une telle structuration du débat idéologique n’est pas innocente. Il s’agit, de part et d’autre, de submerger la question des intérêts de classe en alimentant pour les uns des terreurs « identitaires », en vitupérant pour les autres des pulsions « réactionnaires ».
Mais, n’en déplaise à tous les progressistes de marché, ceux « qui pensent que l’Europe est nécessaire » sont situés socialement. Les « travailleurs détachés » qu’une directive bruxelloise de 1996 a enfantés, et dont le nombre a décuplé ces dix dernières années, sont plus souvent ouvriers du bâtiment ou salariés agricoles que chirurgiens ou antiquaires. Or ce que « pensent » les victimes de ce dispositif est aussi et d’abord le produit de ce qu’ils appréhendent, c’est-à-dire un dumping salarial qui menace leurs conditions d’existence. Pour eux, l’Europe ne se résume pas au programme Erasmus et à l’Ode à la joie.
Stratège politique de M. Donald Trump, M. Stephen Bannon a compris le parti que la droite nationaliste pouvait tirer du déclassement social qui accompagne presque toujours les célébrations du village global. « Le cœur de ce que nous croyons, explique-t-il, c’est que nous sommes une nation avec une économie, et pas une économie dans je ne sais quel marché mondial aux frontières ouvertes. Les travailleurs du monde en ont assez d’être soumis au parti de Davos. Des New-Yorkais se sentent désormais plus proches des habitants de Londres ou de Berlin que de ceux du Kansas ou du Colorado, et ils partagent avec les premiers la mentalité d’une élite qui entend dicter à tous la façon dont le monde sera gouverné [5]. » Quand, dans ses réunions publiques constellées de drapeaux européens, M. Macron exalte la mobilité, réclame la « relance par les marges des entreprises » et s’engage à supprimer les indemnités de chômage après le deuxième refus d’une « offre d’emploi décente [6] », comment distinguer ses propositions des intérêts des oligarques de l’argent et du savoir qui composent le « parti de Davos » ? On imagine les dégâts démocratiques qui découleraient d’un éventuel face-à-face entre lui et Mme Le Pen, celui-là même que les médias s’emploient à installer.
Depuis plus de vingt ans, prôner le « vote utile » revient à présenter les deux partis dominants en remparts contre une extrême droite dont leurs choix successifs et concordants ont favorisé l’envol. « Aujourd’hui, estime M. Hamon, le projet d’Emmanuel Macron, c’est le marchepied du Front national [7]. » Mais, réciproquement, la puissance du FN a affermi le monopole du pouvoir de ses adversaires, socialistes compris [8]. Dès 1981, François Mitterrand calculait qu’une extrême droite puissante obligerait la droite à faire alliance avec elle, au risque de devenir ainsi inéligible [9]. La manœuvre s’est renversée en avril 2002, quand M. Jean-Marie Le Pen a affronté M. Jacques Chirac lors du second tour de l’élection présidentielle. Depuis, la droite n’a plus qu’à devancer le PS dans n’importe quel scrutin, national ou local, pour devenir aussitôt aux yeux de presque toute la gauche l’archange de la démocratie, de la culture, de la République.
Des institutions monarchiques qui permettent toutes les roueries, tous les reniements ; une vie politique verrouillée par la peur du pire ; des médias qui s’accommodent des unes tout en se repaissant de l’autre ; et puis, il y a… l’Europe. La plupart des politiques économiques et financières de la France y sont étroitement subordonnées, ce qui n’empêche pas l’essentiel de la campagne de s’être déroulée comme si le prochain président allait pouvoir agir en toute liberté.
Une victoire de Mme Le Pen pourrait signer la fin de l’Union européenne — elle a prévenu : « Je ne serai pas la vice-chancelière de Mme Merkel. » Dans l’hypothèse où l’un des favoris du scrutin — et de Mme Angela Merkel —, c’est-à-dire M. Fillon ou M. Macron, s’installait à l’élysée, la continuité avec les présidents qu’ils ont servis respectivement serait en revanche assurée, la cohérence avec les orientations de la Commission européenne préservée et l’hégémonie allemande et l’ordolibéralisme confirmés, l’une faisant office de gardienne sourcilleuse de l’autre. La question se poserait différemment pour M. Hamon ou pour M. Mélenchon. Mis à part les tentations fédéralistes du premier et son appui à l’idée d’une défense européenne, leurs objectifs peuvent paraître proches. Mais leurs moyens de les atteindre diffèrent du tout au tout, au point que leurs deux candidatures se concurrencent et font courir à chacun le risque de l’élimination.
Avec M. Hamon, difficile d’échapper à un sentiment de déjà-vu. Cherchant à concilier son attachement à l’Union européenne et son désir de la voir rompre avec l’austérité pour conduire une politique plus favorable à l’emploi et à l’environnement et moins impitoyable envers des États comme la Grèce que leur endettement accable, le candidat socialiste doit se persuader que la réorientation à laquelle il aspire est possible, y compris dans le cadre des institutions actuelles ; qu’il est concevable d’« atteindre des résultats tangibles sans se mettre à dos toute l’Europe ». Et il fonde son espérance sur un regain d’influence de la gauche européenne, allemande en particulier.
Or c’est presque exactement l’hypothèse qu’avait laissée miroiter M. Hollande il y a cinq ans. Le 12 mars 2012, s’engageant « solennellement » devant ses camarades européens réunis à Paris à « renégocier le traité budgétaire » qu’avaient conclu Mme Merkel et M. Sarkozy, il précisait : « Je ne suis pas seul parce qu’il y a le mouvement progressiste en Europe. Je ne serai pas seul parce qu’il y aura le vote du peuple français qui me donnera mandat » (lire « L’engagement trahi »).
Mme Cécile Duflot, qui devint sa ministre du logement, nous rappelle la suite : « Tout le monde attendait que [M. Hollande] engage le bras de fer avec Angela Merkel. (…) Nous allions enfin tourner le dos au Merkozy. (…) Tout libéral et rigide qu’il est, l’Italien Mario Monti comptait sur la France pour inverser la tendance. Le très conservateur Mariano Rajoy voyait dans l’élection de François Hollande la possibilité de desserrer l’étau qui étreignait l’Espagne. Quant à la Grèce et au Portugal, ils étaient prêts à suivre n’importe quel sauveur pour éviter la ruine [10]. » On sait ce qu’il advint.
Une Union européenne fébrile à chaque scrutin national
Rien d’autre au fond que ce qui s’était déjà produit quinze ans plus tôt [11]. À l’époque, M. Hollande dirigeait le PS et M. Lionel Jospin le gouvernement. En guise de prélude à la monnaie unique, un « pacte de stabilité et de croissance » venait d’être négocié qui prévoyait un ensemble de disciplines budgétaires, dont des amendes en cas de déficits excessifs. Chef de l’opposition, M. Jospin n’avait pas manqué de dénoncer dans le pacte un « super-Maastricht », « absurdement concédé aux Allemands ». Devenu premier ministre en juin 1997, il en accepta néanmoins tous les termes au Conseil européen d’Amsterdam, quelques jours plus tard. Pour prix de son consentement, prétendit M. Pierre Moscovici, alors ministre des affaires européennes, il aurait arraché « la première résolution d’un Conseil européen consacrée à la croissance et à l’emploi ». Une résolution à l’impact foudroyant, comme chacun a pu en témoigner depuis.
MM. Hamon et Mélenchon entendent à leur tour renégocier les traités européens. Cette fois, s’en donnent-ils les moyens ? M. Hamon ne remet pas en question l’indépendance de la Banque centrale européenne, mais il espère « faire évoluer ses statuts ». Il consent à la règle des 3 % de déficit public, mais « souhaite des politiques de relance » compatibles avec ses ambitions écologistes. Il propose « la constitution d’une assemblée démocratique de la zone euro », mais il précise aussitôt : « J’accepterai qu’on en discute, évidemment. Je n’irai pas à Berlin ou ailleurs en disant : « C’est cela ou rien », ça n’a pas de sens. »
Certaines de ces réformes exigent l’accord unanime des membres de l’Union et aucune d’elles ne peut aujourd’hui se prévaloir de l’aval de Berlin. M. Hamon espère par conséquent modifier la donne grâce à un « arc d’alliance des gauches européennes ». Et il récuse le précédent peu encourageant de 2012 : « Je crois que les Allemands sont plus ouverts aujourd’hui qu’ils ne l’étaient quand M. Hollande est arrivé au pouvoir. » La crainte d’une dislocation de l’Union européenne d’une part, la perspective d’une alternance politique en Allemagne de l’autre auraient rebattu les cartes à son profit. « Je suis du parti de l’espérance », admet-il néanmoins.
L’espérance de M. Mélenchon, elle, a changé depuis 2012. Puisque « aucune politique progressiste n’est possible » dans l’Union telle qu’elle existe, à défaut d’une « sortie concertée des traités européens » ou de leur refonte (plan A) il n’exclut plus une « sortie unilatérale » (plan B). Comme il ne croit pas trop à une poussée prochaine et simultanée des forces de gauche, lesquelles auraient plutôt tendance à refluer ces dernières années, la France, deuxième puissance de l’Union, devient à ses yeux le « levier de la bataille européenne ». Codirecteur de la rédaction de son programme présidentiel, Jacques Généreux résume ainsi l’équation : « La sortie contrainte de la France signifierait la fin de l’euro et la fin de l’Union européenne, tout simplement. Personne n’a intérêt à prendre ce risque. Surtout pas l’Allemagne. » Par conséquent, tout en refusant de se plier aux règles européennes qui contraignent ses priorités économiques, « la France peut sans crainte, et si elle le souhaite, rester dans l’euro aussi longtemps qu’elle veut [12] ».
L’Union européenne était devenue indifférente aux choix démocratiques de ses peuples, assurée que les orientations fondamentales des États membres étaient verrouillées par des traités. Depuis le vote du « Brexit » et la victoire de M. Trump, la politique prend sa revanche. Une Union désormais fébrile observe chaque scrutin national comme si elle y jouait sa peau. Même la victoire d’un des candidats français qu’elle a adoubés ne la rassurerait pas longtemps.