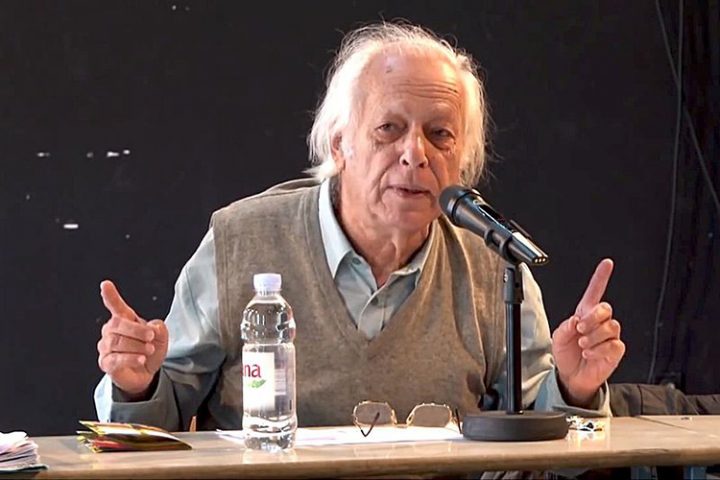I La bataille de l’ IDEP
Professeur à l’IDEP-Dakar (1963-1967)
J’avais accepté, courant 1962, de faire partie d’une équipe que les Nations Unies voulaient constituer pour créer en Afrique un « Institut de Planification et de Développement ». J’étais donc allé à Addis Abeba et devais pendant un mois cogiter avec les membres de cette équipe. J’avoue que je ne fus pas impressionné par ce qui s’y dessinait. La majorité – bureaucrates africains et « experts » étrangers – voyaient les choses d’une manière fort simple. On sait ce qu’il faut faire, tant ce que doit être une « bonne politique de développement » qu’un « bon enseignement des techniques de planification et de gestion ». C’est tout écrit dans les rapports d’experts, c’est un savoir qui est dans la tête de tous les bons profs. Naïveté incroyable des uns, prétention stupide d’autres. Mon point de vue était minoritaire, bien qu’il fut soutenu par quelques personnages clé, au-dessus de l’équipe, les uns à New York (Philippe de Seynes), les autres à Addis (quelques grands diplomates africains, des hauts fonctionnaires éthiopiens qui se révélaient bien au-dessus de la moyenne du continent, en dépit de tous les préjugés concernant leur pays « qui n’a pas eu la chance d’être colonisé »), et de l’Anglais Arthur Ewing qui assurait l’intérim du Secrétariat de la C.E.A., en attendant l’arrivée de Robert Gardiner, lequel, je dois le dire aussi, a vite montré qu’il penchait plutôt de notre côté. L’essai valait donc la peine qu’on s’y associe, et en octobre 1963 nous quittions, Isabelle et moi, Bamako pour nous installer à Dakar, siège du nouvel Institut Africain de Développement et de Planification, IDEP.
L’I.D.E.P. devait me faire découvrir rapidement à la fois les possibilités que l’O.N.U. offrait – faire du neuf, dans un esprit multinational – mais aussi les faiblesses extrêmes de ce système, ballotté entre des forces directrices centrifuges impossibles à concilier, pour des raisons intrinsèques tenant précisément à sa nature internationale. La valse des directeurs de l’I.D.E.P. au cours des années soixante, leur changement annuel pendant les quatre premières années de l’existence de l’Institution, à un stade premier où au contraire il aurait fallu le maximum de continuité, étaient bien l’expression de ces faiblesses. Bien que le comité préparatoire ait produit un document définissant les objectifs de l’Institut, son mode d’opération et de financement, les lignes générales de son programme d’enseignement (sans que la recherche n’y fut mentionnée autrement que par pure forme), ce document était du style des « résolutions » de l’O.N.U., diplomatique et ambigu. Le directeur et le collectif qui avaient la responsabilité de le mettre en oeuvre disposaient donc d’une marge d’autonomie – et de manœuvre – non négligeable, si on avait voulu en faire usage.
Je ne sais comment la direction fut d’abord confiée, la première année, à un couple curieux aux fonctions mal définies : Christian Vieyra (juriste béninois, on disait alors dahoméen) et John Mars (professeur d’économie en Grande Bretagne, d’origine autrichienne). Chacun d’eux criait fort : je suis le directeur, le premier en français, le second en anglais, l’un et l’autre rébarbatifs au bilinguisme, ne communiquant (généralement pour s’insulter) que par interprète (gêné) interposé. Vieyra était proche des hommes politiques les plus modérés de l’Afrique francophone, du Dahomey en particulier, sensibles à l’extrême aux opinions des experts de la coopération française (ex Ministère des Colonies, très vite rebaptisé sans quitter les lieux d’ailleurs et sans grand changement de personnel). Mars était un professeur d’économie conventionnelle, qui n’avait jamais ni connu le « tiers monde » ni réfléchi à ses problèmes. Il était de surcroît d’une naïveté politique illimitée.
Robert Gardiner s’est débarrassé du tandem Vieyra-Mars et a nommé l’année suivante le danois Boserup. J’ai du respect pour cet homme ouvert et curieux d’apprendre. Boserup était venu avec la mission de trouver, en un an, un directeur africain qui lui succéderait. Il tint sa promesse ; mais son choix fut, à mon avis, malheureux. Le sénégalo-mauritanien Mamoudou Touré n’était préparé en rien pour assumer cette fonction, ce qui ne devait pas l’empêcher de faire carrière plus tard, au F.M.I., dont il fut le serviteur zélé au Zaïre, puis, un temps, comme ministre des Finances à Dakar. Touré n’avait pas d’idées particulières concernant le rôle de l’I.D.E.P., qu’il acceptait de voir « enseigner des techniques » sans guère plus. De surcroît il était craintif à l’extrême et voulait donc éviter à tout prix la conduite de recherches qui auraient pu être critiques et déplaire, dans tel ou tel gouvernement, à un quelconque ministre. De mon côté je n’estimais pas possible un enseignement sans recherches et je poursuivais celles-ci – utilisant la marge de liberté dont nous disposions si on voulait s’imposer – par des travaux sur la Côte d’Ivoire, le Mali, les pays du Maghreb. Ce que j’en tirais effrayait Touré qui aurait voulu mettre ces « rapports » sous clé et en interdire tout usage ou diffusion. C’est pour ces raisons que je commençais à songer devoir quitter l’I.D.E.P., si Touré y conservait son poste. Quand je suis parti donc, en octobre 1967, ce directeur était toujours là, mais pas pour longtemps puisqu’il devait être recruté peu de temps après par le F.M.I. Son successeur fut David Carney, auquel je succédais moi-même en 1970.
En quittant l’I.D.E.P. j’avais cru utile d’adresser directement au secrétaire général de l’O.N.U. – à l’époque U Thant – une lettre dans laquelle j’expliquais les raisons de ma démission, sans mentionner quoi que ce soit de personnel, ni me concernant ni concernant les collègues et le directeur. J’expliquais simplement qu’à mon avis, le rôle de l’I.D.E.P. devait être autre que celui d’une école d’enseignement de techniques, mal placée dans la concurrence sur ce terrain avec les universités d’Afrique et d’ailleurs ; que l’Institut par contre devait tenter de devenir l’un des centres majeurs de réflexion critique sur les conceptions et les pratiques du développement en Afrique et articuler son enseignement sur ce type de débats. C’est cette lettre – retrouvée plus tard par la mission que le PNUD devait organiser en 1969 pour proposer des solutions à la crise de l’Institut qui a fait penser à moi en haut lieu pour prendre la succession.
J’avais donc la charge d’enseigner à l’I.D.E.P. la comptabilité nationale et les techniques (et expériences) africaines de planification. J’enseignais donc les techniques de l’input output, dont le maniement est relativement simple et formateur d’un minimum de rigueur, toujours nécessaire, mais je garde l’opinion que j’ai exprimée que la technique ne doit pas servir de paravent pour éluder les choix sociaux et politiques fondamentaux qui précèdent. J’enseignais également l’analyse de projets. Mais là je mettais en garde : ou bien cette analyse n’est rien de plus que la rationalisation du calcul capitaliste de rentabilité, et il faut le connaître pour comprendre comment le monde réel (qui est capitaliste) fonctionne ; ou bien on prétend extrapoler la logique de ce calcul pour lui donner une dimension sociale qui lui est étrangère. Et dans ce cas on propose aux décideurs nationaux des instruments qu’ils ne peuvent utiliser parce qu’ils sont en conflit avec le mode de décision que mettent en oeuvre les agents économiques réels. Ce type de « planification », qui a évidemment la préférence de la Banque mondiale au point qu’elle n’en connait pas d’autres, consiste donc en définitive à jeter de la poudre aux yeux. Le choix traduit en fait un refus de planifier. Qui est logique. Si le marché est autorégulateur, pourquoi intervenir ? Le développement d’ailleurs n’a plus de sens particulier ; il n’est que le résultat spontané des « forces du marché », il devient synonyme d’expansion du capitalisme, alors que la spécificité du concept de développement est précisément de s’en distinguer, d’être la traduction d’un projet sociétaire identifiable en termes d’objectifs sociaux et politiques.
Il fallait donc, à mon avis, avant tout apprendre aux futurs fonctionnaires du Plan à identifier ces incohérences, à en comprendre le mécanisme du déploiement, à proposer des correctifs. Ce que j’avais appris à faire au Caire, à Bamako et au S.E.E.F. était ici essentiel pour mon enseignement. Je le proposais sous la forme d’exercices, d’abord faits en classe, puis donnés à refaire par les étudiants seuls. J’inventais un T.E.E. (Tableau Economique d’Ensemble) simplifié ; je définissais un « Plan » dans les termes par lesquels ils sont généralement définis (volumes d’investissements, financements extérieurs etc.) à partir desquels on faisait d’abord des projections (disons à cinq ans) des grandeurs macro-économiques principales, ce qui permettait de faire connaître les liaisons déterminantes majeures entre ces grandeurs (propensions à importer , coefficients de capital, charges récurrentes etc), puis, en plaçant ces grandeurs dans un T.E.E. projeté, d’identifier les incohérences. Outils : les tables d’intérêts composés et la règle à calcul.
Voilà donc comment je comprenais mon métier d’enseignant. Pour le tiers des étudiants qui avaient un minimum de formation – fut elle très générale – ou de capacités intellectuelles et de volonté de travail, les résultats ont été, je crois, pas mauvais. J’ai retrouvé beaucoup de ces étudiants des années plus tard, dans leurs pays respectifs, et j’ai constaté que leur travail y était apprécié.
Directeur de l’Idep ( 1970-1980)
La mission d’évaluation des Nations Unies dont j’ai parlé plus avant était parvenue à la conclusion que le rôle que l’I.D.E.P. devrait remplir en Afrique était principalement celui d’analyser les expériences et les stratégies du développement et de la planification, et de greffer son enseignement sur cette connaissance spécifique. C’était exactement la position que j’avais défendue dans la commission chargée de la création de l’institution, et que j’avais rappelée dans ma lettre de démission. Retrouvant cette lettre dans leur dossier de « briefing » il était normal que la mission pense à moi pour prendre la relève. Philippe de Seynes, que je ne connaissais pas encore, le fit.
J’hésitais, en me demandant si véritablement je pourrais mettre en oeuvre le changement souhaité, compte tenu de toutes les faiblesses du système des Nations Unies dont je commençais à avoir eu l’expérience. Mais j’étais en position de force pour négocier. Alors pourquoi ne pas tenter ? Je rencontrais donc – pour interview comme on dit – Philippe de Seynes à New York. La discussion a été d’emblée franche et cordiale. Nous sommes d’ailleurs devenus des amis à dater de ce jour. Je lui rappelais que j’avais des opinions auxquelles je ne renoncerai pas, que je continuerai à les exprimer dans les écrits à venir, et que probablement cela ne plairait pas à tout le monde. Qu’importe, me dit-il, quelqu’un qui n’a pas d’opinions ne peut remplir les fonctions qu’on attend de lui dans un poste comme celui-là. Regardez la CEPAL (la Commission Economique pour l’Amérique Latine). Raul Prebisch n’hésite pas à s’entourer d’intellectuels qui sont tous dans l’opposition vis à vis de leurs gouvernements, souvent même réfugiés politiques, comme les Brésiliens, Celso Furtado et Fernando Henrique Cardoso. Le succès de la CEPAL leur est dû, est à rapporter à la liberté académique qui y règne.
Je convenais donc d’accepter le poste, en principe. Je précisais néanmoins que la « rigolade » (c’est le terme que j’ai employé) ne durerait peut être que trois mois. Je devrais en effet réunir le Conseil d’Administration de l’I.D.E.P., présidé par le Secrétaire Exécutif de la C.E.A., leur soumettre mes propositions. Je ne pensais pas qu’ils les accepteraient et je n’avais aucune intention de les manipuler pour leur arracher un ralliement ambigu. Mais, ai-je dit, je ne ferai pas de chantage et ne leur laisserais pas entendre qu’en cas d’échec de la réunion je démissionnerais. On verra. Acceptez-vous, Monsieur de Seynes, de recevoir sans surprise ma lettre de démission dans trois mois. J’accepte le risque, mais vous verrez que j’ai raison, il est négligeable. Ils finiront par avoir ma peau, répliquais-je. Cela prendra beaucoup de temps, beaucoup plus que vous ne le pensez, concluait de Seynes. L’histoire lui a donné raison : cela a pris dix ans.
LE RAYONNEMENT DE L’I.D.E.P. EN AFRIQUE
A peine installé je téléphonais à Gardiner pour lui faire part de mon souhait de le rencontrer et le mettre au courant de mes intentions. Je les connais, me répondit-il, vous les avez déjà exprimées. Vous en connaissez les principes, mais les modalités doivent être précisées à leur tour, et j’apprécierais votre opinion à ce sujet, comme il nous faut entendre le Conseil d’Administration. Echanges de paroles courtoises, mais insuffisantes pour me faire comprendre si l’accord que Gardiner avait donné à New York pour ma nomination était sincère.
A Dakar je faisais le tour de l’Institut, rencontrais le personnel. Kwame Amoa avait été recruté après mon départ et songeait s’en aller. Je me rendais compte immédiatement qu’il avait de grandes qualités. Derrière une apparence flegmatique à la britannique, ce jeune Ghanéen était intelligent, fin, réfléchi, progressiste dans ses réactions immédiates. Je pensais donc immédiatement introduire une première innovation dans l’organisation de l’Institut, créer un poste de directeur adjoint dont il serait le bénéficiaire. Moi égyptien et classé francophone, lui ouest africain anglophone, cela serait une bonne chose pour l’équilibre et la représentativité de l’IDEP. Par ailleurs cela assurerait une permanence, puisque l’un et l’autre nous serions appelés à nous déplacer fréquemment. En fait, il avait plus que ces capacités, il avait le tempérament d’un diplomate de qualité, qui savait à la perfection comment rédiger des propositions, négocier, reconnaître l’essentiel et faire les concessions utiles. Nous sommes devenus des amis très proches et j’ai dit de lui qu’il aurait pu être le Ministre des Affaires étrangères d’une grande puissance. Aucun des directeurs avant moi n’avait imaginé être secondé par un adjoint. En bons autocrates ils ne voyaient automatiquement dans leurs collègues que des adversaires à l’affût pour prendre leur place !
Je ne connaissais pas les membres du conseil d’administration élus par une « Conférence des Planificateurs Africains » qui se réunissait tous les deux ans au siège de la C.E.A. à Addis Abeba. Bien que cette conférence fut censée être suivie par les ministres responsables, elle n’était en fait qu’une réunion d’administrateurs du développement. Il y avait parmi ceux-ci de tout, certains étaient des fonctionnaires de qualité, d’autres insignifiants. Ce n’était pas forcément les meilleurs qui étaient choisis pour le Conseil de l’I.D.E.P. et la règle de la représentation de chacune des quatre régions du continent (Afrique du Nord, de l’Ouest, du Centre, de l’Est et Australe) comme celle de l’équilibre linguistique compliquaient les choses. La constitution du conseil pouvait donc faire l’objet de manipulations. Gardiner y répugnait, par tempérament probablement. Mais plus tard Adedeji ne devait pas manquer d’y recourir. Je laissais tout cela se faire et défaire sans aucune préoccupation, ayant opté pour le principe de ne pas chercher à me « faire des amis » dans le Conseil. Les Conseils que j’ai connus étaient d’une composition hétéroclite, à l’image de ce que sont les administrations en Afrique, et ailleurs. Il y avait parmi leurs membres des administrateurs ouverts et compétents, avec qui on pouvait argumenter. Mais il y avait aussi les éternels « chasseurs de per diem » qui se font élire pour avoir l’occasion de voyager, donc corruptibles. Mes propositions furent soutenues par Gardiner sans aucune réserve, mais peut être aussi sans enthousiasme. Le Conseil les approuva sans problème.
J’introduisais, avec l’accord du Conseil, l’idée d’un « Conseil académique consultatif ». J’estimais plus qu’utile – nécessaire – de ne pas « travailler seul » et d’avoir l’opinion de gens avisés. C’est dans mon tempérament. Or le Conseil d’administration ne pouvait remplir cette fonction. J’ai donc soumis à Gardiner une liste de noms qu’il approuva, en me disant néanmoins : ce sont de trop grandes personnalités, ils ne viendront jamais. Ils sont tous venus. Il y avait parmi eux Dudley Seers, qui initiait la nouvelle université modernisée de Brighton en Grande Bretagne, Celso Furtado qui nous apportait le savoir accumulé en Amérique latine et à la CEPAL, le Nigérian Onitiri, l’un des plus anciens universitaires d’Afrique, Ismaïl Abdallah, Charles Prou, directeur du C.E.P.E. Je précise -est-ce nécessaire ? – que ces deux derniers, bien qu’amis, n’ont pas le tempérament d’être des « complices ». Leurs avis, critiques, suggestions étaient aussi libres que ceux des autres.
L’option fondamentale était de faire de l’I.D.E.P. un centre de réflexion africain de première grandeur. D’arracher aux institutions étrangères de « l’assistance technique » et de la « coopération », qu’elles fussent européennes, américaines ou onusiennes, le monopole de penser pour l’Afrique. Donc de mettre l’accent sur la recherche et de tailler des enseignements sur mesure qui pourraient véhiculer les débats et démultiplier leurs effets.
Les formules en furent diverses. Nous maintenions des enseignements relativement longs (un et deux ans) de manière à pouvoir en approfondir les effets et à associer les meilleurs étudiants à des recherches où ils feraient leur apprentissage, de manière également à permettre d’acquérir l’outillage et la maîtrise des techniques. L’une des innovations majeures fut celle d’un programme de séminaires de 4 à 6 semaines organisés hors de Dakar. J’y voyais beaucoup d’avantages : toucher un multiple du nombre de nos étudiants puisque chaque séminaire pouvait réunir 50 à 100 participants, à faible coût (les séminaires étaient monolingues et la majorité des participants déjà sur place dans le pays où l’on opérait), établir des rapports étroits avec les universités locales invitées à partager les responsabilités du séminaire, et avec les administrations et les services chargés du développement. L’I.D.E.P. remplissait fréquemment ici le rôle d’un catalyseur et amortisseur de chocs entre universitaires et administrateurs qui se méprisaient mutuellement, entre différentes forces politiques et courants de pensée qui ne se fréquentaient guère en dehors de nos invitations. Plus d’une trentaine de ces cours/séminaires ont été organisés au cours des années 1970, dans vingt cinq capitales africaines différentes, donnant par là même un rayonnement continental à l’Institut. Chacune de ces opérations était un véritable événement dans le pays concerné, longtemps commenté et presque toujours vivant dans la mémoire de ceux qui y avaient participé. Je garde un souvenir précis d’une dizaine de ces séminaires (tenus à Alger, Bamako, Cotonou, Ibadan, Douala, Brazzaville, Kinshasa, Mogadiscio, Dar es Salam et Tananarive).
Pour mener à bien ces tâches il fallait bien entendu recruter un personnel du niveau requis et en nombre minimal suffisant. Nous y sommes parvenus, plus ou moins, attirant à l’I.D.E.P. des intellectuels dont certains sont suffisamment connus par leurs publications pour qu’il soit inutile de les présenter ici. L’équipe s’étoffait progressivement et comprenait à un moment ou un autre, Norman Girvan (Jamaïque), Oscar Braun (Argentine), Hector Silva Michelena (Venezuela), Fawzy Mansour, Naguib Hedayat et Hassan Khalil (Egypte), Samba Sow (Sénégal), Jacques Bugnicourt et Duhamel (France), Bernard Founou (Cameroun), Cadman Atta Mills (Ghana), Jagdish Saigal (Inde) et Marc Franco (belge, qui a fait une belle carrière par la suite à la CEE), Anthony Obeng (Ghana), Joseph Van den Reysen (Congo). Nous parvenions également à la renforcer par de nombreux « missionnaires », soit financés par la coopération française (parmi lesquels Pierre Philippe Rey, Catherine Coquery Vidrovitch, André Farhi, Francine Kane), soit invités d’Afrique identifiés au cours de nos séminaires. Certains de ceux-là ont été attachés à des programmes de recherches spécifiques, lorsque nous en trouvions le financement, comme les deux guinéens Baldé et Kouyaté, le malien Lamine Gakou, le soudanais Hamid Gariballah, les deux sénégalais Abdousalam Kane et Alioune Sall (rattachés au programme spécial de l’ENDA), le kenyan Abdalla Bujra et le Malawi Thandika Mkandawire. Amoa et moi-même, en dépit de nos charges, n’avions pas renoncé à participer à l’enseignement, fut-ce à moindre dose ; je n’aurais pour ma part jamais accepté l’idée qu’on peut « diriger » un institut sans partager avec les collègues la connaissance directe de ses problèmes, c’est à dire sans le contact vivant avec ses étudiants et sans la participation active aux équipes de recherche.
Cette équipe était évidemment apte à conduire des programmes de recherches faisant du sens. Comme je l’avais appris au S.E.E.F. les meilleurs programmes sont ceux que les responsables définissent eux-mêmes et mettent en oeuvre librement. Le collectif servait donc de chambre de discussion des propositions, engagements volontaires des participants et débats organisés aux différentes étapes du travail. Et si peut être quelques individus pouvaient trouver dans ce système le moyen de se dérober, dans l’ensemble la méthode a probablement produit des résultats meilleurs que ceux que donne la répartition autoritaire des tâches. En témoigne le nombre des papiers produits – plus de 400 – , certains de la taille d’ouvrages, et le démarrage de la publication de ces résultats, négocié avec l’éditeur Anthropos pour le français et l’université de Dar es Salam pour l’anglais.
Le rayonnement que l’I.D.E.P. avait conquis occasionnait à son tour l’appel à l’Institut pour des missions de consultations. L’un des objectifs qui m’étaient toujours paru prioritaire était de briser l’isolement dans lequel la colonisation avait enfermé l’Afrique. Nous avons donc organisé dans cet esprit les deux premières grandes rencontres entre intellectuels d’Afrique et d’Amérique latine (à Dakar en 1972) puis d’Afrique et d’Asie (à Tananarive en 1974). C’était pour beaucoup la première fois que l’occasion leur était donnée de débattre entre eux des grands problèmes du tiers monde. Jusque-là tout au plus quelques-uns d’entre eux s’étaient entrevus par hasard dans des réunions internationales dont l’ordre du jour ne portait pas toujours sur les questions qui étaient au centre de leurs préoccupations. Pour beaucoup de latino-américains et d’asiatiques il s’agissait de leur première visite en Afrique. J’épargnerai les noms, qui sont pour la plupart bien connus. L’école « dépendantiste » latino-américaine était représentée par ses plus grandes figures – Fernando Henrique Cardoso, Ruy Mario Marini, Teotonio dos Santos, Pablo Gonzalez Casanova, André Gunder Frank, Anibal Quijano, Gérard Pierre Charles etc. Cardoso n’avait jamais encore mis les pieds sur le continent qui n’est pourtant pas sans importance pour le pays dont il est devenu le président, le Brésil. Personne ne l’y avait invité. A Tananarive les Asiatiques du Sud-Est, singulièrement les Indonésiens et les Malais, étaient surpris de se retrouver à moitié chez eux, tandis que les Africains entendaient pour la première fois une panoplie des meilleurs noms de la science sociale de ce pays continent qu’est l’Inde.
L’expansion des activités de l’I.D.E.P. exigeait la mobilisation de moyens financiers supplémentaires, au- delà du budget réglementaire, financé par les Etats africains et le PNUD. Nous parvenions à collecter plus de 50 % des sommes pour lesquelles les Etats africains s’étaient engagés en principe, soit plus de 600.000 dollars par an. Cela représentait une proportion de respect des engagements financiers meilleure que celle des fonds collectés par l’O.N.U. elle-même à l’échelle mondiale et bien meilleure que celle qui concernait les versements des Etats africains à toute autre organisme africain ou international. Mais cela ne devait pas empêcher les tristes sires que sont Doo Kingue (propulsé par les Américains à la direction du P.N.U.D.), Bertin Borna (Résident Représentant de l’O.N.U. à Dakar), et quelques autres comme l’affreux Paul Kaya d’engager des diatribes démagogiques – seulement 50 % ! Or après mon départ de l’I.D.E.P., lorsque précisément ces détracteurs s’y sentirent chez eux pour faire la pluie et le beau temps, cette proportion est tombée à presque zéro !
Parallèlement je me mis à rechercher activement des sources de financement supplémentaires. Philippe de Seynes et Gardiner, je dois dire, m’ont donné carte blanche pour le faire. Je suis parvenu à collecter ainsi des moyens qui doublaient presque le budget de l’I.D.E.P. Sur ce plan la coopération française a été véritablement décevante et n’a pas changé depuis. Je réussissais mieux avec l’Italie qui acceptait de financer un programme de recherche (mis en oeuvre par Baldé et Kouyaté) et surtout avec la Suède dont la SAREC, récemment créé (en 1975 si je ne me trompe) s’est avéré par la suite d’une générosité exemplaire à l’égard de nos projets. Je reviendrai sur l’entretien avec Olof Palme qui m’a ouvert ces portes.
Certes les coûts globaux de l’administration de l’Idep étaient élevés, en grande partie pour des raisons objectives réduisant les possibilités de compression à presque néant : barèmes des salaires onusiens, bilinguisme (entraînant la traduction et l’interprétation), bibliothèque que je tenais à voir enrichie de tout ce qu’il fallait – livres et revues. Néanmoins d’autres sources de dépenses me paraissaient pouvoir être réduites. L’administration onusienne est lourde et multiplie les postes administratifs et financiers avec une avalanche hiérarchique. Le mode de comptabilité est l’un des plus inutilement compliqué qu’on puisse avoir imaginé. Et cette complication ne facilite pas l’audit dont la nécessité est toujours absolue, loin de là. Elle facilite seulement la guérilla bureaucratique si les circonstances s’y prêtent ! J’invitais donc Gustave Massiah, dont je connaissais l’immense compétence dans ces domaines de l’organisation, à étudier la question. Je n’ai pas mis en oeuvre les recommandations intelligentes qu’il m’a proposées. Je me suis immédiatement rendu compte que je prêterais le flanc à une attaque sur un terrain favorable à l’adversaire. Ce n’était pas le terrain sur lequel j’avais choisi de contraindre ce dernier à se battre.
Je ne concevais pas que l’I.D.E.P. puisse remplir à elle seule toutes les fonctions attendues d’un centre majeur de réflexion. Il fallait donc prendre des initiatives et créer d’autres institutions, plus spécialisées ou à vocation complémentaire. La direction de l’I.D.E.P. était bien située pour stimuler ces initiatives. Ce que je fis dans trois directions.
J’avais été invité à la conférence de Stockholm (1973) qui initiait la prise de conscience des problèmes de l’environnement à l’échelle mondiale. Je crois que j’ai saisi immédiatement la pertinence et l’importance du problème. Je négociais donc – avec les Suédois – le soutien à un premier programme test pour l’Afrique et, rentré à Dakar, j’en confiais l’exécution à Jacques Bugnicourt, en 1974. C’est Bugnicourt qui a eu l’idée d’appeler ce programme E.N.D.A (Environnement pour le Développement en Afrique). Bien placé auprès de la coopération française il obtenait d’elle le financement d’un noyau de personnel d’appui (si je ne me trompe Mataillet, Guibert, Melle Mottin, Langley et plus tard Mhlanga) qui a permis le démarrage effectif et l’expansion rapide du projet. En conformité avec mon tempérament je donnais à Bugnicourt carte blanche pour négocier les moyens d’exécution de son programme et il le fit avec le talent qu’on lui connaît. E.N.D.A. faisait néanmoins partie de l’I.D.E.P., juridiquement, jusqu’à ce qu’en 1977 ce programme se transforme en une institution indépendante. Ce qui avait été mon objectif dès le départ.
Même topo pour le CODESRIA sur laquelle je reviendrai plus en détail dans un autre chapitre de ces Mémoires.
Je parlerai plus loin dans ces Mémoires avec plus de détails de la création du Forum du Tiers Monde. J’en prenais l’initiative avec un groupe de collègues et de personnalités d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ; nous obtenions que le Président du Chili, Allende, nous invite en 1973 (à peine trois mois avant le coup d’Etat de Pinochet) à Santiago pour mettre au point le projet. Le congrès constitutif du Forum s’est tenu ensuite à Karachi en 1975, l’un de nos membres ayant obtenu son financement par la Banque Nationale du Pakistan. Je reviendrai également avec plus de détails sur l’audience qu’Olof Palme m’accordait (la même année je crois) et sur le financement par la SAREC suédoise qui a suivi, permettant le démarrage effectif ultérieur de cette nouvelle institution importante du Tiers Monde.
Les années 1970 ont été celles de la grande époque pour l’I.D.E.P. Sans fausse modestie je peux dire que le nom de l’institution était connu et respecté surtout le continent. Mais justement pour cela, je savais que cela ne pourrait durer.
L’administration des Etats Unis était notre adversaire fondamental, comme elle l’est de toutes les forces de libération dans le tiers monde. L’I.D.E.P. – si mineure que puisse être une telle institution sur l’échiquier mondial – devait être détruite. La stratégie américaine ne néglige jamais de faire ce qu’elle doit, sur tous les fronts, majeurs et mineurs. La guerre de position avait commencé dès 1972, par personnes interposées, bureaucrates africains médiocres (ou corrompus) eux-mêmes pour cette raison dépendants pour leur carrière onusienne de la note que la CIA leur donnerait. Ma stratégie de contre-feu était simple : mettre les Etats africains de notre côté. Application de la phrase des Chinois « les Etats veulent l’indépendance, les nations la libération, les peuples la révolution ». Il s’agissait donc d’une bataille pour le respect du principe de l’indépendance des Etats africains. Ayant choisi ce terrain pour y porter la bataille (et c’est pourquoi j’abandonnais les autres terrains secondaires dont j’ai parlé plus haut) ma stratégie était simple : tenir les Etats au courant. Non pas par le renseignement de détail sur les intrigues de l’adversaire ; au contraire mépriser celles-ci et simplement donner toute la transparence nécessaire à nos activités, sur le fond, et en informer les plus hautes autorités, jusqu’aux chefs d’Etat qu’on pouvait savoir sensibles à l’argument d’indépendance et capables de comprendre la portée positive de nos activités.
Mais voilà qu’une occasion fût donnée à l’adversaire lui permettant d’intensifier son offensive. Gardiner quittait le Secrétariat de la C.E.A. et Adebayo Adedeji qui lui succédait était un jeune loup autocrate et avide. Adedeji redoublait immédiatement l’intensité de la guerilla administrative par le canal du « chef de l’administration » dont la carrière dépendait de lui, chargé de saboter le travail et de nous noyer de « mémos ». Je n’acceptais pas le combat sur ce terrain et ne répondais même pas à ces « mémos ». C’est alors qu’Adedeji fut contraint de monter au créneau. En 1978 il fit transférer la tutelle de l’I.D.E.P. de l’O.N.U. à la C.E.A., c’est à dire à lui, puis s’employa à manipuler la conférence des Planificateurs Africains et le Conseil d’Administration de l’Institut pour leur faire adopter deux résolutions catastrophiques pour l’avenir de l’I.D.E.P. Par la première les séminaires nationaux étaient supprimés et le seul cours à Dakar maintenu, soit disant pour le renforcer. Résultat : le volume des activités d’enseignement de l’Institut, mesuré en stagiaires /mois, qui avait presque doublé (augmenté de 90 %) entre 1970 et 1977, devait redescendre à son niveau de départ lors de ma dernière année de direction, en 1979. Par la suite ce dernier niveau n’a jamais été dépassé, à ma connaissance. Par la seconde résolution tous les budgets annexes, financés par des accords spéciaux, étaient supprimés et la négociation éventuelle d’accords retirée à la direction de l’I.D.E.P. et transférée à la C.E.A. Bien entendu la C.E.A. n’a rien négocié par la suite, ou tout au moins rien obtenu. Evidemment je sauvais les meubles. E.N.D.A., CODESRIA et FTM pouvaient être chassés de l’I.D.E.P., ils avaient les moyens de leur propre autonomie. Moi-même et Amoa, à la surprise d’Adedeji, nous démissionnions en mai 1980.
Les trois mois de « rigolade » avaient duré dix ans.
La machine onusienne
Le monde moderne est constitué de nations interdépendantes. Dans l’inégalité, et même dans une inégalité qui ne cesse de s’aggraver depuis deux siècles. Concevoir et mettre en oeuvre une autre organisation des sociétés et de leur interdépendance qui supprime cette dimension majeure de la réalité du monde moderne – que j’appelle la polarisation immanente à l’expansion du capitalisme mondialisé – constitue l’une des tâches majeures de la civilisation, si on veut que celle-ci ne périsse pas corps et âme dans les destructions matérielles et morales que la polarisation produit inéluctablement.
La victoire remportée sur le fascisme à l’issue de la seconde guerre mondiale et l’essor des mouvements de libération nationale en Asie et en Afrique, qui a imposé la liquidation du vieux colonialisme, sont à l’origine de la création de l’ONU, la première tentative dans l’histoire de l’humanité d’organiser les relations internationales à l’échelle de la planète, même s’il a fallu attendre encore une quinzaine d’années après 1945 pour que la couverture de la planète devienne à peu près totale. La création de l’ONU a été, de ce fait, un fait historique positif ; l’ONU est nécessaire, et si elle n’existait pas il faudrait l’inventer.
Ma vision de l’ONU est donc d’abord essentiellement politique. En ce sens elle est certainement différente de celle de la grande majorité de ceux qui ont opéré sous son drapeau et qui voient l’organisation comme une sorte de « pool d’expertise » mis par les uns à la disposition des autres. Cette vision est celle du discours sur le « village mondial » qui est, pour moi, tout simplement ridicule, parce qu’il ignore la réalité majeure – la polarisation générée par la logique du système.
La mondialisation n’est pas un phénomène nouveau et je ne suis sans doute pas le seul à m’y être intéressé bien avant qu’elle ne soit devenue un thème de la mode dominante. Cette dimension est présente dès l’origine dans mon analyse du capitalisme réellement existant. J’ai toujours pensé que l’unité d’analyse la plus pertinente était le système mondial, non les sous-systèmes qui le composent. Qui s’enferme dans les frontières d’un pays quelconque – Etats Unis ou Belgique, Chine ou Somalie – se condamne donc à ne pas comprendre véritablement la dynamique du changement même à l’échelle de sa seule propre société.
Certes la solution de ce problème majeur n’est pas pour demain, puisqu’elle implique des transformations de fond en comble de tous les aspects de la vie sociale dans toutes les régions du monde, que je ne vois pas comment on pourrait qualifier autrement que par le terme de « socialisme à l’échelle mondiale ». Ces transformations impliqueront forcément, à un certain stade de leur déploiement, le dépassement de l’optique inter-nationale (des rapports entre nations) et la construction de rapports véritablement supra-nationaux. Il n’est pas impossible que cette exigence soit d’abord ressentie dans le cadre de grandes régions, comme la construction européenne aurait dû et pu l’illustrer. Or l’ONU ne fournit pas, dans l’état actuel des choses, ce cadre supranational à l’échelle mondiale même sous une forme embryonnaire. L’organisation reste strictement internationale. Si elle venait à se bloquer indéfiniment à ce stade, elle risquerait alors de faire oublier la portée du projet qui était à son origine : organiser le monde dans une perspective humaniste. Mais l’ONU ne pourra contribuer à l’évolution, dans ce sens nécessaire et souhaitable que si ses composantes – les nations – en préparent elles mêmes les conditions, par leur propre transformation.
Il y a beaucoup d’obstacles qui entravent ces transformations, aux échelles locales et à celle du système mondial. Cependant l’obstacle immédiat principal est l’hégémonisme des Etats Unis. Un hégémonisme qui n’est plus fondé sur une supériorité économique et technologique qui, écrasante aux lendemains de 1945, s’est érodée rapidement. Cette hégémonie aujourd’hui est fondée avant tout sur le monopole de la puissance des armes, renforcé par les effets de la mondialisation néo-libérale et le discours de la « culture » vulgaire du capitalisme exprimée dans le jargon de l’anglo-américain.
L’ONU n’est donc pas pour moi une institution méprisable, inutile, qui fausse le fonctionnement réel des rapports entre les Nations – qui ne sont conçus alors que comme des rapports de force. Mais elle n’est pas non plus le noyau de l’organisation du « village mondial ». Cette vision, populaire dans certains milieux, est, à mon avis, naïve, encore une fois parce qu’elle saute par-dessus la réalité des mécanismes polarisateurs qui opèrent dans ce soit disant « village ».
L’adversaire principal est donc l’hégémonisme américain. Et celui-ci s’emploie avec toute sa vigoureuse puissance à la fois pour soumettre tous les pays du monde – fut-ce à des degrés divers et par des moyens appropriés bien entendu – et simultanément organiser l’ordre international qui lui convient, qui exige l’instrumentalisation de l’ONU. Le combat pour la défense de l’organisation internationale et le progrès de sa mission est donc synonyme de combat contre l’hégémonisme américain.
La plupart des pays capitalistes développés ont accepté le leadership des Etats Unis. Cette conjoncture a toujours permis aux Etats Unis d’instrumentaliser les Nations Unies, non sans arrogance. C’est pire aujourd’hui, d’autant que les diplomaties occidentales ont repris en chœur les campagnes du dénigrement de l’ONU orchestrées par Washington, pour le plus grand profit de l’OTAN ! On dira qu’à côté des puissances majeures certaines puissances moyennes sont différemment actives au sein du système des Nations Unies : les Scandinaves entre autre. En termes de contributions financières et de postes de responsabilité le poids de ces pays dans le système onusien est effectivement important. En exploitent-ils tout le potentiel ? La réponse à cette question n’est pas simple. J’ai souvent entendu dire que les responsables de ces pays seraient « naïfs » et que de ce fait, ils sont enclins à défendre des positions de « wishful thinking » (voeux pieux) surestimant le rôle de l’ONU, ou bien encore que, par leur culture protestante, ils sont enclins à s’aligner naturellement sur les positions hégémoniques de la grande métropole américaine. Je crois toutes ces explications non pas seulement – au mieux – fort superficielles, mais encore largement erronées et trompeuses. Certains de ces pays – la Suède – ont pris des positions courageuses de soutien aux luttes dans le tiers monde, parfois en conflit frontal avec les Etats Unis. La Suède a accueilli les déserteurs américains pendant la guerre du Viet Nam (aucun autre pays occidental ne l’a osé), elle a soutenu les luttes de libération dans les colonies portugaises à un moment où aucun pays de l’alliance atlantique ne l’a fait. Je crois donc plutôt que ces pays ont fait une option stratégique de soutien de principe à l’ONU, peut-être parce que – compte tenu de leur taille modeste – ils craignent d’être parmi les plus vulnérables dans une conjoncture de chaos international. Dans ce cas leur option est, à mon avis, correcte et positive. Cela ne signifie pas qu’ils en déduisent nécessairement des postures efficaces, ni qu’ils exploitent au mieux leur présence dans le système onusien.
La diplomatie des pays du tiers monde a été fort active au sein du système des Nations Unies pendant toute la période de Bandung et singulièrement entre 1960 et 1975. Qui ne se souvient des Assemblées générales de ces grands jours de l’ONU, lorsque, dans le hall du bâtiment de New York, en septembre-octobre de chaque année, on rencontrait des hommes d’Etat d’envergure et les plus célèbres des journalistes. De nos jours le hall n’est plus guère hanté que par des fonctionnaires subalternes et des journalistes sans importance. La diplomatie des Non Alignés et du Groupe des 77 imposait la discussion de tous les véritables grands problèmes de notre époque, ceux concernant l’ordre économique international – avec entre autre la création de la CNUCED en 1964 – comme ceux concernant les interventions politiques des puissances dans les affaires du tiers monde. Le poids que la diplomatie du tiers monde avait à l’époque tempérait les ambitions de Washington au sein de l’appareil onusien, en dépit de la soumission de leurs agents d’exécution – africains et autres – au sein de cet appareil.
Mais quelle qu’ait été la valeur de la diplomatie du tiers monde de l’époque, son intervention dans la gestion onusienne était largement annihilée par l’action des Américains et de leurs « amis ». Ceux-là, propulsés à des postes de décision – dont ils n’étaient évidemment que les exécutants, d’autant plus élevés qu’ils étaient médiocres, voire fragilisés par les dossiers de la CIA – n’ont jamais eu de rôle autre que celui que leurs patrons leur assignaient. Inutile de donner des noms, ce que j’ai dit plus haut en suggère immédiatement quelques-uns. Beaucoup d’entre eux avaient presque le physique de l’emploi. Vulgarité bien entendu. Le malheur est que, derrière ces personnages – les « amis » des Américains et de beaucoup de ceux qui dans les autres pays de l’Occident en acceptent la stratégie – se profilaient – et se profilent toujours – des cohortes « d’experts » et même parfois des « intellectuels ». Pas suffisamment forts pour s’imposer comme « irremplaçables ». Pas suffisamment courageux pour ne pas succomber à la tentation de « faire carrière ». Ce choix fait, la déchéance progressive devient fatale. Quelques-uns sombrent même dans l’alcoolisme, sans doute pour noyer leurs remords.
J’ai voulu ici simplement brosser le tableau du cadre humain dans lequel la bataille de l’IDEP et bien d’autres ont été conduites à l’époque.
Source : http://samiramin1931.blogspot.fr/2017/02/samir-amin-extraits-des-memoires-idep.html