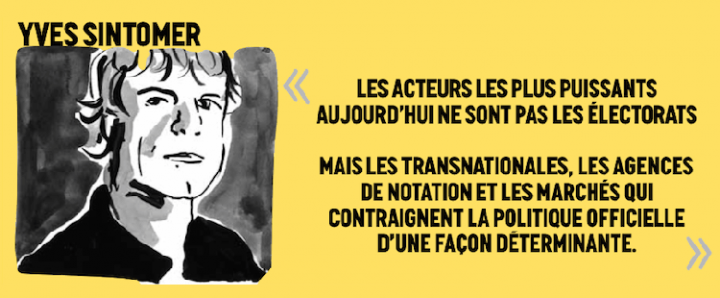En ces temps d’élections présidentielles qui ont vu aux États-Unis la victoire d’un Donald Trump et, en France, la multiplication de candidats qui pour la plupart ne se différencient plus beaucoup sur le plan politique ou idéologique, le néolibéralisme a t-il perverti la raison politique ? Nous avons posé la question à Yves Sintomer, professeur de science politique à l’Université Paris 8.
De quelle manière le néolibéralisme pèse t-il sur la politique institutionnelle ?
Il pèse de deux manières, un peu différentes en France et aux États-Unis. Il y a, d’une part, un phénomène quasi universel avec la globalisation menée par le capitalisme financier : les acteurs les plus puissants aujourd’hui ne sont pas les électorats mais les transnationales, les agences de notation et les marchés qui contraignent la politique officielle d’une façon déterminante. D’autre part, aux États-Unis et dans les pays qui ont adopté leur modèle, notamment en Amérique latine, il y a un facteur spécifique avec l’influence déterminante de l’argent dans les campagnes politiques. Il n’y a pratiquement pas de limites au financement privé des campagnes et, de fait, les partis américains se réduisent pour l’essentiel à être des machines à trouver de l’argent. En France, il existe encore une autre dimension qui tient à la proximité des élites politiques et économiques. Celles-ci viennent des mêmes milieux sociaux et passent allègrement d’un espace à l’autre – Barroso en étant ces derniers temps l’exemple le plus éclatant, mais même quelqu’un comme Montebourg n’échappe pas à cette proximité.
À cela s’ajoute encore l’influence des médias…
Les médias constituent en effet un autre facteur d’influence. Aujourd’hui, l’essentiel des grands médias est possédé par le grand capital qui se sert de la presse comme d’un canal d’influence auprès des politiques et de la société. Certes, celle-ci est partiellement limitée grâce à l’émergence des médias sociaux. Mais il faut savoir que seulement un pour cent des sites concentre la visibilité des médias sociaux. De plus, ceux-ci tendent à pousser à une “discussion entre soi”, c’est-à-dire à une information qui s’échange entre gens qui sont d’accord entre eux (alors qu’un des intérêts des médias traditionnels était d’une plus grande pluralité des points de vue). Et même si l’influence des médias sociaux augmente de plus en plus, ce qui est une très bonne chose, il n’en reste pas moins que les médias traditionnels continuent de peser. D’ailleurs, sur Internet, une des sources importantes d’information vient des sites on-line des grands journaux.
Quelles sont les conséquences de ce discrédit de la politique officielle ?
D’abord le désarroi des classes populaires traditionnelles qui ne sont plus représentées par les grands partis de gauche, qu’ils soient socio-démocrates, communistes, ou comme le Parti démocrate aux États-Unis, et qui, soit s’éloignent tout simplement de la politique institutionnelle, soit sont attirés par des partis nationaux-populistes autoritaires. Ceux-ci prônant comme un retour en arrière, au temps des Trente Glorieuses en France, au temps où les sociétés n’étaient pas multiculturelles. Autre phénomène qu’il ne faut pas négliger : auparavant dans les pays occidentaux, les classes populaires étaient intégrées, même si de façon subordonnée, à un système qui réussissait sur le plan économique et politique parce qu’il était au centre du monde et d’une certaine façon le dominait. On avait des colonies ou des post-colonies permettant d’écouler nos produits et, culturellement, on pouvait se sentir au-dessus du panier. Aujourd’hui, ces pays se sont provincialisés dans l’ordre mondial. D’où une profonde crise d’identité, des classes populaires – blanches, masculines et peu diplômées en particulier. C‘est ce que traduisent l’élection de Trump, le succès du Brexit ou la capacité du Front national à parler à un public populaire en France.
Propos recueillis par Isabelle Bourboulon.