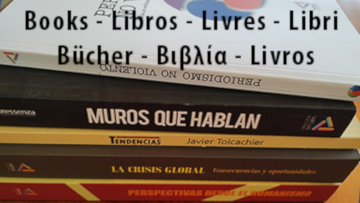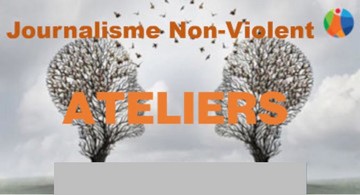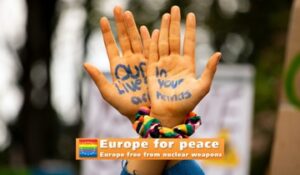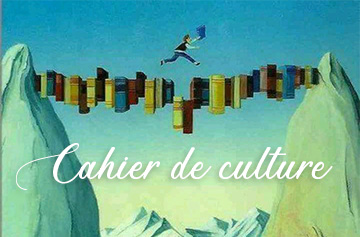L’investiture du milliardaire conservateur Donald Trump à la présidence des États-Unis d’Amérique, l’un des pays les plus en vue de l’orbite occidentale héritier et protagoniste de violents colonialismes, indique que nous assistons au point culminant de la vague réactionnaire qui avait déjà été annoncée.
Le grand nombre de décrets signés par le président récidiviste vise à dissimuler sous une attitude affairiste diligente et opérationnelle, qui caractérise le monde des affaires, qu’il s’agit d’une réaction déguisée en offensive.
Ce rebond montre la résistance de différents secteurs sociaux aux changements rapides survenus au cours des dernières décennies. Changements technologiques, changements dans les modes de production et de consommation, mais aussi progrès dans l’émancipation, et une plus grande représentativité de secteurs négligés et relégués historiquement, tels que celui des femmes, des communautés indigènes et afro-descendantes, ou des diverses identités affectives, entre autres.
L’accroissement de la mobilité humaine a enrichi le paysage monochrome des sociétés d’abondance, mais a également augmenté le niveau de discrimination. L’appel à une décolonisation effective visant à égaliser les chances et à transformer les institutions internationales se fait entendre haut et fort. La dictature culturelle et géopolitique imposée par l’Occident vacille aujourd’hui sous les assauts sérieux des peuples du Sud et de l’Est du monde.
C’est une période de reconfiguration totale des relations personnelles et sociales un tremblement de terre général des fondations qui crée instabilité et incertitude. À cela s’ajoute une nouvelle génération qui ne trouve ni place ni issue, réduisant son champ d’action à la consommation et à la servitude technicisée, aux addictions ou à la pandémie de santé mentale en cours.
La virulence du discours de haine, multipliée par les plateformes numériques qui atteignent l’intimité de chaque individu, touche profondément le ressentiment produit par le manque d’opportunités et l’étranglement de la liberté réelle. Une liberté qui est non seulement manipulée conceptuellement par la stratégie hégémonique pour combattre toute tentative de libération populaire, mais aussi pour installer une fausse croyance dans l’entrepreneuriat individualiste de la misère. Le rejet de la construction collective, de l’alliance coopérative des intentions, se traduit ainsi par un nouvel affaiblissement du tissu social et la possibilité de résistance et d’action créative et transformatrice des groupes humains.
Vestiges d’un vêtement inutile
Avec une grande insensibilité aux effets de la dialectique générationnelle, les générations précédentes tentent de donner une continuité à des modèles usés et s’obstinent, encore et encore, à combler les énormes lacunes du système par des solutions partielles et conjoncturelles.
C’est ainsi qu’apparaissent les réformismes qui visent à modérer les abus flagrants mais qui ne changent pas l’essence même de l’exploitation ni de la discrimination mais détournent souvent l’attention des conflits centraux. Des réformismes qui se transforment en conformismes, partant du principe que l’équilibre actuel des pouvoirs ne permet pas de résoudre les problèmes à la racine.
Des réformismes qui peuvent contenir des germes révolutionnaires de grand intérêt, comme l’exemple actuel de la Quatrième Transformation au Mexique, le slogan de la Paix Totale en Colombie, les efforts persistants du gouvernement dirigé par Xiomara Castro au Honduras, ou l’idée communautariste renouvelée de la révolution bolivarienne, qui, au contraire, peuvent ne représenter qu’un intervalle d’ajournement, comme ceux qui se manifestent dans les administrations aux orientations sociales-démocrates.
Au cours de l’ incessante évolution politique et sociale, les réformismes sont alors confrontés au dilemme de la mutation vers la révolution ou l’involution des structures. Tout comme les esprits révolutionnaires précédents doivent, en s’affirmant dans le même esprit, faire évoluer leurs révolutions en promouvant des changements, qui tiennent compte des temps nouveaux et de l’accroissement qualitatif des aspirations humaines, qu’ils ont eux-mêmes contribué à mobiliser et à réaliser.
De nouveaux horizons apparaissent également dans d’autres régions du monde comme dans la rébellion des nations du Sahel, qui ont décidé de briser le joug de la dépendance et de la domination française, mais aussi avec la mobilisation populaire au Sri Lanka, qui a culminé avec la victoire électorale du leader de gauche Anura Kumara Dissanayake, brisant la gestion corrompue des frères Rajapaksa qui a plongé le pays dans la pauvreté et l’endettement.
Un vent de renouveau se fait également sentir au Sénégal avec l’investiture du populaire Ousmane Sonko au poste de premier ministre, après avoir subi une persécution féroce de la part du gouvernement précédent.
L’histoire ne s’arrête jamais
L’avenir n’est pas écrit, mais une chose est sûre. L’être humain, dans sa quête pour se libérer des conditions d’oppression et de souffrance, ne cesse de chercher des moyens d’échapper aux inconvénients auxquels il est confronté. C’est ce qui fait avancer l’histoire, le besoin de surmonter la douleur et la souffrance.
Actuellement, la crise terminale du système doit servir à poser le regard sur le soutien au développement des nouvelles utopies qui sont déjà à l’œuvre. Des utopies à caractère collectif, et qui ont pour objectif non seulement le bien-être matériel, mais aussi le progrès existentiel pour tous, la compréhension et la coopération entre les cultures, et la liberté effective pour chaque personne de décider de son propre destin.
C’est ainsi que l’histoire jugera notre action : sur la capacité à affronter de manière créative l’inéluctable déclin capitaliste, et à s’orienter résolument vers des horizons humanistes.
Traduction de l’espagnol, Ginette Baudelet