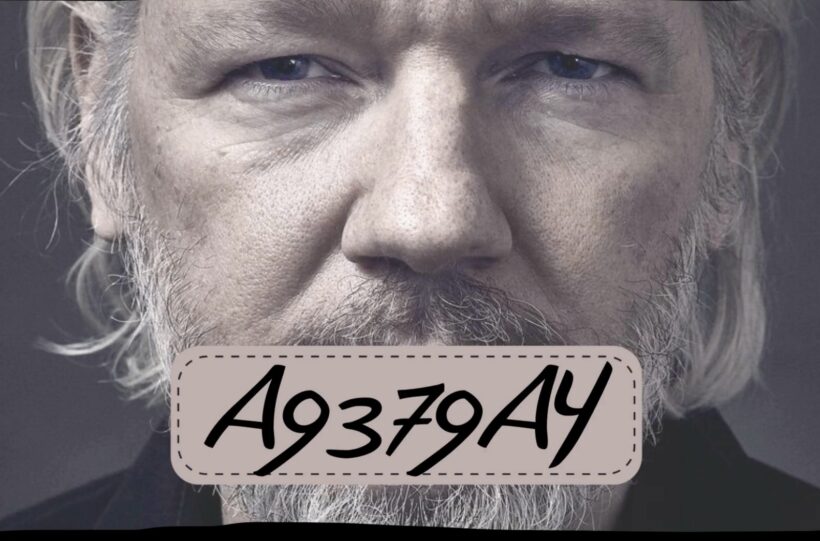Le cofondateur du site web Wikileaks craint que sa propre détention, la persécution par le gouvernement américain et le blocage du financement du site n’aient en fait effrayé les dénonciateurs potentiels.
À Belmarsh, la prison de Sa Majesté, il est 14h30 le mercredi 13 décembre lorsque Julian Assange entre dans la zone réservée aux visiteurs. Dans le groupe de 23 détenus, Julian se distingue par sa taille – 188 centimètres -, ses longs cheveux blancs et sa barbe taillée. Il plisse les yeux, cherchant un visage familier dans la foule des épouses, des sœurs, des fils et des pères des autres détenus.
Je l’attends, comme on m’a dit, dans la zone D-3 du hall, qui ressemble à un terrain de basket. C’est l’une des environ 40 zones, toutes constituées d’une petite table entourée de trois chaises rembourrées, deux bleues et une rouge, vissées au sol.
Nous nous entrevoyons, nous nous approchons et nous nous embrassons. C’est la première fois en six ans que je le vois en face de moi. Je lui dis : « Tu es pâle ». Avec ce sourire malicieux que j’ai vu lors de tant de rencontres dans le passé, Julian me dit en plaisantant : « Oui. On appelle ça la pâleur des prisonniers ».
Il n’a pratiquement pas été à l’air libre depuis qu’il s’est réfugié dans la petite ambassade équatorienne à Londres en juin 2012 – à l’exception de cette minute pendant laquelle la police l’a traîné dans un fourgon pénitentiaire.
Avant 2019, les fenêtres à la française de l’ambassade laissaient au moins entrevoir le ciel. Au lieu de cela, dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, où il vit depuis le 11 avril 2019, Julian ne voit jamais le soleil. Les gardiens le maintiennent confiné dans une cellule 23 heures par jour. Sa seule « heure de récréation » se déroule entre quatre murs, sous bonne garde. On peut donc comprendre la raison de cette pâleur mortelle.
J’étais arrivée en train puis en bus une heure et demie avant le rendez-vous, pour les formalités d’enregistrement et les contrôles de sécurité.
Tout commence au centre des visiteurs, un bâtiment situé au rez-de-chaussée à gauche de la prison. Il s’agit d’une pièce désolée des années 1950, comme celles dépeintes par Edward Hopper : des tables bon marché, des chaises branlantes, des lumières faibles et des rangées de casiers en verre.
Une femme souriante, qui semblait avoir au moins autant d’années que mes 72 ans, m’a dit que j’étais en avance et m’a suggéré de prendre un café. Je l’ai commandé à un petit homme qui présidait un coin cuisine rudimentaire : il s’est contenté de verser de l’eau bouillante dans une tasse où il avait mis du café instantané.
Vingt minutes plus tard, à une heure et quart, la porte d’un bureau adjacent s’est ouverte pour permettre aux visiteurs de faire la queue pour obtenir des laissez-passer.
Lorsque mon tour est arrivé, j’ai donné mon nom à l’une des trois femmes en uniforme derrière un comptoir surélevé. Elle a consulté son ordinateur, puis m’a demandé : « Êtes-vous ici pour M. Assange ? ». Elle s’est montrée polie, presque amicale, en enregistrant les empreintes de mon index et en me demandant de regarder une caméra aérienne qui me photographiait.
J’ai montré les trois livres reliés que je voulais offrir à Julian: mon « Soldiers Don’t Go Mad » [NdT: Charles Glass est l’auteur de ce livre], le nouveau roman de Sebastian Faulks, « Seventh Son », et « Pegasus : The Story of the World’s Most Dangerous Spy Software », de Laurent Richard et Sandrine Rigaud. La gentille dame m’a ordonné de les remettre à la femme trapue assise à sa droite. Elle examine mon livre, qui raconte l’histoire d’un hôpital psychiatrique pour officiers en état de choc pendant la Première Guerre mondiale. Puis, regardant la page de titre, où j’avais apposé ma signature pour Assange, elle a décrété : « Il est interdit de le remettre ». « Mais pourquoi ? », ai-je demandé, posant la question qu’il ne faut jamais poser dans une prison. « Parce qu’on ne peut rien écrire sur un livre destiné aux prisonniers ». J’ai répondu que j’avais simplement mis ma signature sur un livre, qu’il ne s’agissait pas d’un code secret. Rien à faire. C’était la règle. Elle m’a ordonné d’attendre dans la salle à manger pendant qu’elle vérifiait s’il était permis de donner les deux autres livres.
Buvant mon Nescafé tiède, je lis les journaux. D’autres personnes sont arrivées, principalement des femmes qui ont rejoint la file d’attente. Certaines étaient accompagnées d’enfants en bas âge ou de bébés.
L’une d’elles était accompagnée de son fils, un garçon souriant d’environ 12 ans. Une autre ressemblait à Diana Dors, la vamp du cinéma britannique, dont les formes voluptueuses et le rouge à lèvres rouge cerise auraient donné à n’importe quel détenu l’envie de goûter aux plaisirs de l’intimité. Il y avait aussi une femme âgée qui semblait venir d’Asie du Sud et qui boitait en s’appuyant sur une canne. Une autre encore avait les cheveux couverts par un hijab. Il y avait aussi quelques hommes, pour la plupart âgés, qui rendaient peut-être visite à leurs fils. La plupart d’entre eux donnaient l’impression d’être déjà venus ici.
Au bureau d’enregistrement, la femme trapue m’a dit qu’Assange ne pouvait recevoir aucun livre. La raison ? Il devait retirer les livres en trop de sa cellule avant d’en ajouter de nouveaux. Je demande à nouveau : « Pourquoi ? ». Le visage impassible, elle répond : « Risque d’incendie ». Une phrase du “Maître et Marguerite » de Mikhaïl Boulgakov me vient à l’esprit, mais je n’ose pas la dire : « Les manuscrits ne brûlent pas ».
J’ai déposé les livres et tout ce que j’avais dans un casier : téléphone, stylo, carnet, journaux. J’ai gardé 25 livres sterling en liquide dans ma poche – la limite autorisée – pour acheter des collations à l’intérieur de la prison. La gentille femme m’a donné un laissez-passer en papier et une étiquette à porter autour du cou : « H[is]. M[ajesty’s]. Prison Belmarsh – Visiteur social 2199 ». Avec mon groupe, j’ai traversé la cour jusqu’à l’entrée des visiteurs, juste à l’intérieur de la prison. Ensuite, une autre série de contrôles et de fouilles, la vérification des empreintes digitales, l’examen aux rayons X et l’inspection par un magnifique golden retriever capable de renifler les drogues. Enfin, nous sommes entrés dans la salle pour attendre les détenus.
Julian et moi sommes assis, face à face, moi sur la chaise rouge, lui sur l’une des bleues. Au-dessus de nous, des globes de verre cachent les caméras qui enregistrent les interactions entre les détenus et leurs invités.
Ne sachant pas comment entamer la conversation, je lui demande s’il veut quelque chose au bar. Il demande deux chocolats chauds, un sandwich au fromage et aux cornichons et une barre Snickers. Je l’invite à m’accompagner pour faire son choix. Il me répond que ce n’est pas autorisé. Je pars seul faire la queue au stand tenu par les bénévoles des Samaritains de Bexley et de Dartford. Lorsque mon tour arrive, je passe ma commande. Les sandwichs sont terminés, me dit le petit homme, mais le reste est de la nourriture malsaine : chips, barres chocolatées, colas, muffins sucrés. Je retourne auprès de Julian, qui a changé de place. Les chaises rouges sont pour les prisonniers, les bleues pour les visiteurs, et un gardien lui a ordonné de prendre le bon siège. Je pose sur la table le plateau avec les chocolats chauds, les Snickers, quelques muffins et mon café instantané.
Je lui demande pourquoi il n’y a que de la nourriture malsaine. Il sourit et me dit que je devrais voir ce qu’ils mangent là-dedans avec un budget de 2,30 euros par détenu et par jour. Par jour ? Oui : un porridge [bouillie] pour le petit-déjeuner, une soupe légère pour le déjeuner et pas grand-chose d’autre pour le dîner. [Voir la « Lettre au roi Charles » de Julian, dans laquelle il décrit les horreurs de Belmarsh, dans cette magnifique vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nOgN6-nr5uc ].
Julian avait pensé qu’être en prison signifiait des repas en commun sur de longues tables, comme dans les films. Mais en pratique, les gardiens de Belmarsh introduisent la nourriture dans les cellules et laissent les détenus manger seuls.
Il est difficile dans ces conditions de se lier d’amitié avec les autres. Julian Assange est là depuis plus longtemps que n’importe quel autre prisonnier, à l’exception d’un vieil homme qui a purgé sept ans contre quatre ans et demi pour Julian. Il me dit qu’il y a parfois des suicides, dont un la nuit précédente.
Puis je m’excuse de ne pas pouvoir lui donner de livres, expliquant qu’on m’a dit qu’il dépassait la limite. Il sourit à nouveau. Au cours des premiers mois, ils lui ont permis une douzaine de livres. Plus tard, jusqu’à 15. Il a insisté pour en avoir plus. « Combien en as-tu maintenant ? Deux cent trente-deux », dit-il d’un air malicieux. C’est à mon tour de sourire.
Je lui demande s’il a encore la petite radio qu’il avait eu du mal à obtenir la première année. Il l’a, mais elle ne fonctionne plus à cause d’une prise défectueuse. Le règlement permet à chaque prisonnier d’avoir une petite radio achetée dans les magasins de la prison, mais les autorités avaient prétendu qu’il n’y avait plus d’équipement radio disponible pour lui. Lorsque j’avais appris cela, je lui avais envoyé une petite radio. Elle m’avait été renvoyée. Je lui avais ensuite envoyé un livre sur la fabrication d’une radio. Il m’avait également été retourné. Après plusieurs mois j’avais contacté l’un des anciens otages britanniques les plus connus du Hezbollah pour lui demander conseil. En effet, le fait d’écouter la BBC World Service sur la petite radio que ses geôliers lui avaient donnée lui avait permis de ne pas devenir fou. Puis, à ma demande, Julian avait écrit au directeur de la prison pour lui dire que ce serait une mauvaise publicité pour la prison si l’on apprenait que Belmarsh refusait à Assange un privilège que le Hezbollah accordait à ses otages. La prison avait donné sa radio à Julian.
« Tu veux que je t’aide à convaincre les autorités de réparer ou de remplacer la prise cassée ? “Non merci”, a-t-il répondu, « Cela ne me causerait que des ennuis inutiles. »
Mais comment fait-il pour se tenir complètement au courant, lui qui est si passionné par l’actualité mondiale ? Réponse : la prison lui permet de lire les revues de presse ; de plus, des amis lui écrivent. Avec l’invasion de l’Ukraine et de Gaza, dis-je, les occasions ne devraient pas manquer pour les lanceurs d’alerte du monde entier d’envoyer des documents à WikiLeaks, non ? Julian regrette que WikiLeaks ne soit plus en mesure de dénoncer les crimes de guerre et la corruption comme par le passé. Son emprisonnement, les persécutions dues au gouvernement américain et les restrictions imposées au financement de WikiLeaks n’ont fait qu’éloigner les dénonciateurs potentiels. Il craint que d’autres médias ne soient pas en mesure de combler le vide.
Belmarsh ne leur propose pas de programmes éducatifs ni d’activités sociales, telles que jouer dans un orchestre, faire du sport ou participer à la rédaction d’un journal de prison, activités normales dans beaucoup d’autres prisons. Le régime est punitif, même si les quelque 700 habitants de Belmarsh ne sont là qu’en détention provisoire, c’est-à-dire dans l’attente d’un procès ou d’un appel. Mais il s’agit de prisonniers de catégorie A, ceux qui « représentent la menace la plus grave pour le public, la police ou la sécurité nationale » : des personnes accusées de terrorisme, de meurtre ou de violence sexuelle.
Nous parlons de Noël, qui est un jour comme les autres à Belmarsh : pas de dinde, pas de chants de Noël, pas de cadeaux. La prison est fermée aux visiteurs le jour de Noël et le lendemain ; en fait, la prison a informé sa femme, Stella Moris, qu’elle et leurs deux jeunes fils, Gabriel et Max, ne peuvent pas voir Julian la veille de Noël. En revanche, il pourra assister à la messe catholique célébrée par l’aumônier polonais, qui est devenu un ami.
Les visites touchent à leur fin. Nous nous levons et nous nous embrassons. Je le regarde, incapable de lui dire au revoir. Nous nous embrassons à nouveau, sans voix.
Les visiteurs se dirigent vers la sortie, tandis que les prisonniers restent assis. Je suis libre de partir, mais lui doit retourner dans sa cellule. Hormis les visites occasionnelles, ses journées se ressemblent toutes : l’espace confiné, la solitude, les livres, les souvenirs, l’espoir que l’appel de ses avocats contre l’extradition et l’emprisonnement à vie aux États-Unis sera couronné de succès.
Alors que je franchis les portes automatiques menant au monde extérieur, je me souviens des derniers mots de « Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch » d’Alexandre Soljenitsyne, traduits par mon regretté ami et agent littéraire Gillon Aitken : « Sa peine était de trois mille six cent cinquante-trois jours, du matin de chaque jour jusqu’à l’extinction des feux. Les trois jours supplémentaires étaient dus aux années bissextiles ».
Notes
Les lecteurs souhaitant écrire à Julian Assange peuvent le faire en adressant leur courrier à M. Julian Assange, Prisoner #A9379AY, HMP Belmarsh, Western Way, London SE28, United Kingdom. [Des instructions sur la forme que doit prendre la lettre sont disponibles sur ce site https://writejulian.com/ . Les dons au fonds de défense peuvent être envoyés à https://www.gofundme.com/f/julian-assange-amp-wikileaks-public-defense-fund/donate
Par Charles Glass
Traduction d’Evelyn Tischer.