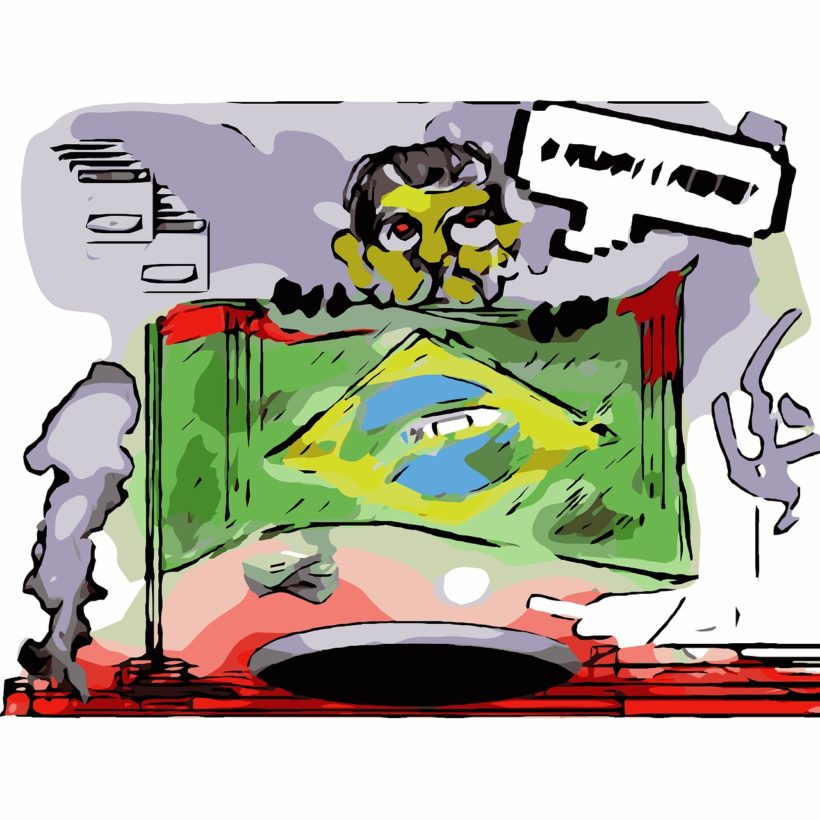Par la Professeure Erica Almeida¹
Au Brésil, les intérêts des grands propriétaires terriens ont déterminé les priorités de l’État pendant de nombreux siècles. Entre autres, le maintien de l’esclavage jusqu’à la fin du 19ème siècle, l’absence de droits du travail dans les campagnes presque tout au long du 20ème siècle et, plus récemment, toute une série de violations des droits du travail et des droits sociaux et l’augmentation de conditions de travail proches de l’esclavage dans les campagnes et les villes. Et ce, sans tenir compte du caractère informel de plus de 70% des emplois domestiques.
Depuis 2013, la coordination entre les oligarchies agraires, les banquiers et une grande partie du secteur des affaires a non seulement apporté un soutien politique au processus de destitution de Dilma Rousseff, mais aussi aux réformes du travail et de la sécurité sociale qui pénalisent ceux qui vivent de leur travail, notamment les plus pauvres. Comme si les attaques contre les droits des travailleurs, qui sont remisés au banc de « marchandises » complètement dévaluées, ne suffisaient pas, la politique ultralibérale des gouvernements successifs continue de gagner du terrain grâce à de grands investissements économiques sur les territoires indigènes et quilombos, sur les terres paysannes, sur les mers et les rivières des petits pêcheurs. Cela met en danger la reproduction sociale de ces communautés traditionnelles, et l’environnement à l’échelle locale, nationale et mondiale, et avec elle la survie de l’humanité.
Considéré comme une dimension structurelle de l’expérience imposée par le colonialisme européen, l’esclavage a fonctionné comme un élément de classification et de hiérarchie entre ceux qui avaient de l’humanité et ceux qui n’en avaient pas, soutenu par l’idéologie de la suprématie blanche et du racisme. La fin de la terreur de l’esclavage n’a pas mis fin à la violence institutionnelle contre les Noirs. La violence et le racisme ancrés dans les institutions de l’État républicain ont façonné leur mode de fonctionnement, notamment à l’encontre des populations pauvres et noires. Ces pratiques sociales n’avaient d’autre objectif que de mettre de côté les Noirs et de les réduire au silence. Et, avec eux, toute leur culture, leur tradition, leurs faits et gestes, leurs connaissances, leurs croyances et leurs religiosités – en fait, tous les droits dont disposent les Européens blancs depuis le 18ème siècle.
Sans aucun soutien de la part des politiques publiques pour s’intégrer économiquement et socialement, ces nouveaux « citoyens » ont été obligés de « se débrouiller » dans un monde hostile et raciste et d’accepter les pires emplois et les plus bas salaires, vivant dans des logements insalubres et subissant continuellement la stigmatisation, les violences policières et l’emprisonnement. A partir des années 1950, l’expulsion des travailleurs des campagnes a créé les boias-frias, ces travailleurs ruraux précaires et appauvris qui vivent aujourd’hui à la périphérie des villes. Une fois de plus, sans soutien des politiques publiques, ces travailleurs ont dû s’occuper de se trouver un logement, généralement construit de leurs mains, et de la « subsistance » de leurs enfants.
Les villes reproduisent les inégalités de classe au quotidien : au racisme structurel s’ajoutent des espaces urbains racialisés, des périphéries totalement privées de droits à des infrastructures urbaines et à un ensemble de biens et services collectifs matériels et immatériels. Marquée par une ségrégation socio-spatiale et raciale, la ville de Campos dos Goytacazes, dans l’État de Rio de Janeiro, au Brésil, ancien territoire des Indiens Goytacazes, s’est développée tout en maintenant un ensemble d’inégalités dans l’accès à la terre, aux revenus et aux droits sociaux, politiques et culturels. Ce quotidien de « privations » qui caractérise souvent les périphéries continue de façonner le paysage de la ville, creusant toujours plus le fossé social et racial et pénalisant des milliers de familles de travailleurs qui continuent de vivre en marge d’un emploi décent.
30 ans après l’entrée en vigueur de la Constitution Citoyenne qui a intégré un ensemble de droits dans le texte constitutionnel, les pratiques sociales et notamment les actions institutionnelles, vont dans le sens inverse de la Constitution Fédérale (CF) de 1988, surtout dans les lieux socialement stigmatisés. Les quartiers des travailleurs pauvres et des Noirs sont perçus comme appartenant à des « délinquants ». Ils ont été transformés en zones pour « personnes dangereuses », ce qui justifie non seulement l’absence de bon nombre d’institutions et d’actions liées à la protection sociale et à la garantie des droits constitutionnels, mais aussi la présence visible et violente d’autres institutions et actions gouvernementales.
Cette incapacité de l’État, au travers de ses institutions, de protéger tout le monde, quelle que soit la classe, la race et/ou l’ethnie et le genre, n’est pas un problème de budget ou de ressources humaines, bien que ces problèmes soient présents dans tous les domaines de l’État. C’est le résultat d’un manque de reconnaissance institutionnelle du statut de citoyen des travailleurs pauvres brésiliens. Ce problème est encore plus grand lorsque l’humanité est refusée aux hommes et aux femmes noirs, en particulier aux jeunes, qui sont considérés comme indignes de vivre. Cette posture ne se limite pas aux institutions de l’État, elle a gagné en légitimité dans la société civile également, soutenue par ceux qui ont participé activement au coup d’État de 2016 et au processus de destruction des droits du travail, et qui continuent d’agir contre l’emploi, la santé, l’éducation et l’assistance sociale (des politiques publiques nécessaires à la grande majorité de la population) et contre l’environnement, notre plus grand patrimoine collectif. Les actions des deux derniers (mauvais) gouvernements en termes de privatisations, de suppression des politiques publiques, d’attaques contre les institutions libérales et la Constitution de 1988, l’utilisation excessive de la violence institutionnelle pour faire face aux mouvements sociaux et la militarisation de la sécurité publique, résument un mode opératoire continu dans la résolution des conflits sociaux et leur « pacification », générant un climat de peur et d’insécurité et imposant un grand nombre de défis aux luttes pour les droits.
Pour conclure, il ne s’agit pas de se demander si les institutions fonctionnent, mais de remettre en question les pratiques institutionnelles, ainsi que leurs relations et articulations avec des intérêts privés et corporatifs, parfois inavouables. Cela nous permet de penser que l’omission d’une défense intransigeante des droits universels et de la démocratie participative (qui va au-delà des élections tous les quatre ans) peut signifier non seulement l’absence de républicanisme dans nos défuntes institutions « républicaines », mais aussi la subordination d’une grande partie d’entre elles aux intérêts et aux projets des nouveaux « propriétaires du pouvoir » et de leur rationalité. Une rationalité commerciale qui se répand de plus en plus dans les institutions « publiques » ou celles qui conservent encore cet adjectif, et qui transforme les travailleurs en entrepreneurs et en citoyens, en consommateurs et en concurrents. La possibilité d’un avenir en danger apparaît dans les actions des mouvements sociaux qui résistent à cette destruction généralisée des intérêts communs et de l’agenda des droits collectifs. En résistant, on accumule les expériences de partage et de construction de nouvelles significations et de nouvelles sociabilités, plus collectives et solidaires. C’est sur elles que nous devons parier !
¹ Assistante sociale, professeur du cours de Service Social et du Programme de Troisième Cycle en Développement, Environnement et Politiques Publiques (PPGDAP, acronyme en portugais) à l’Université Fédérale Fluminense (UFF), dans la ville de Campos dos Goytacazes, État de Rio de Janeiro, Brésil.
Traduction de l’espagnol, Frédérique Drouet