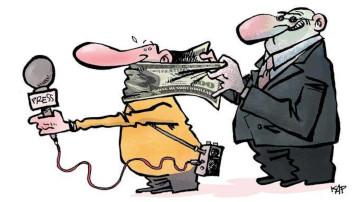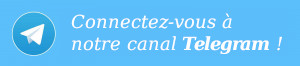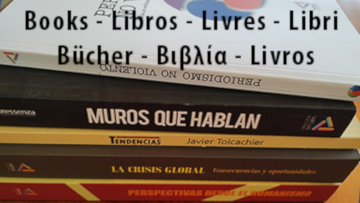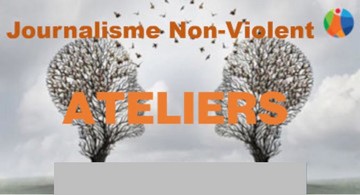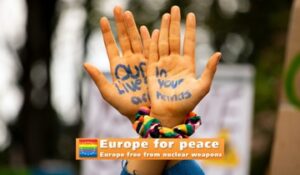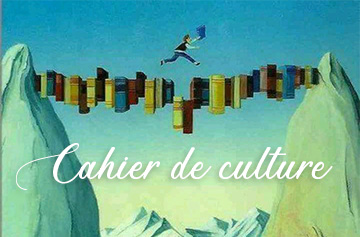Après l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, les pays de l’OTAN ont annoncé qu’ils allaient à nouveau investir plusieurs milliards dans l’armement et transférer des troupes et des systèmes d’armes en Europe de l’Est. Mais que se passera-t-il si la dissuasion échoue ? Une guerre – probablement nucléaire – en Europe ? Et jusqu’à quel point la défense sera-t-elle légitime ? Car à un moment donné, il n’y a plus rien à défendre, il ne s’agit plus que de « descendre ensemble dans l’abîme », pour reprendre l’expression si parlante du psychosociologue Friedrich Glasl, désignant le niveau ultime de l’escalade des conflits. Sommes-nous vraiment revenus au slogan « Plutôt mourir que de perdre la liberté » ?
Par Christine Schweitzer (*)
Après la Seconde Guerre mondiale, ces questions sur la pertinence de la défense militaire ont conduit des chercheurs sur la paix – et des militaires comme le Britannique Stephen King-Hall – à réfléchir à des alternatives. Leur réponse peut sembler utopique, mais elle s’inspire des succès de résistances civiles non-violentes de nombreux pays.
Le terme technique : la défense sociétale (Soziale Verteidigung[1]) ; le principe : non pas une défense des frontières et du territoire par les armes, mais une défense du mode de vie et des institutions par la résistance civile. Sous la plume de King-Hall : « J’estime qu’un pays occupé par l’ennemi est préférable à un pays en ruines. Si nous sommes confrontés à cette alternative, je pense qu’il est plus sage, plus courageux et plus démocratique de choisir l’occupation, même si c’est avec le cœur lourd. Je ne veux pas empêcher ceux qui en décident autrement et qui préfèrent être réduits à une poignée de cendres radioactives de se suicider. Mais rien ne les autorise à faire pression pour une législation ou des décisions politiques qui pourraient conduire à un suicide collectif de toute la nation[2]. »
Outre King-Hall, de jeunes chercheurs de Grande-Bretagne (comme Adam Roberts et April Carter), des États-Unis (Gene Sharp) ou des pays scandinaves (comme Johan Galtung) ont contribué à faire émerger le concept de défense sociétale[3]. À ce cercle s’est joint assez tôt le politologue allemand Theodor Ebert, qui rédigea sa thèse sur l’action non-violente et participa à une initiative visant à créer une « armée de la paix » sur le modèle gandhien. Il œuvra pendant plusieurs décennies au sein du mouvement pacifiste et de l’Église protestante, et milita pour que le gouvernement fédéral mette en œuvre la défense sociétale.
Exemples de défense sociétale en Allemagne
Deux des exemples « classiques » de défense sociétale proviennent justement d’Allemagne, pourtant peu réputée pour sa défiance envers les autorités : En 1920, l’échec du putsch de Kapp contre la jeune République de Weimar, grâce à une grève générale, efficace en quelques jours. En 1923, la lutte contre l’occupation belgo-française de la Ruhr (la France et la Belgique souhaitant récupérer les réparations pour les destructions de la Première Guerre mondiale), avec à nouveau l’action décisive des syndicats, cette fois avec le soutien du gouvernement du Reich ; cette action, interrompue après quelques mois, a cependant pesé sur les négociations internationales aboutissant à un aménagement des versements[4].
L’apogée des années 1980 : le mouvement pour la paix, puis le déclin
Dans les années 1980, à l’époque du grand mouvement pacifiste contre le « réarmement » par des missiles à moyenne portée, la défense sociétale a suscité un vif intérêt – au-delà des concepts militaires alternatifs – en tant que concept de défense devant accompagner un désarmement massif. Les objecteurs de conscience l’ont exposée aux commissions chargées de statuer sur leur refus de servir dans l’armée. Des initiatives pacifistes se sont penchées sur le concept et l’ont popularisé. Et en Suisse (et peu après en Allemagne) on a envisagé d’abolir l’armée, avec un référendum populaire en 1989 rassemblant près de 36 % des votes pour une Suisse sans armée !
Dans le même temps, de nouvelles études parurent, notamment en 1989 celle de l’historien Jacques Sémelin sur la résistance civile pendant la Seconde Guerre mondiale, montrant que la résistance non-violente était possible même contre les forces d’occupation les plus inhumaines comme les nazis. C’est un argument important dans le débat sur la défense sociétale, car on objecte souvent que, contre des régimes inhumains, la résistance civile est inutile.
Au XXe siècle, le point culminant en Allemagne fut un congrès intitulé « Les chemins de la défense sociétale », qui a réuni plus de mille personnes à Minden en 1988. À l’issue de cette conférence fut fondée le « Bund für Soziale Verteidigung » (BSV – Association pour la défense sociétale), qui existe encore aujourd’hui.
Après le « tournant » de 1989 – l’effondrement du Pacte de Varsovie et de l’Union soviétique et la réunification des deux Allemagnes – la défense sociétale s’est faite discrète. Les forces militaires de l’OTAN se sont exclusivement tournées vers des opérations dans les pays du Sud. Les tristes moments marquants ont été les agressions contre l’Afghanistan et l’Irak. De nombreux chercheurs qui s’étaient auparavant penchés sur la défense sociétale, se sont tournés vers d’autres thèmes, en particulier les soulèvements non-violents contre les dictatures. Enfin, une jeune génération de chercheurs a vu le jour ; ils n’utilisent plus le terme de défense sociétale : ils le rejettent en raison de sa connotation critique envers l’armée, ou peut-être ne le connaissent-ils pas. Cependant, au cours de ces vingt dernières années, un riche corpus de travaux sur la résistance civile a vu le jour, qui doit encore être mis en relation avec le concept de défense sociétale, et pourrait ainsi contribuer considérablement à son adaptation au XXIe siècle.
Ce n’est que depuis 2014 environ que le thème de la défense non-violente est revenu sur le devant de la scène, reflétant les tendances politiques de renouveau du conflit Est-Ouest et de la défense du territoire ; peut-être une nouvelle phase du concept de défense sociétale.
Campagne « Défendre sans armes »
Avec le conflit qui touche l’Ukraine depuis 2014, l’intérêt pour ce concept a été ravivé en Allemagne, avec deux conférences du BSV en 2018 et 2023, et une conférence internationale (en ligne) en septembre 2024.
En été 2022, des sympathisants du BSV ont lancé la campagne « Se défendre sans armes », pour informer sur la défense sociétale, faire pression et la préparer concrètement dans trois « régions modèles ». Car une défense intégrale et humaine doit être préparée et mise en œuvre sur le terrain ; elle ne peut pas être organisée « d’en haut ». Les trois régions modèles sont assez différentes dans leur orientation. Au Wendland (nord-ouest de l’Allemagne), région marquée par des décennies d’opposition au stockage des déchets nucléaires, il s’agit avant tout de résister à l’extrémisme de droite : se préparer à une éventuelle prise de pouvoir de l’AfD (Alternative für Deutschland) est vu par les militants comme une préparation à la défense sociétale contre d’autres menaces – militaires.
À Berlin, c’est une communauté qui s’active : paroisse protestante et association politico-culturelle de quartier, le « Campus de la réforme » (REFORMATIONS-Campus e.V) associe sa foi chrétienne à la transformation de la société ; son travail porte principalement sur la résilience dans différents domaines – le changement climatique, les droits humains et l’éradication de la violence ; un travail qui prend place dans le contexte de la défense sociétale. La troisième région modèle, le Haut-Rhin, présente peut-être un intérêt spécifique pour les français, par sa présence transfrontalière, avec des partenariats en France et en Suisse ; on y fait davantage de « relations publiques » au sens classique du terme – des manifestations, des conférences, des fêtes de la paix, au cours desquelles on informe sur la défense sociétale (voir : www.wehrhaftohnewaffen.de).
Un travail titanesque
En Allemagne, le mouvement pacifiste dans son ensemble, et pas seulement sa minorité engagée dans le concept radical de défense sociétale, est marginalisé. Les partis de gouvernement et les partis conservateurs d’opposition défendent unanimement un réarmement (y compris avec de nouvelles armes nucléaires et des armes à moyenne portée) et des livraisons d’armes à l’Ukraine et à Israël. À cela s’ajoute une préparation à la guerre de l’ensemble de la société, avec la réintroduction du service militaire obligatoire (suspendu en 2011), la propagande militaire dans les écoles et la préparation des infrastructures civiles (hôpitaux…) labellisées « aptes à la guerre ». Les voix dissonantes essuient des critiques massives ou malveillantes, les pacifistes sont taxés d’ « amis de la Russie » ou d’irresponsables partisans de l’éthique de conviction. La situation, différente de celle de la France, est aggravée par le fait que tous les partis suivent la ligne militariste, sauf deux partis populistes d’extrême droite qui, loin de défendre des positions non-violentes, se rangent plutôt du côté de la Russie et demandent la fin du soutien à l’Ukraine ; malheureusement, certains groupes se réclamant du mouvement pacifiste et au moins un de ces deux partis ont des idées et des partisans en commun.
Cet article se conclut quand même sur une note d’espoir : l’expérience des mouvements sociaux des cent dernières années nous enseigne que ceux-ci se meuvent comme des vagues. En 1978, personne n’aurait cru possible que deux ans plus tard, des millions de personnes descendraient dans la rue pour protester contre l’annonce du déploiement d’armes nucléaires à moyenne portée en Europe. Le travail sur des alternatives non-violentes à l’armement et à l’armée peut être comparé au labeur des paysans, qui doivent préparer le sol avant que le fruit puisse être semé et mûrir.
Traduit de l’allemand par Mayeul Kauffmann, président de l’IRNC[5].
Notes
[1] Aussi traduit par défense civile, défense civile non-violente (DCNV) ou défense sociale.
[2] King-Hall, Stephen (1958): Den Krieg im Frieden gewinnen. Traduit de Defence in the Nuclear Age, 1958.
[3] Sur ces débuts, cf. Bogdonoff , Philip (1982) Civilian-Based Defense: A Short History, www.bmartin.cc/pubs/19sd/refs/Bogdonoff1982.pdf
[4] Voir Müller, Barbara (1995): Passiver Widerstand im Ruhrkampf. Eine Fallstudie zur gewaltlosen zwischenstaatlichen Konfliktaustragung und ihren Erfolgsbedingungen.
[5] Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits (IRNC).
(*) L’Auteure
Christine Schweitzer est directrice du Bund für Soziale Verteidigung (soziale-verteidigung.de) et collaboratrice scientifique à l’Institut für Friedensarbeit und gewaltfreie Konfliktaustragung – Institut pour la paix et la résolution non-violente des conflits, ifgk.de.
Cet article fait partie du Dossier La Défense civile non-violente, numéro 213 (spécial), Décembre 2024, de la revue Alternatives non-violentes.