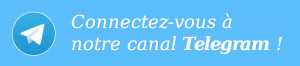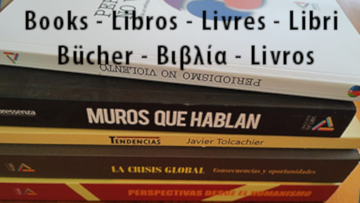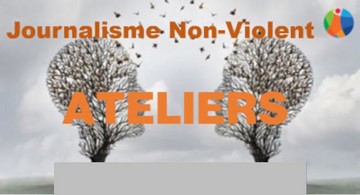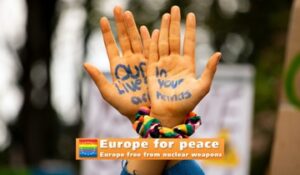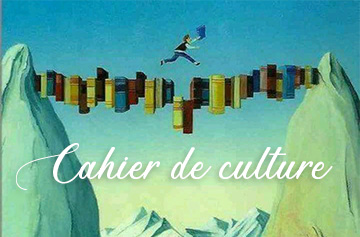Ann Wright est une militante pacifiste, une ancienne diplomate étasunienne et une colonelle de l’armée US à la retraite. En 2003, elle a démissionné du service diplomatique pour protester contre la guerre en Irak et s’est depuis engagée sans relâche en faveur de la paix, du désarmement et de la justice mondiale. Chaque fois qu’elle se trouve en Allemagne, elle prête sa voix et son cœur pour soutenir le mouvement pacifiste local, comme elle l’a encore fait hier lors de la manifestation nationale à Wiesbaden. Nous sommes très heureux de nous entretenir avec elle aujourd’hui.
Reto Thumiger : Chère Ann, merci beaucoup d’avoir pris le temps de nous accorder cet entretien. Nous sommes toujours heureux de vous accueillir en Allemagne – et reconnaissants de pouvoir compter sur votre solidarité et votre soutien.
Ann Wright : C’est un plaisir d’être ici. Cela fait quelques années que je ne suis pas venue en Allemagne, alors je suis contente d’être de retour.
Qu’est-ce qui vous a amenée en Allemagne cette fois-ci ?
J’ai été invitée à prendre la parole lors de la manifestation organisée à Wiesbaden au sujet des missiles US qu’il est prévu de déployer en Allemagne en 2026. La manifestation était dirigée contre cette décision, à laquelle je suis également très opposée. Je suis donc venu ajouter ma voix à celle des citoyens allemands qui disent : il s’agit d’une provocation de la part des États-Unis, et il faut y mettre un terme.
Comment avez-vous vécu l’ambiance et la participation à la manifestation pour la paix à Wiesbaden ce 1 avril ?
Oh, la manifestation était vraiment, vraiment bonne. Environ 4 000 à 5 000 personnes se sont rassemblées sur la place principale où les discours ont été prononcés. La manifestation a commencé à la gare de Wiesbaden – une foule enthousiaste malgré le froid. Plus tard, Reiner, Katrin et moi-même sommes allés à la rencontre d’un groupe de 50 cyclistes qui roulaient pour la paix. Nous les avons rencontrés, nous les avons remerciés pour leur effort, puis ils ont continué à rouler jusqu’à Wiesbaden.
Dans l’ensemble, l’énergie était excellente. Les gens étaient attentifs, ils appréciaient tous les orateurs, et je me suis sentie vraiment honorée de participer à cet événement.
Ça a dû être une grande source d’inspiration. La dernière fois que j’ai parlé avec vous, c’était à l’été 2018, lors de la campagne Stop Ramstein. Beaucoup de choses ont changé au cours des presque sept années qui se sont écoulées depuis. Comment résumeriez-vous ces évolutions ?
Eh bien, la situation actuelle est tellement différente de ce qu’elle était en 2018. À l’époque, Trump était président – et en 2019, il a retiré les États-Unis du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire FNI, l’accord sur les forces nucléaires à portée intermédiaire.
Après cela, la Russie a dit : « Si vous n’en faites pas partie, nous n’en ferons pas partie non plus ».
Au cours des sept dernières années, nous n’avons donc eu aucun accord de contrôle des armements sur les missiles nucléaires à portée intermédiaire. Rien.
Puis l’administration Biden est arrivée – et entre-temps, nous avons assisté à la guerre en Ukraine et en Russie, qui, selon moi, a été largement provoquée par les États-Unis et l’OTAN.
Et puis il y a le génocide israélien à Gaza, commencé avec la complicité de l’administration Biden. Biden, au lieu d’inverser cette voie, a profité de la situation – y compris la sortie de Trump des FNI – et dans ce qui semble avoir été une surprise pour le gouvernement allemand, a annoncé en juillet 2024 que les États-Unis déploieraient de nouveaux missiles en Allemagne. Et d’après ce que j’ai entendu, cela s’est fait sans consultation, vraiment, du gouvernement allemand. Cela change donc toute la dynamique des relations américano-européennes.
Et maintenant que Trump est revenu au pouvoir – même si cela ne fait que deux mois – le genre de déclarations que nous avons entendues de sa part et de celle de son secrétaire d’État, de ses envoyés spéciaux, de son secrétaire à la défense… elles sapent essentiellement la dépendance de l’Europe à l’égard des États-Unis et de l’OTAN en matière de défense.
J’ai toujours été critique à l’égard de l’OTAN – je pense qu’il y en a beaucoup trop. D’un certain point de vue, je pourrais donc dire que réduire la dépendance à l’égard de l’OTAN n’est peut-être pas une mauvaise chose.
Mais en même temps, en tant qu’ancien diplomate américain, je dirais : on ne coupe pas les liens avec ses principaux alliés comme ça. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin de ces relations.
L’approche de l’administration Trump – l’intimidation, l’arrogance, l’impolitesse pure et simple – est vraiment préoccupante pour beaucoup d’entre nous aux États-Unis. Et ce n’est pas seulement en Europe. Partout dans le monde – au Groenland, au Canada, au Panama – Trump ou des membres de son administration ont fait des déclarations insensées.
Dire des choses comme « Nous allons prendre le contrôle du canal de Panama », ou qualifier le Canada de 51e État… ce sont des remarques absurdes et dangereuses. Aucun dirigeant sérieux, aucun secrétaire d’État ou ministre des affaires étrangères ne devrait s’exprimer de la sorte.
La rhétorique de Trump est toujours pleine de contradictions. En 2018, vous avez suggéré que la population allemande devrait expulser l’armée US – parce qu’elle tue des gens et utilise les bases militaires ici pour le faire. Aujourd’hui, de nombreux politiciens allemands craignent que Trump n’envisage en fait de se retirer de l’OTAN et de l’Europe – et en réponse, ils appellent à un réarmement massif. Et néanmoins, les États-Unis veulent déplacer les missiles en Allemagne, etc. Ce n’est probablement pas ce que vous aviez à l’esprit, n’est-ce pas ?
Tout à fait. Cette évolution est très préoccupante, mais elle n’est pas obligatoire. Le fait est que nous devrions donner la priorité à la diplomatie, et non à l’ajout d’armes ou à la confrontation militaire. Et c’est ce qui a vraiment manqué dans toute cette affaire.
Les accords de Minsk I et de Minsk II – et maintenant que nous en savons plus sur la manière dont ils ont été traités – étaient censés être des efforts diplomatiques sérieux. Ils auraient dû servir à prévenir toute escalade militaire entre la Russie et l’Ukraine.
Ensuite, avec les Ukrainiens, les États-Unis et les pays européens impliqués, la situation n’aurait jamais dû en arriver au point où la Russie a estimé qu’elle devait envahir l’Ukraine. Pour être clair, je ne suis pas du tout d’accord avec la décision de la Russie de le faire. Mais en même temps, on peut voir comment les choses se sont détériorées, surtout quand il n’y a pas eu d’effort réel pour arrêter l’escalade. C’est presque comme si les États-Unis avaient poussé à la confrontation.
En fait, de hauts fonctionnaires étasuniens ont ouvertement déclaré que l’objectif était en partie d’affaiblir la Russie par une longue guerre, de la forcer à épuiser ses ressources militaires et économiques, d’imposer davantage de sanctions et, en fin de compte, de provoquer un changement de régime, ce qui est souvent l’objectif des États-Unis.
Tout d’abord, c’est une erreur. Deuxièmement, les États-Unis ne semblent jamais tirer les leçons de leurs échecs passés lorsqu’il s’agit de renverser des gouvernements et d’essayer d’installer des régimes qui servent leurs intérêts. Cela ne marche jamais. Et pourtant, nos hommes politiques semblent se dire : peut-être que cette fois-ci, ça marchera. Alors essayons encore.
Et que se passe-t-il alors ? Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers – même des millions de personnes – sont tuées ou blessées. Il est tout simplement incroyable qu’à notre époque, les gouvernements – en particulier le mien – continuent de choisir la voie militaire au lieu d’une véritable diplomatie.
Nombreux sont ceux qui se demandent ce qui ne va pas avec le rôle de l’Europe dans tout cela. Même aujourd’hui, alors que Trump pousse à la négociation avec la Russie – ce qui, personnellement, me laisse sceptique en termes d’intentions sincères pour la paix dans le monde – l’Europe semble toujours réticente à s’engager dans un dialogue ou à prendre des mesures en faveur de la paix en Ukraine. De votre point de vue, quelles mesures concrètes devraient être prises en vue d’une désescalade ?
Eh bien, une mesure concrète – et une mesure importante – serait que les États-Unis cessent d’envoyer de nouvelles armes. Je pense qu’ils ont indiqué à Zelensky qu’il fallait une sorte de négociation, un cessez-le-feu et une voie vers un accord de paix. Il faut donc vraiment que les États-Unis cessent d’alimenter cette guerre avec davantage d’armes et de soutien militaire.
Comme vous l’avez mentionné, les gouvernements européens ne sont pas tellement pressés de le faire, et il semble bien qu’ils veuillent poursuivre cette confrontation. Nous assistons aujourd’hui à une augmentation considérable des dépenses militaires dans presque tous les pays européens, en raison de la menace que la Russie est considérée poser.
Si vous ne voulez pas d’une menace de la part de la Russie, vous feriez mieux de commencer à lui parler. Il faut engager le dialogue – demander : quels sont exactement les problèmes que la Russie voit dans ce qui se passe en Europe ? Ensuite, vous pouvez exprimer ce que l’Europe considère comme un problème.
Oui, la décision du gouvernement russe d’envahir certaines parties de l’Ukraine est terrible. Cela n’aurait jamais dû se produire. Mais cela aurait également pu être évité si une diplomatie active et réelle avait été mise en place pour répondre aux préoccupations de la Fédération de Russie et à celles de l’Ukraine. Ce dont nous avons besoin, c’est de rouvrir les canaux diplomatiques et de créer des espaces où ce type de conversation peut avoir lieu.
Voyez-vous également des développements positifs ? Voyez-vous quelque chose d’encourageant ?
Eh bien… il est difficile, honnêtement, de voir des développements positifs en ce moment. Du point de vue des États-Unis, nous assistons à une répression majeure de la liberté d’expression. Des étudiants sont expulsés et des organisations comme celles dont je fais partie – Veterans for Peace, Code Pink, Women for Peace – sont vilipendées par le Congrès américain simplement parce qu’elles osent remettre en question les politiques américaines.
La semaine dernière, au Sénat, lors d’auditions télévisées nationales, deux sénateurs ont accusé Code Pink d’être financé par le parti communiste chinois, pour l’amour du ciel.
On se serait cru à l’époque de McCarthy. Je me suis fait arrêter parce que j’ai tenu tête au sénateur Tom Cotton et j’ai dit : « Nous ne sommes payés par personne – nous comptons sur de petits dons de particuliers ici aux États-Unis ».

Mais c’est le genre de représailles que nous voyons maintenant. Si l’administration Trump n’aime pas ce que vous dites, elle s’en prend à vous. Elle s’en prend aux institutions et aux personnes qui ont contesté l’affirmation de Trump selon laquelle il a gagné les dernières élections. Les gens ont vraiment peur – et les tribunaux n’agissent pas assez vite pour s’opposer à tout cela.
Donc… s’il y a un côté positif, c’est que toute cette répression est en fait en train de revigorer l’activisme citoyen. Les gens descendent à nouveau dans la rue. Ils font pression sur le Congrès. Ils sont très attentifs aux prochaines élections. La semaine dernière, nous avons vu des candidats républicains perdre dans des régions où ils étaient presque sûrs de gagner – parce que les citoyens se réveillent.
Alors oui, je pense que c’est ce qui est encourageant : les gens sont attentifs. Ils s’impliquent. Et c’est exactement ce qu’il faut faire si nous voulons nous opposer à des politiques dangereuses pour nos pays et pour le monde.
Et je pense que l’on retrouve un peu de cela ici, en Allemagne. Même si les voix pro-palestiniennes font l’objet d’une forte répression, il y a riposte.
C’est ce qui est encourageant : en tant que citoyens, nous continuons à demander des comptes à nos gouvernements sur les politiques qu’ils mènent.
C’est donc l’aspect positif de la situation, même en ces temps très difficiles – la résistance non violente. Les gens descendent dans la rue. Diriez-vous que c’est ce que les gens peuvent faire ?
Tout à fait. Je pense qu’il est très important – et en particulier le fait de pousser les médias à montrer qu’il y a un mécontentement aux États-Unis. En ce moment, nous voyons de plus en plus de réunions publiques avec des hommes politiques, et c’est très fort. Les citoyens se lèvent – même ceux qui soutenaient Trump – et ils disent : Que faites-vous ? Pourquoi mettez-vous en pièces l’ensemble du gouvernement fédéral ? Vous me faites du mal en tant que vétéran. Vous me faites du mal en tant que personne âgée dépendant de la sécurité sociale.
Alors oui, nous avons besoin de ce genre de visibilité. Les lettres et les courriels, c’est bien. Mais personne ne les voit, sauf celui qui les reçoit. Il faut être dans la rue pour montrer que des centaines de milliers de personnes se préoccupent de ces questions.
Quel regard portez-vous sur la jeune génération dans ce contexte ? Est-ce que cela vous donne de l’espoir, ou plutôt de l’inquiétude ?
Eh bien, cela dépend vraiment du sujet. Hier, à la manifestation de Wiesbaden, il y avait surtout un public plus âgé, ce qui est assez similaire à ce que l’on voit lors des manifestations pour la paix aux États-Unis. Mais en ce qui concerne la Palestine, et le génocide israélien à Gaza, ce mouvement est mené par les jeunes. Ce sont eux qui sont en première ligne, qui s’organisent, qui s’expriment, qui prennent des risques. Et ils sont soutenus par les générations plus âgées, certes, mais ce sont les jeunes qui montrent la voie. Même chose pour les questions environnementales aux États-Unis : c’est la jeune génération qui se mobilise, qui se préoccupe de son avenir et qui exige des mesures concrètes.
Ce qui me donne de l’espoir, c’est leur indignation. Ils ne sont pas insensibles. Ils ne sont pas indifférents. Ils observent ce qui se passe – le monde du XXIe siècle laisse se produire un nouveau génocide – et ils en sont furieux.
Pourquoi pensez-vous qu’il est si difficile pour les gens de voir les liens entre la militarisation, le démantèlement des services sociaux, le déclin de l’éducation et des soins de santé, l’effondrement des infrastructures, la pauvreté croissante et la destruction de l’environnement ? Cela semble évident, mais apparemment, ce n’est pas le cas.
Vous avez raison. Et je pense que nous sommes tous confrontés à ce problème. Peut-être est-ce dû au fait que les gens s’intéressent particulièrement à des choses qui les touchent directement au quotidien. Et comme il n’y a plus de conscription pour l’armée US, l’armée n’affecte pas directement la plupart de ceux de la jeune génération, car ils sont si peu nombreux à s’engager. Ce sont surtout ceux qui ont besoin d’un emploi et qui n’en trouvent pas ailleurs qui finissent par s’engager.
Mais je pense que nous continuerons d’essayer de lier ces questions, de les présenter comme un tout cohérent. De montrer toutes les tentacules de la pieuvre : comment la militarisation affecte notre société tout entière : l’environnement, par exemple, ou l’expulsion des migrants.
En ce moment, l’armée US – des militaires en service actif – est déployée à la frontière pour aider à refouler les gens. Des vols militaires emmènent des personnes hors du pays dans le cadre d’opérations d’expulsion, sans aucune forme d’audience judiciaire.
Et cet aspect – les expulsions forcées – est un sujet auquel les jeunes s’accrochent vraiment, d’autant plus que de nombreux jeunes immigrants vivent aux États-Unis depuis longtemps. Ils se considèrent comme faisant partie du pays – résidents, voire citoyens. Et même s’ils n’ont pas de statut légal, ils font partie de notre société depuis si longtemps qu’ils veulent simplement être traités comme s’ils y appartenaient – car ils y appartiennent bel et bien.
Je pense donc que cette question contribue à rassembler les différentes composantes de notre communauté pour la justice sociale.
Malheureusement, le temps commence à manquer. Face à tous les revers et à la situation désastreuse du monde, où puisez-vous votre force ? Comment parvenez-vous à garder courage et espoir ? Beaucoup de militants ont du mal avec cela.
Eh bien, vous savez, je m’inspire de ceux qui sont opprimés – et qui résistent encore. Il suffit de regarder les Palestiniens – à Gaza et en Cisjordanie – et tout ce qu’ils traversent. Et pourtant, l’esprit dont ils font preuve… Peu importe le nombre de centaines de milliers de morts, ils disent : « Nous n’abandonnerons pas. Nous ne renoncerons pas à être Palestiniens. Nous ne renoncerons pas à vivre sur les terres où nous vivons depuis des milliers d’années. »
Je m’inspire aussi des Ukrainiens : ceux qui disent : « Notre territoire a été envahi », et des citoyens ordinaires qui disent : « Cela ne peut pas continuer. » Ils sont prêts à contester ce qui se passe, mais ils affirment : « Il faut la paix. » Ils ne veulent pas que d’autres personnes meurent.
Je puise aussi du courage auprès des immigrants vivant aux États-Unis : des gens qui ont travaillé si dur, qui sont devenus partie intégrante de notre société, et qui pourtant sont maintenant expulsés. Et même là, quand on les entend parler, ils expriment toujours leur gratitude pour le temps passé aux États-Unis. Ils repartent avec des valeurs différentes, même si cette dernière leçon, celle de l’expulsion, est une leçon qu’ils n’apprécieront certainement pas.
Mais dans l’ensemble… il y a tellement d’espoir chez ceux qui continuent à œuvrer pour un monde meilleur. Et tous ces gens qui travaillent dur pour l’humanité me donnent de la force. Ils me donnent de l’espoir.
Chère Ann, merci du fond du cœur pour votre temps, vos paroles claires et votre voix infatigable en faveur de la paix. C’est toujours une source d’inspiration de vous parler. Nous vous souhaitons beaucoup de force et de bonne santé – et espérons vous accueillir bientôt de nouveau en Allemagne, aux côtés du mouvement pacifiste.