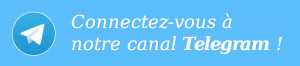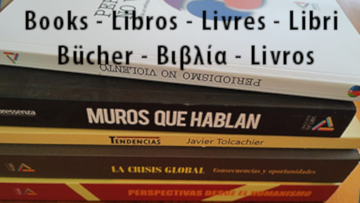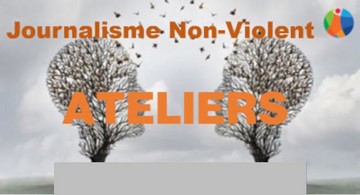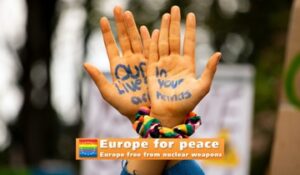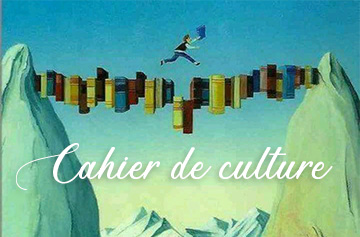Il est difficile de saisir à quel point la discrimination nous affecte tous et à quel point ses conséquences peuvent être importantes. À la base, la discrimination repose sur une structure hiérarchique et de jugement qui façonne la façon dont nous percevons le monde et interagissons avec lui. Elle devient un filtre inconscient à travers lequel notre esprit est organisé, créant des frontières qui limitent notre compréhension mutuelle. La discrimination n’a pas seulement un impact sur la manière dont nous interagissons avec les autres – le « nous » et le « eux » – mais aussi sur la manière dont nous percevons les idées qui diffèrent de ce que l’on nous a enseigné.
L’une des façons de comprendre notre époque est d’examiner la discrimination à l’encontre de la recherche non matérielle. Nous vivons dans un monde surmatérialisé, où tout a été objectivé, laissant peu de place aux relations non transactionnelles. Même le financement de la recherche scientifique est principalement dicté par des principes matériels et physiques.
Nikola Tesla s’est fait l’écho de cette tendance en déclarant : « Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie qu’au cours de tous les siècles précédents de son existence. ”
Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à produire. Les humains modernes sont devenus les machines de production par excellence : ils produisent des biens, de la nourriture, des médicaments, des infrastructures, des technologies, des connaissances et même de l’art à un rythme accéléré. Nous inondons nos vies d’objets, de transactions et d’innovations, en cherchant toujours à augmenter et à accélérer le processus. Pourtant, nous nous demandons rarement où tout cela nous mène. Dans cette quête incessante, même les êtres humains sont objectivés, souvent comparés à l’intelligence artificielle, comme si notre valeur se mesurait uniquement à l’aune de notre rendement.
L’astronaute Edgar Mitchell, en voyant la Terre depuis la Lune, a décrit un profond changement de perspective : « Vous développez une conscience globale instantanée, une orientation vers les gens, une insatisfaction intense de l’état du monde, et une compulsion à faire quelque chose à ce sujet ».
La communauté de personnes autistes offre une autre perspective éclairante pour examiner nos préjugés matériels. En 2017, on estime que 2,21 % des adultes des États-Unis âgés de 18 à 84 ans, soit environ 5,4 millions de personnes, vivaient avec un trouble du spectre autistique. À l’échelle mondiale, environ 1 % de la population est autiste, ce qui représente plus de 75 millions de personnes, selon les recherches menées par le CDC.
Bien que l’autisme soit de plus en plus reconnu comme une forme de neurodiversité plutôt que comme un déficit, la stigmatisation et les idées fausses continuent de créer des obstacles à l’inclusion. De nombreuses sociétés considèrent encore l’autisme comme quelque chose qui doit être corrigé ou caché, ce qui conduit à l’exclusion sociale et à la discrimination. Cette stigmatisation empêche de nombreuses personnes autistes d’accéder à un soutien approprié, de participer pleinement à leur communauté, de nouer des relations, de trouver un emploi et de recevoir des soins de santé adéquats.
Le podcast Telepathy Tapes, créé par le réalisateur de documentaires Ky Dickens, explore l’idée que les enfants autistes qui ne parlent pas communiquent par télépathie. Cela remet en question la croyance conventionnelle selon laquelle la communication est uniquement verbale ou transactionnelle. Elle nous invite à considérer qu’il existe des dimensions de connexion au-delà de ce que nous reconnaissons habituellement – des espaces que nous pouvons tous expérimenter mais que nous avons du mal à articuler.
Imaginez un instant que votre point de vue sur le monde soit transformé par une véritable écoute des personnes autistes. Et si nous redirigions notre énergie vers le développement de nouveaux canaux de communication qui ne reposent pas sur des objets physiques ? Et si les expériences de certains de nos voisins autistes révélaient que l’existence n’est pas confinée au corps et que la communication peut transcender la présence physique ? Ces idées laissent entrevoir la possibilité d’une conscience globale, à laquelle nous sommes tous intrinsèquement liés, même si nous ne le reconnaissons pas.
C’est peut-être notre mentalité discriminatoire, limitée par le filtre matérialiste, qui nous retient. Il n’existe pas de « pilule » contre la discrimination – seule une motivation profonde à voir au-delà de ses limites peut ouvrir la porte à l’exploration des vastes territoires inexplorés de la connexion humaine. Un monde plus inclusif nous attend tous. La communauté des autistes pourrait bien nous montrer la voie à suivre, à condition que nous osions l’écouter.