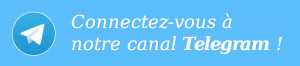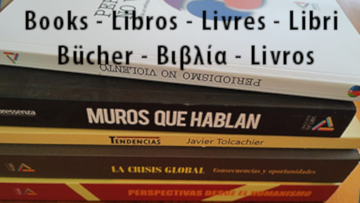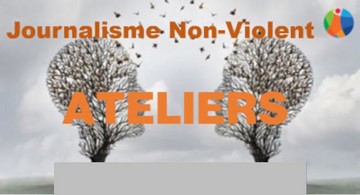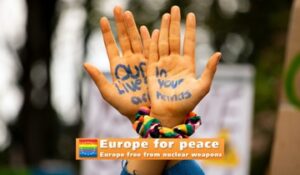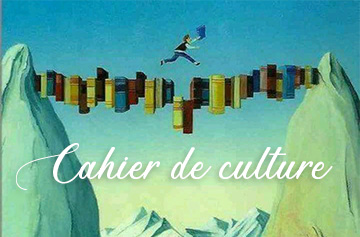En Amérique du Nord, les citoyens sont tellement libres qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, faire complètement abstraction de la réalité géopolitique. Parmi les libertés qui leur sont offertes, il y a la liberté d’ignorer l’importance de ces enjeux, une liberté que les autorités entretiennent volontiers, leur offrant du pain et des jeux en guise de remerciement. On se charge de les maintenir dans l’ignorance des agissements de la Central Intelligence Agency (CIA), de la National Endowment for Democracy (NED), de la National Security Agency (NSA) et même de la United States Agency for International Development (USAID).
L’opinion publique nord-américaine structure plutôt sa compréhension du monde politique à travers la politique telle qu’elle se déploie à l’intérieur de leurs États, opposant par exemple les Démocrates et les Républicains aux États-Unis, ainsi que les Libéraux et les Conservateurs au Canada. Dans les deux cas, il s’agit d’une opposition entre des politiciens de tendance libérale et des politiciens de tendance conservatrice. Ainsi, un électeur moyen de tendance libérale aura été enclin ces derniers mois à appuyer Justin Trudeau (Parti libéral) contre Pierre Poilièvre (Parti conservateur) et Joe Biden (Démocrate) contre Donald Trump (Républicain).
On ne peut certes pas nier les différences significatives pouvant persister entre ces partis politiques et, tout particulièrement, dans le contexte présent, concernant les politiques identitaires, qu’il s’agisse des femmes, des LGBTQ, des Afro-Américains, des citoyens autochtones ou des immigrants. Le combat contre le wokisme occulte peut-être d’autres débats de fond, mais les choix faits en ces matières ne sont pas anodins et sans importance, car ils peuvent avoir des conséquences sérieuses pour les personnes concernées.
En ce qui a trait aux enjeux géopolitiques, les esprits ont été formatés à partir de la certitude que l’Occident offrait des promesses de liberté qui sont absentes au sein des sociétés russe, chinoise ou iranienne. Aussi, lorsqu’il s’agit de comprendre ce qui se passe à l’échelle internationale, les citoyens nord-américains ont tendance, peu importe leur allégeance, à prendre position en projetant sur l’enjeu géopolitique les certitudes acquises au sujet du fonctionnement interne de leurs pays respectifs. Un article récent sur l’avant-Seconde Guerre mondiale évoquait la dérive autoritaire, l’ébranlement des institutions démocratiques, la xénophobie, mais pas la situation internationale et la marche à la guerre. L’instance internationale et ses réalités sont absentes. Ces citoyens souscrivent aux « valeurs » occidentales et s’entendent sur la suprématie des droits individuels. Ils ne peuvent en ce sens, lorsqu’un conflit surgit, qu’avoir des préjugés défavorables face à la Russie, à la Chine ou à l’Iran. Il leur échappe que des impératifs collectifs, réglés ou non existants en Occident, puissent être prioritaires dans d’autres sociétés. Ils ne sont pas conscients que les droits individuels, présentés en termes absolus, sont devenus un instrument que les puissances occidentales utilisent pour déstabiliser les sociétés dont elles cherchent à prendre le contrôle.
Il ne faut pas atténuer la gravité des enjeux identitaires au sein des sociétés non occidentales. Il faut en particulier être sensible au traitement qu’un très grand nombre de ces sociétés infligent aux femmes, aux LGBTQ et aux autres minorités. Il faut cependant se méfier de la tendance fâcheuse qui consiste à se prononcer sur les enjeux de géopolitique en se servant des opinions que l’on a pu se faire au sujet des régimes internes ou des pratiques sociales des pays concernés. Même si on est hostile à l’endroit d’un État que l’on considère autoritaire, il faut reconnaître que cet État a quand même le droit de vivre dans un environnement international sécuritaire et de ne pas être agressés par l’Occident. Demanderait-on que les pays occidentaux soient envahis parce qu’on y retrouve des inégalités sociales, de la discrimination, de la xénophobie et du racisme ? On ne peut comprendre les questions internationales en se limitant aux seules considérations sociétales, identitaires ou humanitaires. L’empathie et l’indignation morale ne suffisent pas.
Une présence impériale démasquée?
Prenons comme point de départ l’Ukraine et l’opération militaire spéciale de la Russie amorcée le 24 février 2022. Ici, la haine de Vladimir Poutine et de ses agissements présumés à l’égard de ses opposants politiques et médiatiques vient structurer notre opinion. Il éliminerait, emprisonnerait et empoisonnerait ses opposants. Dès lors, il ne peut qu’être coupable d’une agression non provoquée en Ukraine que l’on peut expliquer en lui attribuant l’intention de reconquérir les territoires perdus de l’ex-union soviétique. C’est ainsi que les politiciens, les journalistes et les milieux intellectuels européens et nord-américains réagirent face à l’intervention en Ukraine, produisant une opinion qui, forcément, par son caractère unanime, serait adoptée aussi par l’ensemble des citoyens.
Suite au démantèlement de l’Union soviétique en 1991, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) aurait pu aussi être dissoute, car il s’agissait d’une organisation militaire antirusse dont le commandement était américain. L’organisation adopta plutôt une politique de la porte ouverte, trop heureuse d’agrandir ses rangs et d’imposer sa domination sur une Russie humiliée. Les membres de l’OTAN passeront de 16 à 30 et ils sont maintenant 32. Des bases militaires y seront installées encerclant de plus en plus la Russie. La NED et la CIA joueront un rôle-clé dans les révolutions de couleur que les Américains chercheront à fomenter : rose en Géorgie, orange en Ukraine, denim en Biélorussie, tulipe au Kirghizistan, cèdre au Liban et verte en Iran.
Concernant plus spécifiquement l’Ukraine, les États-Unis tentèrent sans succès de provoquer un changement de régime en 2004. Ils annoncèrent quand même à Bucarest en 2008 leur intention d’inclure l’Ukraine dans l’OTAN, et ce, malgré les refus et avertissements successifs et répétés de toute la classe dirigeante russe. L’inclusion de l’Ukraine dans l’OTAN était clairement un geste que les Russes n’allaient pas accepter. Les diplomates, les experts et les intellectuels américains furent d’ailleurs fort nombreux à avertir leur gouvernement de ne pas s’engager dans cette voie.
Qu’à cela ne tienne, les politiciens John McCain, Lindsey Graham, Chris Murphy, Joe Biden et Victoria Nuland sont allés à tour de rôle rencontrer les trois chefs de l’opposition ukrainienne : Vitali Klitschko, Oleg Tiagnibok et Arseni Iatseniouk. En 2014, ils ont avec succès cette fois-ci encadré, appuyé et financé le changement de régime avec l’aide de Secteur droit, un mouvement marginal néonazi ayant toutefois joué un rôle capital dans le détournement violent de la révolte populaire qui se voulait démocratique et pacifiste. Les États-Unis ont, de l’aveu de Victoria Nuland, investi 5 milliards de dollars pour obtenir un changement de régime en Ukraine.
Ils ont par la suite pris en main le contrôle du pays. Ainsi que cela fut révélé dans un appel téléphonique intercepté entre Victoria Nuland et l’ambassadeur américain à Kiev Geoffrey Pyatt, il fut décidé de confier le rôle de Premier Ministre à Arseni Iatseniouk. Il fallait que les deux autres membres de l’opposition restent en retrait du gouvernement. Ainsi, Vitali Klitschko deviendra maire de Kiev, tandis que Oleg Tiagnibok, chef du petit parti néo-nazi Liberté, sera carrément écarté à cause de ses antécédents antisémites dénoncés par la Fondation Elie Wiesel. Qu’à cela ne tienne, quatre membres de son parti seront intégrés au gouvernement. Une citoyenne américaine, Natalie Ann Jaresko, sera rapidement naturalisée ukrainienne pour devenir ministre de l’Économie en décembre 2014. Un allié des États-Unis, Mikheil Saakachvili, ancien président géorgien initiateur de la guerre de Géorgie en 2008, sera propulsé gouverneur d’Odessa. Le directeur de la CIA de l’époque, John Brennan, se rendra en Ukraine pour rencontrer les nouveaux dirigeants. Le vice-président Joe Biden s’y rendra une bonne douzaine de fois. Son fils Hunter entrera dans le Conseil d’administration de l’entreprise Burisma et touchera un salaire mirobolant. Son père Joe fera limoger le procureur général chargé notamment de faire enquête sur un ancien dirigeant de Burisma.
Face au coup d’État, la Russie réagit elle aussi rapidement pour reprendre la Crimée, une région russophone qui avait été confiée à l’Ukraine en 1954. Alors que cette région était sous contrôle russe depuis des siècles, ce contrôle lui échappa en 1991 lorsque l’Ukraine devint indépendante. Il s’agissait donc pour les Russes de reprendre en 2014 une région perdue seulement depuis 23 ans, de préserver l’accès à la mer Noire et de garder le contrôle sur l’une de leurs rares bases navales à Sébastopol. Sous le nouveau régime à Kiev, cette base deviendrait un atout antirusse pour les États-Unis et l’OTAN. La Russie avait fait la sourde oreille au référendum tenu en Crimée en 1991. Elle n’allait pas cette fois-ci réagir de la même façon. Un second référendum fut tenu qui donna encore une fois les mêmes résultats. La quasi-totalité de la population s’exprima en faveur du rattachement à la Russie.
Des lois liberticides furent votées contre l’usage de la langue russe dès le lendemain du coup d’État, le 23 février 2014. Des néonazis se déplacèrent à Odessa pour mettre le feu le feu à la Maison du Syndicat où des opposants russophones à ces lois s’étaient retranchés. Une cinquantaine d’entre eux moururent brûlés vifs. Les Oblasts de Louhansk et de Donetsk déclarèrent leur indépendance pour réagir contre les lois nouvellement adoptées. Une guerre civile s’amorça, au centre de laquelle figurait le groupe néo-nazi Azov, entraînant 14 000 personnes dans la mort.
Les Accords de Minsk furent adoptés par l’Ukraine et la Russie et parrainés par la France et l’Allemagne. Ces accords avaient pour objectif de mettre fin à la guerre civile. Ils visaient à rétablir l’usage public de la langue russe et à constitutionnaliser une autonomie d’États fédérés aux deux Oblasts sécessionnistes. Angela Merkel, François Hollande et Petro Porochenko admettront bien candidement qu’il n’a jamais été question d’appliquer ces accords. Leur adoption servait seulement à gagner du temps en préparation de la guerre contre la Russie.
Suite au coup d’État de 2014 à Kiev, les Américains poursuivront leur escalade belliqueuse. Ils formeront l’armée ukrainienne, et notamment le groupe néonazi Azov. Ils équiperont et fortifieront l’Ukraine pour la préparer à la guerre. Ils ne feront rien pour forcer l’Ukraine à appliquer les Accords de Minsk.
Les Américains s’étaient retirés en 2002 de l’accord sur les systèmes anti-missiles pour en installer ensuite en Pologne et en Roumanie. Ils se sont aussi retirés de l’Accord sur les missiles à portée intermédiaires en 2019. Allaient-ils en installer en Ukraine? Joe Biden, devenu président, a dans un premier temps promis en décembre 2021 de ne pas placer de tels missiles sur le territoire ukrainien, pour ensuite abandonner cette promesse quelques semaines plus tard. La Russie risquait donc de se retrouver face à une Ukraine devenue depuis peu membre de facto de l’OTAN et sur le territoire de laquelle les Américains allaient pouvoir installer des missiles à portée intermédiaire susceptible d’atteindre Moscou en quelques minutes. Il serait donc forcé, à toute heure du jour ou de la nuit, de se tenir prêt, risquant à tout moment de se retrouver en face d’une alerte majeure. Si un missile était lancé en direction de Moscou, il n’aurait que quelques minutes pour décider s’il doit riposter et conduire l’humanité entière dans la spirale d’une guerre nucléaire. Il est dans ce contexte approprié de décrire une telle situation comme un « existential threat ». Cela équivaut à la situation d’un individu qui est face à un fusil que l’on est en train de poser sur sa tempe.
En décembre 2021, les Russes proposèrent sans succès à l’OTAN et aux États-Unis d’ultimes propositions portant sur la sécurité en Europe et sur le désarmement des bases militaires encerclant la Russie. Ils auraient pu exploiter d’autres solutions, mais ils comprirent vite que l’escalade allait de toute façon se poursuivre. Ils choisirent d’agir avant d’être complètement placés le dos contre le mur. Une opération militaire spéciale (non une guerre) fut donc engagée le 24 février 2022 afin de renforcer la sécurité de la Russie en éloignant les États-Unis de sa frontière par la neutralisation de l’Ukraine. Les causes du conflit en Ukraine sont géopolitiques : l’extension de l’OTAN jusqu’à la Russie.
Dans les semaines qui suivirent, des négociations entre l’Ukraine et la Russie furent rapidement engagées. Elles étaient sur le point d’aboutir dès le mois d’avril 2022 à Istanbul, à peine quelques semaines de confrontation militaire. Mais c’était sans compter sur les Américains et les Britanniques qui sont rapidement intervenus pour mettre un frein à cette entente imminente.
Les Américains ont donc tout fait pour que cette guerre advienne et se poursuive. Ils se sont servis de l’Ukraine pour affaiblir la Russie. Un document produit par la Rand corporation (« Extending Russia ») en 2019 indiquait d’ailleurs la marche à suivre. Le document examinait diverses possibilités, dont celles de fournir des armes létales à l’Ukraine, de déstabiliser les gouvernements se trouvant en périphérie de la Russie, de se retirer de l’Accord sur les missiles à moyenne portée, de mettre fin à la vente du pétrole et du gaz russe en Europe et d’interrompre le projet de gazoduc Nordstream. Le gouvernement américain a suivi à la lettre cette feuille de route, et ce, malgré les réserves importantes exprimées par les auteurs du document.
Les faits que nous venons de rapporter peuvent être jugés inutiles et répétitifs pour qui est déjà au fait de la dimension géopolitique de ce conflit, mais ils sont encore largement ignorés et ils ne sont en tout cas pas parvenus à ébranler une opinion largement répandue et convaincue que nous avons plutôt affaire à une opposition entre le bien (l’Occident) et le mal (la Russie « de Poutine »).
Une première raison de douter
Les évènements du 7 octobre 2023 ont cependant introduit une première fissure dans cette image d’Épinal qui oppose le bien contre le mal. En réaction à l’opération du Hamas et de groupes affiliés, le régime d’extrême droite de Benjamin Netanyahu a réagi avec une violence inouïe, appuyé par les États-Unis. Le gouvernement Netanyahu a annoncé son intention de rendre la bande de Gaza invivable et il s’est donné comme objectif de priver la population gazaouie de nourriture, d’électricité, de gaz et d’eau, seule façon selon le ministre de la défense Yoav Galant, de se comporter à l’égard de ces « animaux humains ». Les citoyens de par le monde ont été pour la première fois les témoins directs d’un génocide, ouvertement revendiqué et reconnu comme plausible par la Cour internationale de justice. Or, ce génocide compromet directement les États-Unis, car ce sont eux qui ont fourni les cent mille tonnes de bombes à Israël pour accomplir ce carnage immonde. Cet appui génocidaire de Washington est le fait du président démocrate Joe Biden.
Les États-Unis présentaient un visage étonnamment belliqueux. On aurait alors pu espérer que l’opinion publique se modifie au sujet de l’Ukraine en conséquence de ces évènements tragiques. D’aucuns tentèrent au contraire de montrer que la mort de centaines d’Israéliens tués par le Hamas et par l’armée israélienne dans la journée du 7 octobre constituait le véritable acte de génocide, tandis que la mort de dizaines de milliers de civils gazaouis ne serait que l’effet collatéral malheureux découlant du fait que le Hamas se servait des citoyens comme boucliers humains. Ceux qui voyaient ainsi les choses n’avaient aucune raison de modifier leur opinion au sujet de l’Ukraine, car les États-Unis appuyaient là aussi une « victime ». Israël avait, disait-on, « le droit de se défendre ».
D’autres soulignèrent certes l’incohérence, les deux poids et deux mesures, de l’administration Biden. Cet argument présupposait toutefois le maintien d’un jugement favorable concernant l’appui militaire à l’Ukraine. Rares furent ceux qui reconnurent la cohérence interne de l’impérialisme américain, se servant de l’Ukraine pour affaiblir la Russie et appuyant l’allié au Moyen-Orient adversaire de l’Iran.
Malheureusement, l’opposition entre Biden et Trump dans la course à la présidence de 2024 a très rapidement pris le dessus sur l’ensemble de ces considérations. Les nouvelles en provenance de Gaza se font faites de plus en plus rares et elles sont devenues quasi absentes dans les médias traditionnels, sauf pour rappeler la « crise humanitaire » vécue par les citoyens de la bande de Gaza et la « pression » toujours exercée par Israël sur le Hamas.
Une deuxième raison de douter
Les évènements plus récents ont cependant pu redonner l’espace d’un instant espoir de voir apparaître une prise de conscience nouvelle critique à l’égard des États-Unis. L’arrivée de Trump au pouvoir a donné lieu à une posture agressive et belliqueuse, même à l’égard de ses plus proches alliés. Acheter le Groenland? S’emparer du canal de Panama? Renommer le golfe du Mexique? Imposer des tarifs au Mexique et au Canada? Intégrer le Canada comme 51e État? Il aura fallu tout cela pour que, pour la première fois au Canada, on parle dans les médias de l’impérialisme américain.
Donald Trump proposa de procéder au nettoyage ethnique des 2 millions de Palestiniens. La population mondiale s’est insurgée contre cette position de Trump, y compris au Canada. Et pourtant, cette posture de Trump était en parfaite continuité avec celle qui avait été adoptée auparavant par l’administration Biden. Autant Biden que Trump s’alignaient sur les politiques israéliennes de nettoyage ethnique. Le secrétaire d’État Anthony Blinken avait, en effet, lui-même fait des démarches auprès de la Jordanie et de l’Égypte pour que ceux-ci accueillent les réfugiés gazaouis. L’appui de Biden à Israël avait permis de raser à plat toute la bande de Gaza. La suite logique pouvait à première vue rendre presque nécessaire le déplacement de la population sur d’autres territoires.
Malgré tout cela, très rapidement, l’attention s’est focalisée sur l’autoritarisme de Trump, qui faisait contraste avec l’administration précédente. Sa posture à l’égard de l’immigration, ses décisions abjectes prises à l’égard des LGBTQ, ses « executive orders » qui font fi du Congrès, ses décisions anticonstitutionnelles, l’exclusion de l’Associated Press lors des points de presse de la Maison Blanche, le licenciement des procureurs nommés par les Démocrates, tout cela permet de mettre en évidence une rupture fondamentale par rapport au passé. Le fameux checks and balance est remis en question. L’État de droit n’existe plus. Le président se croit au-dessus de la Cour suprême et de la constitution, comme un véritable facho aux commandes d’un État d’extrême droite.
Tout cela est juste, mais en même temps, la focalisation sur la politique interne de Trump permet d’ignorer ou d’occulter les violations du droit international sous l’administration Biden. La désinvolture de Trump à l’interne n’a pourtant eu d’égale que celle de l’administration Biden à l’externe. L’imposition d’un rules-based order se présentait en remplacement du droit international. Le droit de veto des États-Unis au conseil de sécurité concernant les résolutions visant à mettre en place un cessez-le-feu à Gaza montrait à quel point les États-Unis constituaient un frein au règlement international du conflit. L’appui génocidaire à l’État génocidaire était en violation flagrante de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. L’interruption du financement de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) constituait un coup de pied additionnel donné aux institutions internationales. Il en va de même concernant le maintien de l’aide apportée à Israël qui fut accordée même après les ordonnances de la Cour internationale de justice. Tout cela aurait dû marquer les esprits. Que l’on considère l’administration de Biden ou celle de Trump, dans les deux cas, les États-Unis se croient au-dessus des lois. Mais puisque la politique extérieure est occultée au profit de la politique intérieure, on focalise sur Trump et non sur Biden.
Quelle est la politique la plus odieuse? Celle qui va à l’encontre de la constitution interne des États-Unis ou celle qui va à l’encontre du droit international? Il est difficile de trancher, mais la focalisation sur les déclarations intempestives quotidiennes de Trump n’a pas permis de saisir toute l’arrogance de l’administration Biden, pourtant responsable des dizaines de milliers de morts de civils à Gaza et responsable du pourrissement de la situation en Ukraine.
Une troisième raison de douter
Un troisième brouillage vient toutefois d’apparaître dans l’image que l’on se fait d’un Occident porteur de valeurs universelles sous la direction des États-Unis. Donald Trump rencontre Vladimir Poutine seul à seul. Il s’agit de s’entendre sur les modalités d’un cessez-le-feu en Ukraine mais aussi, plus largement, sur les conditions durables de paix permettant de passer à autre chose. L’Ukraine et l’Europe sont aux abois et pour cause car elles ne sont pas présentes et n’ont pas été invitées.
Il ne faut négliger l’importance de négociations qui s’entament et qui pourraient mettre fin au conflit. Mais on ne peut s’empêcher de constater l’effet dévastateur ressenti par l’Ukraine et l’Europe. Elles ont été entraînées par les Américains dans ce conflit. Les Européens se sont privés du gaz et du pétrole russe bon marché pour appliquer les « sanctions » décrétées par Washington. L’Ukraine, quant à elle, a perdu des centaines de milliers d’hommes au combat et des millions d’Ukrainiens ont émigré.
Or voilà justement que les États-Unis, l’un des perdants de cette guerre, rencontrent la Russie, sans les deux autres perdants, l’Ukraine et l’Europe. Va-t-on alors enfin comprendre que les États-Unis sont en grande partie les premiers responsables de ce conflit, qu’ils étaient les véritables adversaires de la Russie, que la guerre opposait au fond la Russie et les États-Unis et que l’Ukraine et l’Europe ont été instrumentalisés dans toute cette affaire? Depuis le début, le narratif voulait que ce soit une guerre entre la Russie et l’Ukraine, les États-Unis étant ceux qui sont venus secourir l’Ukraine en leur fournissant de l’argent et des armes. Les négociations bilatérales ramenaient la réalité géopolitique au premier plan : le conflit en Ukraine est un affrontement entre les États-Unis et la Russie; les deux adversaires se parlent pour y mettre fin; les proxys bellicistes sont mis en attente auront le temps de changer de logiciel. La réalité était peut-être en voie d’être mieux comprise.
Pour certains, cette négligence de l’Ukraine est un geste scandaleux posé par Trump. Mais le scandale est apparu bien plus tôt sous l’administration Biden. De nombreux représentants et sénateurs, démocrates autant que républicains, se sont réjouis d’investir dans une guerre qui pouvait affaiblir la Russie sans que cela n’entraîne aucune mort de soldats américains. Qu’il s’agisse d’Adam Schiff ou de Mitt Romney, de Lindsay Graham ou de Lloyd Austin, les pertes de vie ukrainiennes ne semblaient pas, selon eux, compter pour grand-chose.
L’Europe aussi apparaît enfin comme un partenaire qui ne compte plus. En forçant les Européens à interrompre le commerce du gaz et du pétrole russe, et en faisant exploser le gazoduc Nordstream financé en partie par l’Allemagne, l’administration Biden manifestait, déjà à l’époque, son mépris à l’égard de l’Europe, et en particulier à l’égard de l’Allemagne. La seule différence est que ce mépris apparaît maintenant en pleine lumière.
Malheureusement, ces constats ne sont pas faits. Les préjugés défavorables à la Russie semblent inébranlables chez certains. On se retourne contre ceux qui les remettent en question en les traitant de pro-Poutine ou de pro-Trump. On blâme Trump d’être celui qui écarte l’Ukraine, ce qui laisse entendre que Biden faisait de son côté montre d’une solidarité nécessaire avec ce pays, et ce bien qu’il l’avait engagé dans une guerre perdue d’avance dont le seul but était d’affaiblir la Russie. L’opinion publique est frappée par la rencontre entre deux chefs dits autoritaires de tendance « fasciste », et ils appréhendent l’enjeu encore une fois à partir d’un prisme idéologique lié à la politique interne de ces deux pays. Ils sont inconscients du fait que les États ont des droits et des intérêts indépendamment de ceux qui les dirigent. La seule nouveauté est que cet autoritarisme d’extrême droite affecterait maintenant aussi les États-Unis et non seulement la Russie.
On pourrait voir les choses autrement. Ce que Trump fait ouvertement, les administrations précédentes le faisaient tout autant, sauf que c’était en catimini. On songe à l’espionnage interne pratiqué par la NSA. Le sonneur d’alerte Edward Snowden qui a révélé cette pratique a été forcé de s’exiler. On songe aux agissements de l’armée, de la CIA et du département d’État mis en évidence par Wikileaks. Julian Assange a payé cher pour avoir eu l’audace de révéler à la face du monde ces mauvais côtés de l’Amérique. Cela a eu pour effet de refroidir les ardeurs des journalistes critiques de l’administration américaine. On songe aux manœuvres mensongères du Russiagate, essayant d’associer Trump à un complot russe contre les États-Unis. On songe à l’influence de USAID sur le financement et le contrôle du journalisme international. On pourrait souligner aussi le rôle des médias, de la CIA et de l’administration Biden dans la campagne visant à étouffer l’affaire du portable de Hunter Biden. Certains éléments contenus sur ce laptop auraient pu conduire à la destitution du président. Le pardon présidentiel accordé par Biden aux membres de sa famille permet de remettre le couvercle sur la marmite.
La politique arrogante de Trump à l’égard des médias exclus de ses conférences de presse est, elle aussi, en parfaite continuité avec les mesures précédemment admises. On songe à l’interdit de diffusion des chaînes Russia Today et Sputnik, jugées vecteurs de désinformation russe, comme si les médias américains ne faisaient pas de la propagande américaine. On songe à la loi approuvée par Joe Biden contre la présence de Tik Tok sur le sol américain. On songe au comportement de l’administration Biden à l’égard de Twitter, révélé par les Twitter Files, et à l’admission par Mark Zuckerberg que le gouvernement a exigé que soient censurés certains contenus circulant sur Facebook.
Conclusion
Tout cela passe sous l’écran-radar de la population nord-américaine, car celle-ci est médusée et terrifiée par les frasques d’un nouveau président tout aussi imprévisible que menaçant. On ne doit certes pas fermer les yeux face à un nombre croissant de pays occidentaux qui sont aux prises avec des partis politiques d’extrême droite. Ce sont des mouvements qu’il faut combattre. Mais il ne faut pas le faire en ignorant le passé, le présent et le futur de la trajectoire géopolitique occidentale.
Il ne faut pas maintenir dur comme fer des préjugés russophobes, sinophobes et islamophobes. Il ne faut pas juger utile de mener une « guerre des civilisations » en étant complaisant à l’égard de l’impérialisme américain. Il ne faut pas affirmer la suprématie des droits individuels en négligeant les droits collectifs des peuples. Il ne faut pas être indifférent à l’égard des 800 bases militaires américaines, des 250 interventions militaires des États-Unis depuis 1991, des 900 milliards par année investis dans le complexe militaro-industriel, et des 18 000 « sanctions » imposées unilatéralement à l’égard d’individus, d’entreprises et de pays. Il ne faut pas accepter, prétendument au nom de la « démocratie », la mort de plusieurs millions de personnes résultant des interventions militaires ou des « sanctions ». Il ne faut pas, comme Madeleine Albright, considérer qu’il valait la peine de tuer 500 000 enfants irakiens dans le sillage de l’invasion américaine de l’Irak en 2003. Il ne faut pas banaliser un génocide appuyé, soutenu et rendu possible par les États-Unis à Gaza. Il ne faut pas non plus se fourvoyer complètement au sujet du conflit en Ukraine.
Le conflit en Ukraine n’a pas commencé le 24 février 2022. Le conflit au Moyen-Orient n’a pas commencé le 7 octobre 2023. Et l’impérialisme américain n’est pas né le 20 janvier 2025. On ne le dira jamais assez : les réalités de la politique internationale ne sont pas réductibles à des questions de politique intérieure.