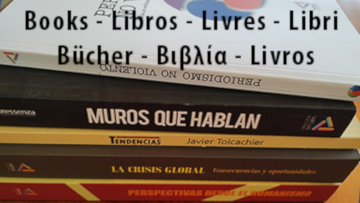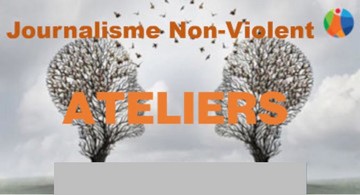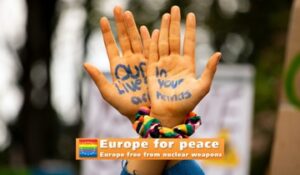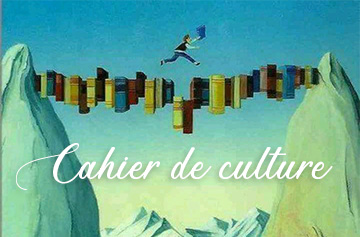Par Carmen Parejo Rendón
Le 1ᵉʳ mai 2006, Hugo Chávez, alors président du Venezuela, déclarait : « Le socialisme ne se décrète pas, le socialisme se construit, et il se construit avec un peuple conscient, mobilisé et organisé ».
C’est la troisième fois que je visite le Venezuela et à chacune de ces occasions, j’ai observé la même réalité. La coexistence de deux types d’histoires qui s’entrecroisent et qui s’affrontent inévitablement dans le pays : les histoires d’amour et les histoires de haine.
Les histoires d’amour ne sont pas parfaites. Les amants ne sont pas toujours d’accord, ils se disputent parfois ; cependant, ils se soutiennent et s’unissent quand il le faut. À l’inverse, il y a les histoires de haine, mais les plans des haineux ne se déroulent pas toujours comme prévu et ils sont aussi, souvent, réunis par ce sentiment.
Une de ces histoires d’amour commence avec un médecin cubain, faisant partie de l’armée de blouses blanches qui parcourent le monde pour défendre les peuples contre la maladie et l’abandon. De ce médecin naîtront les comités de santé, et de ces comités, la Mission Barrio Adentro I.
La Mission Barrio Adentro est l’une des initiatives populaires les plus emblématiques de la Révolution bolivarienne au Venezuela. Lancée en 2003, cette mission a pour objectifs fondamentaux l’accès universel à la santé pour le peuple vénézuélien, la prévention et la promotion d’habitudes saines, ainsi que la décentralisation du système de santé, en apportant les soins médicaux aux communautés les plus éloignées et en surmontant ainsi les barrières d’accès géographique et économique.
Avec Barrio Adentro I, des cabinets de consultation populaires ont été établis dans les communautés, en donnant la priorité aux services de base tels que la médecine générale, la pédiatrie et la vaccination. En 2005, Barrio Adentro II a débuté, avec le développement de centres de diagnostic intégral, de salles de réadaptation et de Centres de Haute Technologie, impliquant l’expansion de l’infrastructure sanitaire pour offrir des soins spécialisés et d’urgence. Ensuite sont venues les phases III et IV, qui ont supposé la consolidation des hôpitaux publics, en misant sur la modernisation technologique et l’expansion de la capacité hospitalière dans tout le pays.
La Mission Barrio Adentro a réussi à réduire la mortalité infantile de 49 % et la mortalité maternelle de 58 % au cours de ses dix premières années de développement. Pour l’année 2020, on rapportait la construction de plus de 11 000 cabinets de consultation populaires, 574 centres de diagnostic intégral et 35 centres de haute technologie.
Plus de 30 000 médecins, cubains et vénézuéliens, ont participé à ce programme, car cette Mission n’a pas seulement fourni des soins de santé, mais elle comprend également la formation d’une nouvelle génération de médecins dans le pays sud-américain.
Cette mission a entraîné la démocratisation de l’accès à la santé au Venezuela et, de plus, d’un point de vue politique, la combinaison des soins directs, de la formation et de la coopération internationale Sud-Sud démontre que la santé peut être un droit universel et non un privilège ou une affaire commerciale.
Cependant, Barrio Adentro fait partie d’une transformation plus profonde de l’État et du concept de démocratie au Venezuela. Ainsi, la Constitution bolivarienne a forgé un modèle participatif où les institutions n’agissent pas de manière isolée, mais travaillent directement avec le peuple organisé. Le peuple n’est pas seulement un récepteur des politiques institutionnelles, mais un concepteur actif de son propre destin. Le pilier fondamental de ce modèle sont les communes et les conseils communaux.

Le 18 janvier 2025, dans la commune rurale de Maisanta, municipalité de San Fernando de Apure, une assemblée communarde a été organisée afin d’expliquer tout ce qui concerne la consultation populaire nationale du 2 février et de connaître les besoins de la communauté en termes de projets de logement, d’électrification, d’aqueducs et de projets productifs.
En avril 2022, lors de ma première visite au Venezuela, une leader communale du quartier populaire La Vega, à Caracas, affirmait : « Ce que nous revendiquons, c’est que nous, en tant que peuple, puissions créer ». Dans cette lignée, elle ajoutait : « Le blocus, nous l’avons eu pendant 500 ans ». Dans son analyse, elle concluait qu’après de multiples agressions, plus de 900 sanctions économiques, de la violence dans les rues et de la violence politique internationale, le peuple vénézuélien résistait « par amour pour ce processus de transformation sociale ».
Actuellement, au Venezuela, il y a 4396 communes, 953 circuits communaux et un total de 5349 instances de participation citoyenne du pouvoir populaire, réparties dans tout le pays.
Le modèle communal a promu la décentralisation du pouvoir et l’autonomie locale, permettant aux communautés de gérer directement des projets de développement, d’infrastructure et de services publics, adaptés à leurs propres besoins.
Les communes ont stimulé la production agricole, artisanale et manufacturière au niveau local, réduisant la dépendance aux produits importés et garantissant l’accès aux denrées et aux biens pour les communautés. À leur tour, elles ont encouragé l’éducation populaire et le développement d’une conscience politique qui renforce la résistance face aux tentatives constantes de déstabilisation.
De nombreuses communautés ont réussi à développer des formes d’autosuffisance dans des domaines tels que l’alimentation, l’éducation et la santé. Tout un processus de transformation sociale qui s’est déroulé en parallèle pour aider à atténuer les effets de la guerre économique, tout en rendant réel l’autre monde possible tant de fois rêvé.
Au Venezuela, il y a quelque chose qui inquiète beaucoup plus les haineux, natifs ou étrangers, qu’un gouvernement plus ou moins favorable : un peuple conscient de ses droits, qui assume sa responsabilité historique et qui est profondément organisé.
Habituellement, des gens haineux nous imposent leur agenda quand nous parlons du Venezuela. Ils disent être préoccupés par la démocratie dans le pays. Mais la démocratie n’était-elle pas le pouvoir du peuple ?
L’autrice : Carmen Parejo Rendón est originaire de Séville (Espagne). Parallèlement à sa formation universitaire en philologie hispanique, elle développe des projets de gestion culturelle liés à la poésie et à la littérature en général. Rédactrice et analyste de la réalité latino-américaine et ouest-asiatique pour différents médias audiovisuels et écrits comme HispanTV, RT et Telesur. Directrice du média numérique Revista La Comuna.