Cette conférence de Mario Rodríguez Cobos, nom de plume Silo, a été donné à la Communauté Emanu-El, siège du judaïsme libéral en Argentine, Buenos Aires, 24 novembre 1994.
Je remercie la communauté Emanu-El et le rabbin Sergio Bergman de me donner la possibilité de faire cet exposé, ici et aujourd’hui. Je remercie de leur présence les membres de la communauté, les intervenants de ce cycle de conférences et les amis de l’humanisme en général.
Le titre de cet exposé annonce l’existence d’un humanisme universel mais, bien entendu, cette affirmation doit être démontrée. Pour cela, il faudra préciser ce que l’on entend par « humanisme » car il n’existe pas de consensus général sur la signification de ce mot ; d’autre part, il sera nécessaire de définir si « l’humanisme » est le propre d’un lieu, d’une culture ou s’il appartient aux racines et au patrimoine de l’humanité toute entière. Pour commencer, il conviendra de préciser l’intérêt que nous portons à ces questions, faute de quoi on pourrait penser que nous sommes simplement motivés par une simple curiosité historique ou culturelle. Pour nous, l’humanisme a le mérite captivant d’être non seulement Histoire mais aussi projet d’un monde futur et outil d’action actuel.
Ce qui nous intéresse, c’est un humanisme capable de contribuer à l’amélioration de la vie, un humanisme capable de faire face à la discrimination, au fanatisme, à l’exploitation et à la violence.
Dans un monde qui se globalise rapidement et qui montre les symptômes d’un choc entre cultures, ethnies et régions, il doit exister un humanisme universel, pluriel et convergent.
Dans un monde où les pays, les institutions et les relations humaines se déstructurent, il doit exister un humanisme capable d’impulser la recomposition des forces sociales. Dans un monde où l’on a perdu le sens et la direction de la vie, il doit exister un humanisme apte à créer une nouvelle atmosphère de réflexion dans laquelle le personnel ne s’oppose pas de manière irréductible au social, ni le social au personnel. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas un humanisme répétitif, mais un humanisme créatif, c’est-à-dire un nouvel humanisme qui, prenant en compte les paradoxes dé l’époque,aspire à les résoudre. Ces questions, qui sous certains aspects semblent contradictoires, seront précisées tout au long de cet exposé.
En demandant « qu’entendons-nous aujourd’hui par humanisme ? », nous soulignons à la fois l’origine et l’état actuel de la question.
Commençons par ce qui est historiquement observable en Occident, sans pour autant fermer la porte à ce qui est arrivé dans d’autres parties du monde où l’attitude humaniste était présente bien avant l’apparition de mots comme « humanisme », « humaniste » et d’autres de la même famille. Les caractéristiques de cette attitude commune aux humanistes de différentes cultures sont les suivantes :
○ la place de l’être humain comme valeur et préoccupation centrale ;
○ l’affirmation de l’égalité de tous les êtres humains ;
○ la reconnaissance de la diversité personnelle et culturelle ;
○ l’aspiration à développer la connaissance au-delà de ce qui est accepté comme vérité absolue ;
○ l’affirmation de la liberté des idées et des croyances ;
○ le rejet de la violence.
Pénétrer dans la culture européenne, et en particulier dans la culture italienne de la pré-Renaissance, nous permet d’observer que les studia humanitatis (l’étude des humanités) se référaient à la connaissance des langues grecque et latine, et surtout à celle des auteurs »classiques ». Les »humanités »comprenaient l’histoire, la poésie, la rhétorique, la grammaire, la littérature et la philosophie morale. Elles traitaient de questions génériquement humaines, à la différence des matières propres aux « juristes », « canonistes », « légistes » et « artistes » qui étaient destinées à une formation spécifiquement professionnelle. Bien sûr, ces formations « professionnelles » incluaient aussi des éléments propres aux humanités, mais ces études étaient dirigées vers des applications pratiques et spécifiques aux différents métiers. La différence entre »humanistes »et »professionnels »s’est élargie de plus en plus, au fur et à mesure que les premiers ont mis l’accent sur les études classiques et sur la recherche appliquée à d’autres cultures, séparant ainsi l’intérêt pour le genre humain et les choses humaines du cadre professionnel. Cette tendance continua à se développer jusqu’à investir des champs très éloignés de ce qui était accepté à l’époque comme « humanités » ; ce qui donna lieu à la grande révolution culturelle de la Renaissance.

En réalité, l’attitude humaniste avait commencé à se développer bien avant. Nous pouvons en retrouver la trace dans les sujets traités par les poètes goliards et par les écoles des cathédrales françaises du XIIe siècle. Cependant, le mot umanista, qui désignait un certain type d’étudiant, ne fut utilisé en Italie qu’en 1538. Sur ce point, je fais référence aux observations de A. Campana dans son article The Origin of the Word « Humanist », publié en1946. Je veux ici souligner que les premiers humanistes – ceux que je viens de mentionner ne se reconnaissaient pas eux-mêmes sous cette désignation ; celle-ci n’entrera en usage que beaucoup plus tard. Il faut également remarquer que des mots analogues comme humanistische (« humanistique »), selon les études de Walter Rüegg, commencent à être usités en 1784 tandis que humanismus (« humanisme ») ne commence à se répandre qu’à partir des travaux de Niethammer, en 1808.
C’est au milieu du XIXe siècle que le terme « humanisme » commence à circuler dans presque toutes les langues.
Par conséquent, nous sommes en train de parler de désignations récentes et d’interprétations de phénomènes qui furent certainement vécus par leurs protagonistes très différemment de ce que l’historiologie ou l’histoire de la culture du siècle dernier ont pu voir. Ce point ne me paraît pas inutile et je voulais l’approfondir, en considérant les significations que le mot « humanisme » a prises jusqu’à ce jour.
Si vous me permettez une digression, je dirai qu’actuellement nous nous trouvons encore en présence de ce substrat historique. En effet, des différences persistent entre les études « d’humanités » dispensées dans les facultés ou dans les instituts d’études humanistes et la simple attitude de personnes, définies non par leur profession mais par leur position vis-à-vis de l’humain comme préoccupation centrale. Aujourd’hui, quand quelqu’un se définit comme « humaniste », il ne le fait pas en référence à ses études « d’humanités » ; inversement, un étudiant en « humanités » ne se considère pas pour autant « humaniste ».
L’attitude « humaniste » est généralement comprise comme quelque chose de plus ample, presque totalisant, et bien au-delà des spécialités universitaires.
Dans le monde académique occidental, on s’attache à nom-mer « humanisme » le processus de transformation de la culture qui débuta en Italie – et particulièrement à Florence – entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle, et s’acheva à la Renaissance par son expansion à toute l’Europe. Ce courant apparut lié aux humanae litterae, écrits relatifs aux choses humaines, par opposition aux divinae litterae, qui mettaient l’accent sur les choses divines ; et c’est l’une des raisons pour lesquelles on appelle ses représentants « humanistes ». Selon cette interprétation, « l’humanisme »est, à l’origine, un phénomène littéraire qui cherche clairement à reprendre les apports de la culture gréco-latine, lesquels avaient été étouffés par la vision chrétienne médiévale.
On doit noter que l’apparition de ce phénomène ne résulta pas seulement de la modification endogène des facteurs économiques, sociaux et politiques de la société occidentale mais que celle-ci reçut également des influences transformatrices provenant d’autres milieux et civilisations. Le contact intense avec les cultures juive et musulmane ainsi que l’élargissement de l’horizon géographique firent partie d’un contexte qui stimula la préoccupation pour le genre humain et pour la découverte des choses humaines.
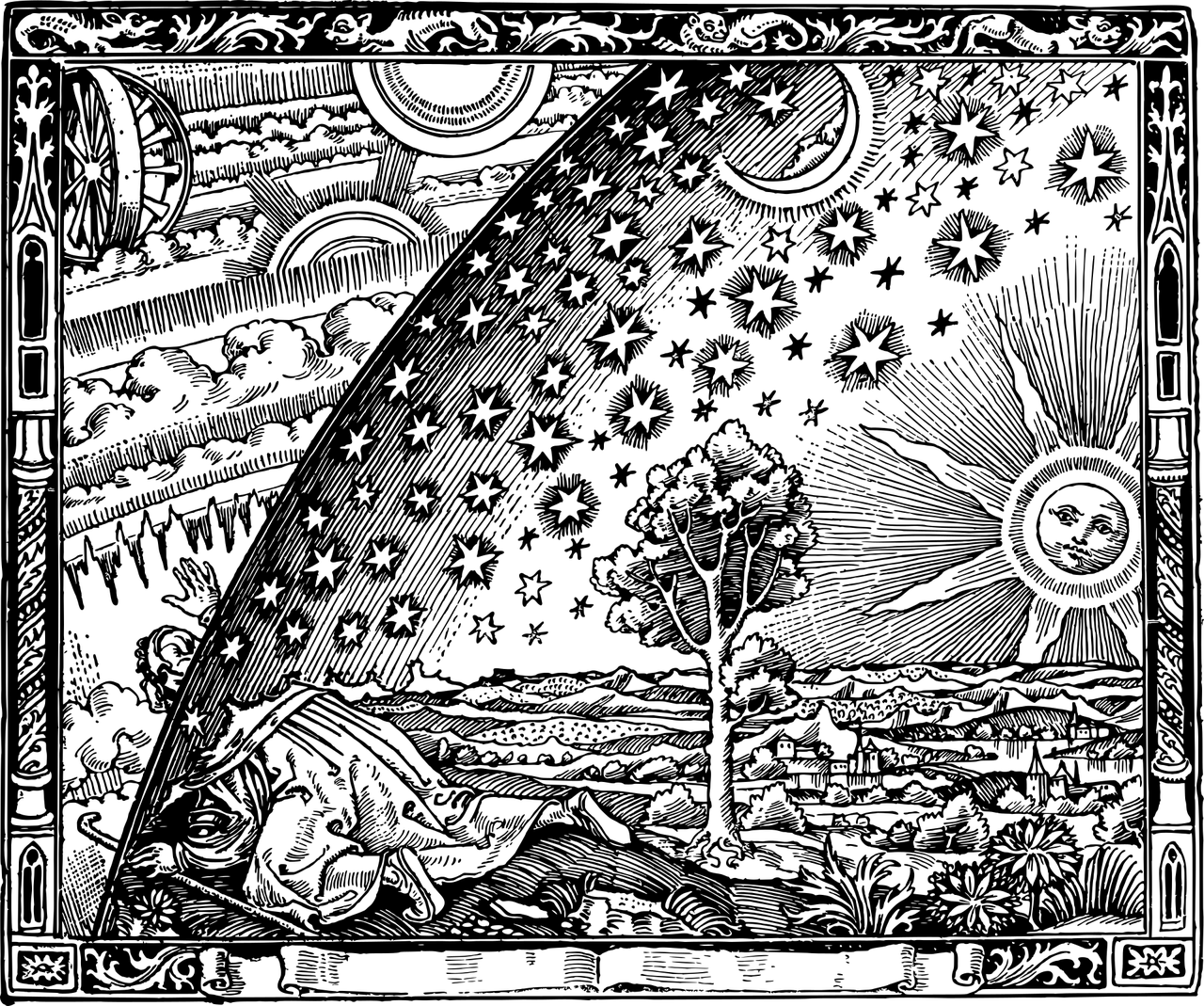
Dans ses Interprétations de l’Humanisme, Salvatore Puledda parvient à mon avis à expliquer que le monde européen médiéval pré-humaniste était un milieu fermé du point de vue temporel et physique, et que ce monde avait tendance à nier l’importance du contact effectif avec d’autres cultures. Du point de vue médiéval, l’Histoire est celle du péché et de la rédemption, et la connaissance d’autres civilisations non illuminées par la grâce de Dieu ne revêt pas grand intérêt. Le futur prépare simplement l’Apocalypse et le jugement de Dieu. La Terre est immobile et se trouve au centre de l’univers suivant la conception ptolémaïque. Tout est entouré d’étoiles fixes et les sphères planétaires tournent, animées par des puissances angéliques. Ce système s’achève dans l’Empyrée, siège de Dieu, moteur immobile qui met tout en mouvement. L’organisation sociale correspond à cette vision : une structure hiérarchique et héréditaire différencie les nobles des serfs ; au sommet de la pyramide se trouvent le Pape et l’Empereur, parfois alliés, parfois en lutte pour la prééminence hiérarchique. Le régime économique médiéval, au moins jusqu’au XIe siècle, est un système économique fermé où la consommation du produit s’effectue sur le lieu de production ; la circulation monétaire est rare, le commerce difficile et lent. L’Europe est une puissance occidentale fermée car la mer, comme voie de trafic, est entre les mains des Byzantins et des Arabes. Mais les voyages de Marco Polo et son contact avec les cultures et la technologie de l’Extrême-Orient, les centres d’enseignement d’Espagne à partir desquels les maîtres juifs, arabes et chrétiens irradient la connaissance, la recherche de nouvelles routes commerciales qui évitent les barrières du conflit byzantino-musulman, la formation d’une couche marchande de plus en plus active, la croissance d’une bourgeoisie urbaine de plus en plus puissante et le développement d’institutions politiques plus efficaces comme celle des seigneurs d’Italie, vont produire peu à peu un profond changement dans l’atmosphère sociale, et ce changement permettra le développement de l’attitude humaniste. On ne doit pas oublier que ce développement comporte beaucoup d’avancées et de reculs et ce, jusqu’à ce que la nouvelle attitude devienne consciente.
Cent ans après Pétrarque (1304-1374), la connaissance des classiques est dix fois plus importante que pendant les mille ans précédents. Pétrarque dirige sa recherche vers les anciens codex dans le but de corriger la mémoire déformée ; il amorce ainsi la tendance de la reconstruction du passé ainsi qu’un nouveau point de vue, bloqué par l’immobilisme de l’époque, sur le courant de l’Histoire. Dans son œuvre De Dignitae et Exellentia Hominis (De la Dignité et de l’Excellence des Hommes), Manetti – un des premiers humanistes – revendique l’être humain contre le Contemplu Mundi (le Mépris du Monde) prêché par le moine Lothaire, qui devint pape sous le nom d’Innocent III. Sur la base de ces idées, Lorenzo Valla attaque, dans son De Voluptate (Du plaisir), le concept éthique de la douleur alors en vigueur dans la société de son temps. Ainsi, pendant que survient le changement économique et alors que les structures sociales se modifient, les humanistes font prendre conscience de ce processus et génèrent une cascade de productions préfigurant ce courant humaniste qui dépassera l’enceinte culturelle et finira par mettre en question les structures du pouvoir alors aux mains de l’Église et du monarque.
De nombreux spécialistes ont mis l’accent sur l’apparition précoce, dans l’humanisme de la pré-Renaissance, d’une nouvelle image de l’être humain et de la personnalité humaine ; celle-ci se construit et s’exprime à travers l’action et, en ce sens, on accorde plus d’importance à la volonté qu’à l’intelligence spéculative. Par ailleurs, une nouvelle attitude face à la nature émerge : celle-ci n’est plus une simple création de Dieu et une vallée de larmes pour les mortels, mais le milieu de l’être humain et, dans certains cas, le siège et le corps de Dieu. Enfin, ce nouvel emplacement face à l’univers physique renforce l’étude des différents aspects du monde matériel, étude qui tend à expliquer ce monde comme un ensemble de forces immanentes ne nécessitant pas de concepts théologiques pour être comprises. On s’oriente alors clairement vers l’expérimentation et la maîtrise des lois naturelles. Le monde est désormais le royaume de l’homme et doit être dominé par la connaissance des sciences.

À ce propos, les érudits du XIXe siècle considéraient comme humanistes de nombreuses personnalités littéraires de la Renaissance telles Nicolas de Cuse, Rodolfo Agricola, Jean Reuchlin, Érasme, Thomas More, Jacques Lefevre, Charles Bouillé, Juan Vives, mais ils placèrent aussi à leur côté des personnalités comme Galilée et Léonard de Vinci.
On sait que de nombreuses idées mises en œuvre par les humanistes ont continué d’évoluer et ont fini par inspirer les encyclopédistes et les révolutionnaires du XVIIIe siècle. Mais, après les révolutions américaine et française, commence le déclin durant lequel l’attitude humaniste se trouvera étouffée. Pendant cette période, l’idéalisme critique, l’idéalisme absolu et le romantisme qui inspirent des philosophies politiques absolutistes, délaissent l’être humain comme valeur centrale pour le transformer en un épiphénomène d’autres puissances. Cette objétisation, ce « cela » au lieu d’un « tu » comme le souligne finement Martin Buber, s’installe au niveau planétaire. Mais les tragédies des deux guerres mondiales émeuvent profondément les sociétés et, face à l’absurde, la question de la signification de l’être humain resurgit. Elle devient présente dans ce qu’on appelle les « philosophies de l’existence ».
Je reviendrai sur la situation contemporaine de l’humanisme à la fin de cet exposé. Pour l’instant, je voudrais souligner quelques aspects fondamentaux de l’humanisme, dont l’attitude anti-discriminatoire et la tendance à l’universalité.
La question de la tolérance mutuelle et, au-delà, celle de la convergence, est très chère à l’humanisme. Aussi, je voudrais à nouveau vous rapporter les explications que fournit le Dr. Bauer dans sa conférence du 3 novembre 1994. Il dit :
« Dans la société féodale musulmane, et particulièrement en Espagne, la situation des Juifs était bien différente. On ne peut même pas parler de leur marginalisation sociale, pas plus que de celle des chrétiens. C’est seulement dans des cas exceptionnels que pouvaient surgir des tendances que nous appellerions aujourd’hui « fondamentalistes ». La religion dominante ne s’identifiait pas à l’ordre social comme elle le fit dans l’Europe chrétienne. On ne peut même pas parler de « division idéologique » car différents cultes existaient parallèlement et dans une tolérance mutuelle. Ils allaient tous ensemble à l’école ou dans les universités officielles, chose inconcevable dans la société médiévale chrétienne. Le grand Maïmonide était disciple et ami d’Ibn Rushd (Averroès) durant sa jeunesse. Et si les Juifs et Maïmonide lui-même subirent plus tard des pressions et des persécutions de la part des fanatiques d’origine africaine qui s’étaient emparés du pouvoir en Andalousie (Al-Andalous), le philosophe arabe, qui était pour eux un hérétique, ne leur échappa pas non plus.
« Dans une telle atmosphère, un humanisme ample et profond, venant tout aussi bien des musulmans que des juifs, pouvait surgir. […] En Italie, la situation était similaire non seulement durant le bref empire de l’Islam sur la Sicile, mais aussi après, et pendant longtemps, lorsqu’elle était sous la domination directe de la papauté. Un monarque d’origine allemande, l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen, qui résidait en Sicile et était lui-même un poète, eut l’audace de proclamer que son régime avait une racine idéologique tripartite : chrétienne, juive et musulmane ; il eut aussi l’audace d’établir, à travers cette dernière, la continuité avec la philosophie classique grecque. »
Repérer l’humanisme dans les cultures juive et arabe ne présente donc aucune difficulté majeure. Je voudrais seulement rapporter quelques observations que l’académicien russe Arthur Sagadeev fit sur « l’humanisme dans la pensée classique musulmane », lors de la conférence qui eut lieu à Moscou en novembre de l’année dernière. Il souligne :
« L’infrastructure de l’humanisme dans le monde musulman était déterminée par le développement des villes et par la culture citadine. Les chiffres qui suivent permettent d’évaluer le degré d’urbanisation de ce monde : dans les trois plus grandes villes de Savad, en Mésopotamie du Sud, et dans les deux plus grandes villes d’Égypte, vivaient près de 20% de la population. Avec une population de plus de cent mille habitants chacune, la Mésopotamie et l’Égypte des VIIIe et Xe siècles comptaient un pourcentage de citadins supérieur à celui des pays d’Europe occidentale au XIXe siècle, comme les Pays-Bas, l’Angleterre, le Pays de Galles ou la France. Selon des calculs très méticuleux, Bagdad rassemblait à cette époque quatre cent mille habitants ; la population de villes comme Fustat (appelée ensuite Le Caire), Cordoue, Alexandrie, Kufa et Basra était de cent mille à deux cent cinquante mille habitants chacune. La concentration dans les villes, qui s’étaient enrichies grâce au commerce et aux impôts, détermina l’apparition au Moyen Âge d’une couche d’intellectuels relativement nombreux ; celle-ci permit une dynamisation de la vie spirituelle ainsi que la prospérité de la Science, de la Littérature et de l’Art. L’être humain était le centre d’intérêt en tant que genre humain et en tant que personnalité unique. Il faut signaler que le monde musulman médiéval n’a pas connu de division entre culture urbaine et culture à orientations axiologiques. En Europe, en revanche, cette division a existé entre les habitants des villes et ceux des monastères et châteaux féodaux. Dans le monde musulman, les représentants de l’éducation théologique et les groupes sociaux comparables aux féodaux d’Europe vivaient dans les villes et expérimentaient la puissante influence de la culture formée chez les habitants urbains fortunés des villes musulmanes.
« Ces habitants aimaient imiter un groupe de référence, incarnation des traits fondamentaux d’une personnalité illustre et bien éduquée. Les Adibs, personnes très concernées par les aspects humanitaires, possédant des connaissances et une haute morale, formaient ce groupe de référence. L’Adab, c’est-à-dire l’ensemble des qualités propres à l’Adib, reposait sur des idéaux de conduite citadine, courtoise, raffinée, pleine d’humour ; il était, par sa fonction intellectuelle et morale, synonyme du mot grec paideia et du mot latin humanitas. Les Adibs incarnaient non seulement des idéaux d’humanisme, mais ils étaient aussi des propagateurs d’idées humanistes, parfois exprimées sous la forme de sentences lapidaires : « L’homme est un problème pour l’homme » ; « Pour celui qui traverse notre mer, il n’existe pas d’autre rivage que lui-même ». L’insistance mise sur le caractère terrestre du destin humain est typique pour l’Adib ; elle le conduisait parfois au scepticisme religieux ; ainsi, apparaissent, parmi ses représentants, des gens à la mode qui montraient ostensiblement leur athéisme. Le mot Adab désignait initialement les caractéristiques propres aux bédouins. Ce mot acquit l’idée de perfection humaniste grâce au Califat qui devint, pour la première fois depuis Alexandre le Grand, le centre d’échanges entre les différentes traditions culturelles et entre les divers groupes confessionnels qui unissaient alors la Méditerranée au monde irano-indien.
« Dans la période de prospérité de la culture musulmane médiévale, l’Adab exigeait d’une part de connaître la philosophie hellénique ancienne, d’autre part d’assimiler les programmes d’éducation élaborés par les scientifiques grecs. Les musulmans disposaient d’énormes moyens pour la réalisation de ces programmes. Rappelons seulement que, selon le calcul des spécialistes, Cordoue comptait plus de livres que toute l’Europe, Al-Andalous exceptée. La transformation du Califat en centre d’influences interculturelles et en mélange de divers groupes ethniques contribua à la formation d’un nouveau trait de l’humanisme : l’universalisme en tant qu’idée de l’unité du genre humain. En pratique, cette idée correspondait à l’extension des terres habitées par les musulmans, du nord au sud, de la Volga jusqu’à Madagascar, et de l’Occident à l’Orient, de la côte atlantique de l’Afrique jusqu’à la côte pacifique de l’Asie.

« Même si l’empire musulman s’est désintégré au fil du temps et bien que les petits états formés sur ses ruines aient été comparés aux possessions des successeurs d’Alexandre le Grand, les fidèles de l’Islam vivaient unis par une seule religion, une seule langue littéraire, une seule loi, une seule culture ; dans la vie quotidienne, ils communiquaient et échangeaient avec les valeurs culturelles de groupes confessionnels très variés. L’esprit de l’universalisme dominait dans les cercles scientifiques, dans les réunions (« Madjalis ») qui réunissaient des musulmans, des chrétiens, des juifs et des athées de diverses régions du monde musulman, partageant des intérêts intellectuels communs. « L’idéologie de l’amitié » les unissait, comme elle avait déjà uni auparavant les écoles philosophiques de l’Antiquité, telles les écoles des stoïques, des épicuriens, des néoplatoniciens, etc., et il en fut de même pendant la Renaissance italienne avec le cercle de Marsile Ficin. Sur le plan théorique, les principes de l’universalisme étaient déjà élaborés par Kalam ; ils se transformèrent ensuite selon la conception du monde des philosophes rationalistes aussi bien que des mystiques soufis. Dans les discussions organisées par les théologiens Mutakallimies (les Maîtres de l’Islam), qui rassemblaient des participants de différentes confessions, il était dans la norme d’argumenter sur l’authenticité des thèses de chacun, non pas en se référant aux textes sacrés – sans fondement pour les représentants des autres religions – mais en s’appuyant exclusivement sur la raison humaine. »
La lecture que je viens de faire de la contribution de Sagadeev ne reflète pas la richesse descriptive qu’il fait des coutumes, de la vie quotidienne, de l’art, de la religiosité, du droit et de l’activité économique du monde musulman à l’époque de sa splendeur humaniste. Je voudrais maintenant parler du travail d’un autre académicien russe, spécialiste des cultures d’Amérique, le professeur Serguei Semenov. Dans sa monographie parue en août de cette année et intitulée Traditions et innovations humanistes dans le monde ibéro-américain, Serguei Semenov effectue une mise au point totalement novatrice qui retrace l’attitude humaniste dans les grandes cultures de l’Amérique précolombienne.
Je lui laisse la parole :
« On peut parler des tendances humanistes dans le monde ibéro-américain avant tout à travers l’analyse de la production d’œuvres artistiques, de l’œuvre des masses et de l’œuvre professionnelle qui se manifeste dans les monuments de la culture et est gravée dans la mémoire du peuple.
« Interdisciplinaire, cette optique d’analyse des manifestations concrètes de l’humanisme offre de nombreuses possibilités d’application au monde ibéro-américain, pluraliste par excellence et incarnant une synthèse culturelle de ce qui se produisait des deux côtés de l’Atlantique, sur quatre continents.
« Évidemment, les principes de ce monde se différenciaient beaucoup des traditions du monde eurasiatique, mais ils se rapprochaient de l’unité de principe de tous les êtres humains, universellement reconnue, indépendamment de leur appartenance tribale ou sociale. Nous constatons ces notions d’humanisme en Mésoamérique et en Amérique du Sud dans la période précolombienne.
« Dans le premier cas, il s’agit du mythe de Quetzalcoatl, dans le deuxième, de la légende de Viracocha, deux divinités qui rejetaient les sacrifices humains communément pratiqués sur des prisonniers de guerre appartenant à d’autres tribus. Avant la conquête espagnole, les sacrifices humains étaient fréquents en Mésoamérique.
« Cependant, les mythes et les légendes indigènes, les chroniques espagnoles et les vestiges des monuments démontrent que le culte de Quetzalcoatl, apparu dans les années 1200-1100 avant notre ère, est relié dans la conscience des peuples de cette région à la lutte contre les sacrifices humains et à l’affirmation d’autres normes morales condamnant l’assassinat, le vol et les guerres. Selon une série de légendes, Topiltzin – le gouverneur toltèque de la ville de Tula qui vécut au Xe siècle de notre ère et adopta le nom de Quetzalcoatl – avait les traits d’un héros culturel. Selon ces légendes, il enseigna l’orfèvrerie aux habitants de Tula, interdit la pratique des immolations humaines et animales, n’autorisant que les fleurs, le pain et les parfums comme offrandes aux dieux. Topiltzin condamnait l’assassinat, les guerres et le vol. Selon la légende, il avait l’aspect d’un homme blanc, non pas blond mais brun. Certains racontent qu’il partit en mer ; d’autres qu’il s’enflamma en une lueur montant au ciel, laissant l’étoile du berger comme espoir de son retour. On attribue à ce héros l’instauration du style de vie humaniste en Mésoamérique, dénommé « toltecayotl » ; ce style de vie fut intégré non seulement par les Toltèques mais aussi par les peuples voisins, héritiers de cette tradition. Fondé sur des principes de fraternité entre tous les êtres humains, de perfectionnement, de vénération du travail, d’honnêteté, de fidélité à la parole, d’étude des secrets de la nature, il était guidé par une vision optimiste du monde.
« Les légendes des peuples mayas de la même époque témoignent de l’activité du gouverneur – et peut-être prêtre – de la ville de Chichen-Itza. Fondateur de la ville de Mayapan et appelé Kukulkan, celui-ci était pour les Mayas ce que Quetzalcoatl était pour les Toltèques.
« Le gouverneur de la ville de Texcoco, Netzahualcoyotl – qui fut philosophe et poète et vécut de 1402 à 1472 – fut un autre représentant de la tendance humaniste en Mésoamérique. Lui aussi rejetait les sacrifices humains, chantait l’amitié entre les êtres et exerça une profonde influence sur la culture des peuples du Mexique.
« En Amérique du Sud, nous observons un mouvement similaire au début du XVe siècle. Ce mouvement est associé aux noms d’Inca Cuzi Yupanqui – qui reçut le nom de Pachacutec, le « réformateur » – et de son fils Tupac Yupanqui ; il est également relié à l’expansion du culte du dieu Viracocha. Comme en Mésoamérique, Pachacutec assuma, à l’instar de son père Ripa Yupanqui, le titre de dieu et prit le nom de Viracocha. Les normes morales régissant officiellement la société de Tahuantinsuyo étaient liées au culte de ce dieu et aux réformes de Pachacutec qui, comme Topiltzin, avait les traits de héros culturel. »
Cette citation est extraite d’un travail évidemment bien plus étendu et bien plus riche.
À travers la lecture de ces deux documents, j’ai voulu rapprocher des témoignages sur ce que nous appelons « attitude humaniste » dans des régions très éloignées l’une de l’autre ; et bien sûr, nous pouvons rencontrer cette attitude à des époques précises dans diverses cultures. Je dis « à des époques précises » car une telle attitude semble reculer et avancer, tout au long de l’Histoire, par intermittence et ce, jusqu’à disparaître définitivement, dans les moments sans retour qui précèdent l’effondrement d’une civilisation. On comprendra qu’établir des liens entre des civilisations à travers leurs « moments » humanistes est une œuvre considérable et de grande portée. Actuellement, les groupes ethniques et religieux se replient sur eux-mêmes pour parvenir à une identité forte ; ainsi, une sorte de chauvinisme culturel ou régional s’instaure, dans lequel ces groupes menacent de se heurter à d’autres ethnies, cultures ou religions. Mais si chacun aime légitimement son peuple et sa culture, il peut aussi com-prendre que, dans ce peuple et dans les racines de ce peuple, il a existé ou il existe encore ce moment humaniste qui le rend, par définition, universel et semblable à celui qu’il affronte. Il s’agit donc de diversités qui ne pourront être balayées par les unes ou par les autres. Il s’agit de diversités qui ne sont pas un obstacle, ni un défaut, ni un retard, mais qui constituent la richesse même de l’humanité. En réalité, le problème ne se situe pas là, mais dans la convergence possible de telles diversités ; c’est à ce « moment humaniste » que je fais allusion lorsque je fais référence aux points de convergence.

Pour finir, je voudrais revenir à la question de l’humanisme dans le moment actuel. Nous disions que les philosophes de l’existence réouvrirent le débat sur un thème qui, après les deux catastrophes mondiales, paraissait mort. Ce débat commença par considérer l’humanisme comme une philosophie, alors qu’en réalité, celui-ci ne fut jamais une posture philosophique mais une perspective et une attitude face à la vie et aux choses. Si, dans le débat, la description de l’humanisme du XIXe siècle fut considérée comme acquise, il ne faut donc pas s’étonner que des penseurs comme Foucault aient accusé l’humanisme d’être un produit typique de ce siècle. Précédemment, Heidegger avait déjà exprimé son antihumanisme dans sa Lettre sur l’Humanisme, considérant celui-ci comme une « métaphysique » de plus. La discussion fut peut-être fondée sur la position de l’existentialisme sartrien qui posa la question en termes philosophiques. Si l’on regarde ces choses depuis la perspective actuelle, il nous paraît excessif d’accepter l’interprétation d’un fait comme le fait lui-même, et partant de là de lui attribuer ces caractéristiques déterminées.
Althusser, Lévy-Strauss et de nombreux structuralistes ont déclaré, dans leurs œuvres, leur antihumanisme ; d’autres ont défendu l’humanisme comme une métaphysique ou comme une anthropologie.
En réalité, l’humanisme historique occidental ne fut en aucun cas une philosophie, ni chez Pic de la Mirandole, ni chez Marsile Ficin. Que de nombreux philosophes aient partagé l’attitude humaniste n’implique pas que celle-ci soit une philosophie. D’autre part, si l’humanisme de la Renaissance s’intéressa aux thèmes de la « philosophie morale », on doit comprendre cette préoccupation comme un effort de plus pour démonter le système de manipulation exercé dans ce domaine par la philosophie scolastique médiévale. À partir de ces erreurs dans l’interprétation de l’humanisme, considéré comme une philosophie, il est facile d’en arriver à des positions naturalistes, comme celles qui s’exprimèrent dans le Humanist Manifesto de 1933, ou à des positions socio-libérales, comme dans le Humanist Manifesto II de 1974. Ainsi, des auteurs comme Lamont ont défini leur humanisme comme naturaliste et anti-idéaliste, affirmant le refus du surnaturel, l’évolutionnisme radical, l’inexistence de l’âme, l’autosuffisance de l’homme, la liberté de la volonté, l’éthique intramondaine, la valeur de l’art et l’humanitarisme. Je crois qu’ils ont le droit de définir ainsi leurs conceptions, mais il me paraît excessif de soutenir que l’humanisme historique s’est mû à l’intérieur de ces horizons. D’autre part, je pense que la prolifération « d’humanismes » durant ces dernières années est tout à fait légitime s’ils se présentent comme des particularités et sans la prétention d’absolutiser l’humanisme en général. Enfin, je crois aussi que l’humanisme est actuellement en condition de devenir une philosophie, une morale, un instrument d’action et un style de vie.
La discussion philosophique avec les idées d’un humanisme historique et, de surcroît, fort localisé, a été mal posée. Mais maintenant le nouveau débat commence. Les objections de l’antihumanisme devront être justifiées devant ce que propose aujourd’hui le Nouvel Humanisme universaliste.
Nous devons reconnaître que toutes les discussions précédentes ont été quel que peu provinciales ; nous devons également reconnaître que depuis trop longtemps perdure l’idée selon laquelle l’humanisme naît dans un point géographique, se discute dans ce point et veut éventuellement s’exporter dans le monde avec ce point pour modèle. Nous concédons seulement que le copyright, le monopole du mot « humanisme » s’inscrit dans une aire géographique. Finalement, nous avons parlé de l’humanisme occidental, européen et, dans une certaine mesure, cicéronien.

Nous avons soutenu que l’humanisme n’a jamais été une philosophie mais une perspective et une attitude face à la vie. Ne pourrions-nous pas étendre notre recherche à d’autres régions et reconnaître que cette attitude s’y manifesta de manière semblable ? En figeant l’humanisme historique en une philosophie qui, de surcroît, ne serait spécifique qu’à l’Occident, non seulement nous nous égarons, mais nous plaçons une barrière infranchissable qui empêche d’instaurer le dialogue avec les attitudes humanistes de toutes les cultures de la Terre. Je me permets d’insister sur ce point à cause des conséquences théoriques qu’ont eu et qu’ont encore les positions dont j’ai parlé, mais aussi en raison de leurs conséquences pratiques et immédiates.
L’humanisme historique croyait fortement que la connaissance et le maniement des lois naturelles amèneraient à la libération de l’humanité ; on croyait qu’une telle connaissance se trouvait dans différentes cultures et qu’il fallait apprendre de toutes. Mais aujourd’hui, nous voyons qu’il existe une manipulation du savoir, de la connaissance, de la Science et de la technologie ; nous voyons que cette connaissance a souvent servi d’instrument de domination. Le monde a changé et notre expérience s’est accrue. Certains crurent que la religiosité abrutissait la conscience et, pour imposer paternellement la liberté, ils s’attaquèrent aux religions. Aujourd’hui, de violentes réactions se manifestent et, par ces actes violents, les cultures tentent d’imposer leurs valeurs sans respecter la diversité. Le monde a changé et notre expérience s’est accrue.
Aujourd’hui, face à la submersion de la raison, face à la croissance du symptôme néo-irrationnaliste qui semble nous envahir, on entend encore les échos d’un rationalisme primitif dans lequel furent éduquées plusieurs générations.
Beaucoup semblent dire : « Nous avions raison de vouloir en finir avec les religions car, si nous y étions parvenus, il n’y aurait pas aujourd’hui de luttes religieuses ; nous avions raison d’essayer de nous débarrasser de la diversité car, si nous avions réussi, le feu de la lutte interethnique et culturelle ne se serait pas déclaré ! » Mais ces rationalistes n’ont pas réussi à imposer leur culte philosophique unique, ni leur style de vie unique, ni leur culture unique ; et c’est cela qui compte. Ce qui compte, c’est surtout la discussion pour résoudre les sérieux conflits qui se développent aujourd’hui. Combien de temps faudra-t-il pour comprendre qu’une culture et ses schémas intellectuels ou comportementaux ne sont pas les modèles que doit suivre l’ensemble de l’humanité ? Je dis cela car il est peut-être temps de réfléchir sérieusement au changement du monde et de nous-mêmes. Il est facile de prétendre que les autres doivent changer ; seulement, les autres pensent la même chose. N’est-ce donc pas l’heure de commencer à reconnaître « l’autre », la diversité du « tu » ?
Je crois que le thème du changement du monde se pose aujourd’hui avec plus d’urgence que jamais ; mais, pour être positif, ce changement doit aller de pair avec le changement personnel. Après tout, ma vie a un sens si je veux la vivre, si je peux choisir les conditions de mon existence et de la vie en général ou lutter pour ces conditions. Cet antagonisme entre le personnel et le social n’a pas donné de bons résultats. Il faudra observer si la relation convergente entre ces deux termes n’a pas plus de sens. Cet antagonisme entre les cultures ne nous amène pas dans la bonne direction. La nécessité s’impose alors de considérer à nouveau cette affirmation mille fois exprimée, qui proclame la reconnaissance de la diversité culturelle ; il est également nécessaire d’étudier la possibilité d’une convergence menant vers une nation humaine universelle.
Enfin, les défauts attribués aux humanistes des différentes époques sont nombreux. On a dit que Machiavel était un humaniste qui essayait de comprendre les lois régissant le pouvoir ; que Galilée montrait une sorte de faiblesse morale face à la barbarie de l’Inquisition ; que Léonard de Vinci comptait parmi ses inventions des machines de guerre avancées, dessinées pour le Prince. Et de la même manière, on a affirmé que beaucoup d’écrivains, de penseurs et de scientifiques contemporains ont aussi montré quelques faiblesses. Dans tout cela, il y a sans doute des vérités ; mais nous devons être justes dans notre appréciation des faits. Einstein n’eut rien à voir avec la fabrication de la bombe atomique ; son mérite est d’avoir conçu la production de la cellule photoélectrique grâce à laquelle on a tant développé l’industrie, cinéma et télévision inclus ; mais son génie se manifesta par-dessus tout dans l’affirmation d’une grande théorie absolue : la théorie de la Relativité. Et Einstein n’eut pas de faiblesse morale face à la nouvelle Inquisition. Oppenheimer non plus, à qui l’on présenta le projet Manhattan comme consistant en la construction d’un engin qui mettrait fin au conflit mondial, une arme uniquement dissuasive et qui ne serait jamais utilisée contre les êtres humains. Oppenheimer fut vilement trahi, alors il éleva la voix en appelant avec force la conscience morale des scientifiques. De ce fait, il fut destitué et persécuté par le maccarthysme.
Ainsi, les nombreux « défauts de morale » attribués aux personnes ayant une attitude humaniste n’ont rien à voir avec leur position face à la société ou à la Science, mais avec leur qualité d’être humain confronté à la douleur et à la souffrance. Si, par sa force morale, la figure de Giordano Bruno, qui fut confronté au martyre, apparaît par conséquence comme le paradigme de l’humanisme classique, nos contemporains Einstein et Oppenheimer peuvent tout autant être considérés avec justesse comme humanistes à part entière. Et pourquoi, bien que se situant au-delà du champ de la Science, ne devrions-nous pas considérer Tolstoï, Gandhi et Luther King comme des génies humanistes ? Schweitzer n’est-il pas un humaniste ? Je suis sûr que des millions de personnes dans le monde entier soutiennent une attitude humaniste face à la vie. Je ne cite que quelques personnalités car elles sont reconnues par tous comme des modèles de la position humaniste. Je sais que ces individus sont critiquables pour certaines conduites, ponctuellement pour des procédés, et pour leur opportunisme ; mais nous ne pouvons nier leur engagement en faveur des autres êtres humains. De toute façon, nous ne sommes pas ici pour pontifier sur qui est ou n’est pas humaniste, mais pour donner notre opinion sur l’humanisme, dans des limites imparties. Cependant, si quelqu’un exigeait de nous une définition de l’attitude humaniste dans le moment actuel, nous lui répondrions en peu de mots :
« Est humaniste celui qui lutte contre la discrimination et la violence en proposant des issues qui permettent à l’être humain de manifester sa liberté de choix. »
Je vous remercie de votre attention.
Cette conférence se trouve dans le livre ‘Silo parle’ : https://www.editions-references.com/catalogue.html
Crédits images : Pixabay.










