Le fait que le conflit israélo-palestinien se poursuive sans qu’il y ait la moindre solution peut sembler assez étrange. Pour de nombreux conflits dans le monde, on a du mal à imaginer un règlement réaliste. Dans le cas présent, non seulement celui-ci est possible, mais ses contours essentiels recueillent un assentiment quasi universel : un règlement à deux États sur la base des frontières internationalement reconnues (avant juin 1967) – avec quelques « modifications minimes et réciproques », pour reprendre la terminologie officielle des États-Unis avant que Washington ne se retire de la communauté internationale au milieu des années soixante-dix.
Texte écrit par Noam Chomsky en 2010. Il a été republié par TomDispatch.com récemment dans la catégorie « meilleurs articles ».
La quasi totalité du monde a accepté ces principes de base, y compris les États arabes (qui appellent à une normalisation totale des relations), l’Organisation des États islamiques (y compris l’Iran) et les acteurs non étatiques concernés (y compris le Hamas). Un règlement en ce sens a été proposé pour la première fois au Conseil de sécurité des Nations unies en janvier 1976 par les principaux États arabes. Israël a refusé de participer à la session. Les États-Unis ont opposé leur veto à la résolution, et l’ont fait à nouveau en 1980. Depuis, le résultat à l’Assemblée générale reste le même.
Il y a eu une rupture importante et révélatrice dans le rejet américano-israélien. Après l’échec des accords de Camp David en 2000, le président Clinton a reconnu que les conditions que lui-même et Israël imposaient étaient inacceptables pour les Palestiniens. En décembre de cette année là, il a présenté ses « paramètres » : peu précis, mais plus généreux. Il a ensuite déclaré que les deux parties les avaient acceptés, tout en exprimant des réserves.
Les négociateurs israéliens et palestiniens se sont rencontrés à Taba, en Égypte, en janvier 2001, pour résoudre les différends et ont fait des progrès considérables. Lors de leur conférence de presse de conclusion, ils ont déclaré qu’avec un peu plus de temps, ils auraient probablement pu parvenir à un accord intégral. Israël a toutefois mis fin prématurément aux négociations et les progrès réalisés ont été officiellement interrompus, même si des discussions informelles à un haut niveau se sont poursuivies et ont abouti à l’accord de Genève, rejeté par Israël et ignoré par les États-Unis.
Bien des choses se sont passées depuis, mais un règlement en ce sens ne semble pas hors de portée – à condition bien sûr, que Washington soit à nouveau disposé à l’accepter. Malheureusement, il n’y a guère de signes en ce sens.
Il existe une véritable légende autour de ce dossier, mais les éléments factuels sont tout à fait clairs et relativement bien documentés.
Les États-Unis et Israël ont agi de concert pour accroître et renforcer l’occupation. En 2005, reconnaissant qu’il était inutile de soutenir financièrement quelques milliers de colons israéliens à Gaza, lesquels mobilisaient des ressources considérables et étaient protégés par une grande partie de l’armée israélienne, le gouvernement d’Ariel Sharon a décidé de les déplacer vers la Cisjordanie et le plateau du Golan, dont le potentiel est nettement plus précieux.
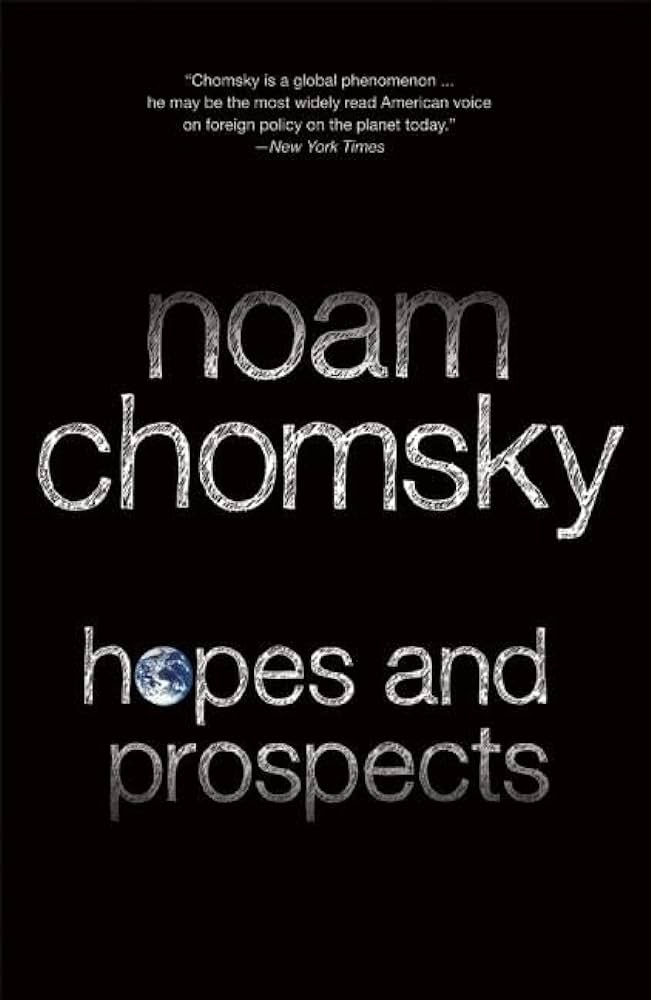 Au lieu de mener l’opération de manière directe, ce qui aurait été assez facile, le gouvernement a décidé de mettre en scène un « traumatisme national », qui a été pratiquement la reproduction de la farce qui avait accompagné le retrait du désert du Sinaï après les accords de Camp David de 1978-79. Dans chacune de ces occasions, le retrait a permis de clamer : « Plus jamais ça », ce qui en pratique voulait dire : impossible pour nous d’abandonner un seul pouce des territoires palestiniens dont nous voulons nous emparer en violation du droit international. Cette comédie a remporté un franc succès en Occident, tout en étant tournée en ridicule par des commentateurs israéliens plus avisés, parmi lesquels l’éminent sociologue israélien Baruch Kimmerling, aujourd’hui décédé.
Au lieu de mener l’opération de manière directe, ce qui aurait été assez facile, le gouvernement a décidé de mettre en scène un « traumatisme national », qui a été pratiquement la reproduction de la farce qui avait accompagné le retrait du désert du Sinaï après les accords de Camp David de 1978-79. Dans chacune de ces occasions, le retrait a permis de clamer : « Plus jamais ça », ce qui en pratique voulait dire : impossible pour nous d’abandonner un seul pouce des territoires palestiniens dont nous voulons nous emparer en violation du droit international. Cette comédie a remporté un franc succès en Occident, tout en étant tournée en ridicule par des commentateurs israéliens plus avisés, parmi lesquels l’éminent sociologue israélien Baruch Kimmerling, aujourd’hui décédé.
Après son retrait effectif de la bande de Gaza, Israël n’a jamais réellement renoncé à exercer un contrôle total sur ce territoire, souvent décrit avec réalisme comme « la plus grande prison du monde ». En janvier 2006, quelques mois après le retrait, la Palestine a organisé des élections reconnues comme libres et équitables par les observateurs internationaux. Les Palestiniens ont cependant voté « de travers », en élisant le Hamas. Immédiatement, les États-Unis et Israël ont intensifié leurs attaques contre les habitants de Gaza pour les punir de ce mauvais choix. Ni la réalité des faits ni la logique qui les sous-tendait n’ont été dissimulées ; au contraire, elles ont été publiées ouvertement, accompagnées de commentaires élogieux sur l’engagement sincère de Washington en faveur de la démocratie. Depuis lors, les attaques israéliennes contre les habitants de Gaza, soutenues par les États-Unis, n’ont fait que s’intensifier, devenant de plus en plus féroces du fait de leur violence et de l’étranglement économique.
Pendant ce temps, en Cisjordanie, toujours avec le plein soutien des États-Unis, Israël poursuit depuis longtemps ses programmes destinés à s’approprier les terres et ressources de grande valeur des Palestiniens et à les cantonner dans des zones difficilement vivables, la plupart du temps à l’abri des regards. Les commentateurs israéliens qualifient ouvertement ces objectifs de « néocoloniaux ». Ariel Sharon, le principal architecte des programmes de colonisation, a qualifié ces cantons de « bantoustan », bien que ce terme soit impropre : L’Afrique du Sud avait besoin d’une main-d’œuvre majoritairement noire, tandis qu’Israël serait ravi que les Palestiniens disparaissent, et ses politiques sont orientées dans ce sens.
Blocus terrestre et maritime de Gaza
Séparer Gaza de la Cisjordanie constitue une étape vers la cantonalisation et compromet les espoirs de survie de la nation palestinienne. Les Palestiniens ont été pratiquement jetés aux oubliettes, une atrocité que nous ne devrions pas cautionner par un consentement tacite. La journaliste israélienne Amira Hass, l’une des plus grandes spécialistes de Gaza, écrit que :
« Les restrictions à la circulation des Palestiniens introduites par Israël en janvier 1991 ont inversé un processus initié en juin 1967. À l’époque, et pour la première fois depuis 1948, une grande partie du peuple palestinien vivait à nouveau sur le territoire d’un seul pays – certes occupé, mais néanmoins entier… La séparation totale de la bande de Gaza et de la Cisjordanie est l’une des plus grandes réussites de la politique israélienne, l’objectif primordial en étant d’empêcher une solution fondée sur des décisions et des accords internationaux et d’imposer à la place un dispositif s’appuyant sur la supériorité militaire d’Israël…
« Depuis janvier 1991, la bureaucratie et la logistique israéliennes n’ont fait que peaufiner la division et la séparation : non seulement entre les Palestiniens des territoires occupés et leurs frères d’Israël, mais aussi entre les résidents palestiniens de Jérusalem et ceux du reste des territoires, et entre les Gazaouis et les Cisjordaniens/Jérusalémites. Les Juifs vivent sur ce même lopin de terre et bénéficient d’un système supérieur et distinct de privilèges, de lois, de services, d’infrastructures matérielles et de liberté de circulation. »
La plus grande spécialiste universitaire de Gaza, Sara Roy, chercheuse à Harvard, ajoute :
« Gaza est le parfait exemple d’une société délibérément réduite à un état de dénuement abject, sa population autrefois productive a été transformée en une population d’indigents tributaires d’aides […] L’asservissement de Gaza a commencé bien avant la récente guerre menée par Israël [décembre 2008]. L’occupation israélienne – aujourd’hui largement oubliée ou niée par la communauté internationale – a dévasté l’économie et la population de Gaza, tout particulièrement depuis 2006 […] Après l’assaut israélien de décembre [2008], la situation déjà précaire de Gaza est devenue pratiquement invivable. Les moyens de subsistance, les habitations et les infrastructures publiques ont été endommagés ou détruits à une échelle que même les Forces de défense israéliennes ont reconnue comme indéfendable.
« Aujourd’hui, à Gaza, il n’y a pas de secteur privé à proprement parler, pas plus que d’industrie. 80 % des récoltes agricoles de Gaza ont été détruites et Israël continue de s’en prendre aux agriculteurs qui tentent de planter et d’entretenir des champs près de la frontière dûment clôturée et surveillée par des patrouilles. La plupart des activités productives ont été réduites à néant […] Aujourd’hui, 96 % des 1,4 million d’habitants de Gaza dépendent de l’aide humanitaire pour subvenir à leurs besoins vitaux. Selon le Programme alimentaire mondial, la bande de Gaza a besoin d’un minimum de 400 camions de nourriture par jour pour ne serait-ce que répondre aux besoins nutritionnels de base de la population. Pourtant, malgré une décision prise le 22 mars [2009] par le cabinet israélien de lever toutes les restrictions sur les denrées alimentaires entrant dans la bande de Gaza, seuls 653 camions de nourriture et d’autres fournitures ont été autorisés à entrer dans la semaine du 10 mai, répondant au mieux à 23 % des besoins. Israël n’autorise aujourd’hui que 30 à 40 produits commerciaux à entrer à Gaza, contre 4 000 produits approuvés avant juin 2006. »
On ne saurait trop insister sur le fait qu’Israël, de 2008 à 2009, n’avait aucun prétexte crédible pour attaquer Gaza, toujours avec le soutien total des États-Unis et en utilisant illégalement des armes américaines. Pratiquement tous affirment le contraire et prétendent qu’Israël a agi en état de légitime défense. C’est une hypothèse qui ne tient absolument pas la route, à la lumière du refus catégorique d’Israël d’utiliser des moyens pacifiques pourtant aisément disponibles, comme le savaient très bien Israël et son partenaire américain dans le crime. Cela mis à part, le siège israélien de Gaza est en lui-même un acte de guerre, comme Israël ne manque pas de le reconnaître, ayant à maintes reprises légitimé le lancement de guerres majeures en raison de restrictions partielles de son accès au monde extérieur, même si rien ne ressemble de près ou de loin à ce qui est imposé depuis longtemps à Gaza.
Le blocus naval est un des principaux volets du siège criminel d’Israël, dont on parle peu. Depuis Gaza, Peter Beaumont rapporte : « Sur son littoral, les frontières de Gaza sont délimitées par une clôture différente dont les barreaux sont des canonnières israéliennes et leurs gigantesques sillages, qui frôlent les bateaux de pêche palestiniens et les empêchent de sortir d’une zone qui leur est imposée par les navires de guerre. » Selon les informations recueillies sur place, le siège naval n’a cessé de se renforcer depuis 2000. Les canonnières israéliennes ont régulièrement chassé les bateaux de pêche vers le rivage, sans respecter les eaux territoriales de Gaza et ce, souvent de manière violente, sans sommation, faisant de nombreuses victimes. En raison de ces opérations, l’industrie de la pêche de Gaza s’est pratiquement effondrée ; la pêche est impossible près du rivage en raison de la contamination causée par les attaques régulières d’Israël, y compris la destruction des centrales électriques et des stations d’épuration.
Ces attaques navales israéliennes ont commencé peu après la découverte par le groupe BG (British Gas) de ce qui semble être des gisements de gaz naturel assez importants dans les eaux territoriales de Gaza. Des revues spécialisées rapportent qu’Israël s’approprie déjà ces ressources gazaouies pour son propre usage, dans le cadre de son engagement à réorienter son économie vers le gaz naturel. Selon la source industrielle habituelle :
« Selon des sources gouvernementales israéliennes, le ministère israélien des finances a donné à la société électrique israélienne (IEC) l’autorisation d’acheter à BG des quantités de gaz naturel plus importantes que celles qui avaient été convenues à l’origine, ce qui permettrait à la société publique de négocier jusqu’à 1,5 milliard de mètres cubes de gaz naturel provenant du champ Marine situé au large de la côte méditerranéenne de la bande de Gaza sous contrôle palestinien. »
« L’année dernière, le gouvernement israélien a autorisé l’achat de 800 millions de mètres cubes de gaz provenant du gisement par l’IEC. […] Récemment, le gouvernement israélien a modifié sa politique et décidé que l’entreprise publique pourrait acheter la totalité du gaz provenant du gisement de Gaza Marine. Auparavant, le gouvernement avait déclaré que l’IEC pouvait acheter la moitié de la quantité totale et que le reste serait acheté par des producteurs d’électricité privés. »
Le pillage de ce qui pourrait devenir une source majeure de revenus pour Gaza a sans nul doute été porté à la connaissance des autorités américaines. On peut donc légitimement supposer que l’intention de s’approprier ces ressources limitées, que ce soit par Israël seul ou avec l’Autorité palestinienne collaborationniste, est la raison pour laquelle on empêche les bateaux de pêche gazaouis de pénétrer dans les eaux territoriales de la bande de Gaza.
Il existe quelques précédents instructifs. En 1989, le ministre australien des affaires étrangères Gareth Evans a signé avec son homologue indonésien Ali Alatas un traité accordant à l’Australie des droits sur les importantes réserves pétrolières de la « province indonésienne du Timor oriental ». Le traité entre l’Indonésie et l’Australie sur le Timor oriental, qui n’offrait pas la moindre miette au peuple dont le pétrole était volé, « est le seul accord juridique au monde qui reconnaisse effectivement le droit de l’Indonésie à gouverner le Timor oriental », a rapporté la presse australienne.
Interrogé sur son intention de reconnaître à la fois la prise de possession indonésienne et le vol de l’unique ressource de ce territoire conquis, soumis à un massacre quasi génocidaire par l’envahisseur indonésien avec le soutien résolu de l’Australie (ainsi que des États-Unis, du Royaume-Uni et de quelques autres pays), Evans a expliqué : « Il n’y a pas d’obligation juridique contraignante consistant à ne pas reconnaître l’acquisition d’un territoire acquis par la force, ajoutant que le monde est un endroit plutôt injuste, truffé d’exemples d’acquisition par la force. »
Il ne devrait donc pas y avoir de problème pour qu’Israël en fasse de même à Gaza.
Quelques années plus tard, Evans est devenu la figure de proue de la campagne visant à introduire le concept de « responsabilité de protéger » – connu sous le nom de R2P – dans le droit international. La responsabilité de protéger vise à établir une obligation internationale de protéger les populations contre les crimes graves. Evans est l’auteur d’un ouvrage important sur le sujet et a été coprésident de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États, qui a publié ce qui est considéré comme le document de base sur la responsabilité de protéger.
Dans un article consacré à cet « effort idéaliste pour établir un nouveau principe humanitaire », le London Economist présente Evans et sa « revendication courageuse et passionnée en faveur d’une expression qui tient en trois mots et qui (en grande partie grâce à ses efforts) appartient désormais au langage de la diplomatie : la responsabilité de protéger ». L’article est accompagné d’une photo d’Evans avec la légende « Evans : une vie entière de passion pour protéger. » Sa main est pressée sur son front, en un geste de désespoir devant les difficultés que rencontre son idéalisme. Le journal a choisi de ne pas publier une autre photo qui circule en Australie et qui représente Evans et Alatas joignant chaleureusement leurs mains pour porter un toast à la signature du traité de Timor Gap qu’ils viennent de signer.
Bien qu’il s’agisse d’une « population protégée » au regard du droit international, les habitants de Gaza ne relèvent pas de la « responsabilité de protéger » et rejoignent la liste de leurs semblables, se conformant ainsi à la maxime de Thucydide – selon laquelle les forts font ce qu’ils veulent et les faibles subissent ce qui leur est imposé – qui s’applique avec sa rigueur séculaire.
Obama et les colonies
Les restrictions de circulation imposées pour détruire Gaza sont depuis longtemps également en vigueur en Cisjordanie, avec moins de cruauté certes mais avec des conséquences désastreuses pour la vie et l’économie. La Banque mondiale indique qu’Israël a mis en place « un régime de verrouillage complexe qui restreint l’accès des Palestiniens à de vastes zones de la Cisjordanie. […] L’économie palestinienne stagne, en grande partie en raison de la forte récession à Gaza et des restrictions qu’Israël continue d’imposer au commerce et à la circulation des Palestiniens en Cisjordanie ».
La Banque mondiale « a mentionné des barrages routiers et des points de contrôle israéliens qui entravent le commerce et les déplacements, ainsi que des restrictions imposées en terme de construction palestinienne en Cisjordanie, là où le gouvernement du président palestinien Mahmoud Abbas, soutenu par l’Occident, est au pouvoir ». Israël autorise cependant – voire encourage – les élites de Rammallah et parfois d’ailleurs à mener une existence privilégiée, largement tributaire de financements européens, une pratique coloniale et néocoloniale traditionnelle.
Tout cela constitue ce que l’activiste israélien Jeff Halper appelle une « matrice de contrôle » destinée à soumettre la population colonisée. Ces programmes systématiques menés sur plus de 40 ans ont pour but de mettre en œuvre la stratégie recommandée par le ministre de la défense Moshe Dayan auprès de ses collègues, peu après les conquêtes israéliennes de 1967, qui consistait à dire aux Palestiniens des territoires : « Nous n’avons pas de solution, vous continuerez à vivre comme des chiens, et quiconque le souhaite peut partir, nous verrons bien où ce processus nous mènera. »
En ce qui concerne la deuxième pomme de discorde, les colonies, il y a bien une confrontation, mais elle est plutôt moins dramatique qu’on ne le dit. La position de Washington a été présentée de la manière la plus ferme dans la déclaration très citée de la secrétaire d’État Hillary Clinton, qui a rejeté les « exceptions de croissance naturelle » à la politique d’opposition à de nouvelles implantations. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, ainsi que le président Shimon Peres et, en fait, la quasi-totalité du spectre politique israélien, insistent pour autoriser la « croissance naturelle » dans les zones qu’Israël a l’intention d’annexer, se plaignant que les États-Unis reviennent sur l’autorisation donnée par George W. Bush d’une telle expansion dans le cadre de sa « vision » d’un État palestinien.
Les principaux membres du cabinet Netanyahu sont allés plus loin. Le ministre des transports, Yisrael Katz, a annoncé : « Le gouvernement israélien actuel n’acceptera en aucune façon le gel des activités légales de colonisation en Judée et en Samarie. » Dans le jargon américano-israélien, le terme « légal » signifie « illégal, mais autorisé par le gouvernement israélien avec la bénédiction de Washington ». Dans cette terminologie, les avant-postes non autorisés sont qualifiés d’« illégaux », bien que, hormis les diktats des puissants, ils ne soient pas plus illégaux que les colonies octroyées à Israël dans le cadre de la « vision » de Bush et du silence scrupuleux d’Obama.
La formulation « musclée » Obama-Clinton n’est pas nouvelle. Elle reprend la formulation du projet de feuille de route de 2003 de l’administration Bush, qui stipule qu’au cours de la phase I, « Israël gèle toutes les activités de colonisation (y compris la croissance naturelle des colonies). » Toutes les parties acceptent officiellement la feuille de route (modifiée pour supprimer l’expression « croissance naturelle ») – en négligeant systématiquement le fait qu’Israël, avec le soutien des États-Unis, a immédiatement ajouté 14 « réserves » qui la rendent inopérante.
Si Obama avait vraiment eu l’intention de s’opposer à l’expansion des colonies, il aurait très facilement pu prendre des mesures concrètes, par exemple en réduisant l’aide américaine à hauteur d’un montant consacré à cette fin. On ne pourrait pas appeler ça une mesure radicale ou courageuse. C’est ce que l’administration Bush I a fait (réduction des garanties de prêts), mais après l’accord d’Oslo en 1993, le président Clinton a laissé les calculs au gouvernement d’Israël. Sans surprise, il n’y a eu « aucun changement dans les dépenses destinées aux colonies », a rapporté la presse israélienne. « Le Premier ministre Rabin continuera à ne pas assécher les colonies, conclut le rapport. Et les Américains ? Ils comprendront. »
Les représentants de l’administration Obama ont informé la presse que les mesures de Bush I n’étaient « nullement en cours de discussion » et que les pressions seraient « largement symboliques ». En bref, Obama a compris, tout comme Clinton et Bush II avant lui.
Visionnaires américains
Au mieux, l’expansion des colonies est une question annexe, tout comme la question des « avant-postes illégaux », à savoir ceux que le gouvernement israélien n’a pas autorisés. Le fait de se concentrer sur ces questions détourne l’attention du fait qu’il n’y a pas d’« avant-postes légaux » et que ce sont les implantations existantes qui constituent le principal problème auquel il faut faire face.
La presse américaine rapporte qu’« un gel partiel est en place depuis plusieurs années, mais les colons ont trouvé les moyens de contourner les restrictions… La construction dans les colonies a ralenti mais n’a jamais cessé, se poursuivant à un rythme annuel d’environ 1 500 à 2 000 unités au cours des trois dernières années. Si la construction se poursuit au rythme de 2008, les 46 500 unités déjà approuvées seront achevées dans une vingtaine d’années…. Si Israël construisait toutes les unités de logement déjà approuvées dans le plan directeur national pour les colonies, cela doublerait presque le nombre de maisons de colons en Cisjordanie ». Peace Now, qui suit les activités de colonisation, estime en outre que les deux plus grandes colonies doubleraient de taille : Ariel et Ma’aleh Adumim, qui ont été essentiellement implantées au cours des années d’Oslo dans les saignées qui subdivisent la Cisjordanie en cantons.
La « croissance naturelle de la population » est en grande partie un mythe, souligne le principal correspondant diplomatique israélien, Akiva Eldar, citant des études démographiques réalisées par le colonel (réserviste) Shaul Arieli, secrétaire militaire adjoint de l’ancien premier ministre et ministre de la défense en exercice, Ehud Barak. La croissance des colonies est en grande partie le fait d’immigrants israéliens enfreignant les conventions de Genève, soutenus par de généreuses subventions. Une grande partie de ces implantations se fait en violation directe des décisions officielles du gouvernement, mais avec l’autorisation du gouvernement, en particulier de Barak, considéré comme une colombe dans le paysage politique israélien.
Jackson Diehl, journaliste, tourne en dérision le « fantasme palestinien longtemps resté en sommeil, ravivé par le président Abbas, selon lequel les États-Unis vont tout simplement contraindre Israël à faire des concessions cruciales, que son gouvernement démocratique soit d’accord ou non ». Il n’explique pas en quoi le refus de participer à l’expansion illégale d’Israël – qui, si on était sérieux, « obligerait Israël à faire des concessions cruciales » – constituerait une ingérence inappropriée dans la démocratie israélienne.
Pour en revenir à la réalité, toutes ces discussions autour de l’expansion des colonies éludent la question la plus cruciale à ce sujet : les implantations déjà mises en place par les États-Unis et Israël en Cisjordanie. Cette esquive permet de concéder tacitement que les programmes de colonisation illégaux déjà en place sont d’une certaine manière acceptables (si l’on met de côté le plateau du Golan, annexé en violation des injonctions du Conseil de sécurité) – même si la « vision » de Bush, apparemment acceptée par Obama, passe d’un soutien tacite à un soutien explicite de ces violations du droit. Ce qui existe déjà suffit à garantir qu’il ne peut y avoir d’autodétermination palestinienne réaliste. Tout porte donc à croire que, même dans l’hypothèse improbable où la « croissance naturelle » prendrait fin, le rejet américano-israélien persisterait, bloquant comme par le passé le consensus international.
Le Premier ministre Netanyahou a par la suite décrété une suspension de 10 mois de toute nouvelle construction, prévoyant de nombreuses exemptions et excluant totalement le Grand Jérusalem, où les expropriations dans les zones arabes et les constructions pour les colons juifs se poursuivent à un rythme effréné. Hillary Clinton a salué ces concessions « sans précédent » en matière de construction (illégale), suscitant la colère et la moquerie d’une grande partie du monde.
Il en serait peut-être autrement si un « échange de territoires » légitime était envisagé, une solution abordée à Taba et détaillée dans l’accord de Genève conclu dans le cadre de négociations informelles de haut niveau entre Israël et la Palestine. L’accord a été présenté à Genève en octobre 2003, salué par une grande partie du monde, rejeté par Israël et ignoré par les États-Unis.
« L’impartialité » de Washington
Le 4 juin 2009, Barack Obama s’est adressé au monde musulman au Caire, fidèle à son style bien rodé d’« ardoise blanche » : peu de contenu, mais une présentation agréable qui permet aux auditeurs d’écrire sur l’ardoise ce qu’ils ont envie d’entendre. CNN en a saisi l’esprit en titrant un reportage : « Obama tente d’atteindre l’âme du monde musulman ». Les objectifs de son discours avaient été annoncés lors d’une interview avec le chroniqueur du New York Times Thomas Friedman. « Nous avons une blague à la Maison Blanche, a déclaré le président. Nous allons tout simplement continuer de dire la vérité jusqu’à ce que cela ne marche plus et la vérité n’est nulle part plus importante qu’au Moyen-Orient. ». On ne peut que se féliciter de l’engagement de la Maison Blanche, mais il est judicieux de voir comment il se traduit dans la pratique..
Obama a rappelé à son auditoire qu’il était facile de « pointer du doigt… mais si nous ne voyons ce conflit que d’un côté ou de l’autre, nous serons aveugles à la vérité : la seule solution consiste à répondre aux aspirations des deux parties par la création de deux États, qui permettent aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans la paix et la sécurité ».
En passant de la vérité Obama-Friedman à la vérité tout court, il y a un troisième acteur, qui joue un rôle décisif tout au long du conflit : les États-Unis. Mais ce participant au conflit, Obama le passe sous silence. Cette omission est considérée comme normale et appropriée, et n’est donc pas mentionnée : L’article de Friedman est intitulé « Le discours d’Obama est destiné tant aux Arabes qu’aux Israéliens ». L’article de la une du Wall Street Journal sur le discours d’Obama est intitulé « Dans son message aux musulmans, Barack Obama s’en prend à Israël et aux Arabes. » Les autres articles sont du même ordre.
On peut comprendre les raisons de ce principe doctrinal : bien que le gouvernement américain commette parfois des erreurs, ses intentions sont par essence bienveillantes, voire nobles. Dans un monde où les images se veulent séduisantes, Washington a toujours désespérément voulu être un intermédiaire honnête, désireux de faire progresser la paix et la justice. La doctrine l’emporte sur la vérité, laquelle n’apparaît guère dans le discours ou dans la couverture médiatique qui en est faite.
Une fois de plus, Obama s’est fait l’écho de la « vision » de Bush en faveur de deux États, sans pour autant préciser ce qu’il entendait par « État palestinien ». Non seulement son intention a été clairement précisée par les omissions essentielles déjà évoquées, mais aussi par la seule critique formelle qu’il a formulée à l’égard d’Israël : « Les États-Unis n’acceptent pas que les colonies israéliennes se poursuivent en toute légitimité. Ces constructions violent les accords antérieurs et sapent les efforts de paix. Il est temps que ces colonies cessent. » En d’autres termes, Israël devrait respecter la phase I de la feuille de route de 2003, rejetée d’emblée par Israël avec le soutien tacite des États-Unis, comme indiqué – mais la vérité est qu’Obama a exclu jusqu’aux étapes de la première version de la feuille de route de Bush pour se retirer de la participation à ces crimes.
Les mots clés sont « légitimité » et « poursuivent ». Ce faisant, Obama indique qu’il accepte la vision de Bush : les vastes projets de colonisation et d’infrastructure existants sont « légitimes », ce qui permet de confirmer que l’expression « État palestinien » est bien synonyme de « poulet frit ». |David Bar-Ilan, directeur de la communication au bureau du premier ministre Nétanyahou indiquait en 1996 que chacun était libre de parler à sa convenance d’État palestinien, qu’on pouvait même l’appeler « poulet frit » et que cela ne poserait de problème à personne tant la sémantique était sans effet sur les intentions d’Israël, NdT].
Toujours aussi impartial, Obama a également adressé un avertissement aux États arabes : « Ils devront reconnaître le fait que si l’initiative de paix arabe a constitué un début important, elle n’a pas pour autant mis fin à leurs responsabilités. » Toutefois, de toute évidence, il ne saurait s’agir d’un « début » sérieux tant qu’Obama continuera d’en rejeter les principes fondamentaux, à savoir la mise en œuvre du consensus international. Toutefois, il est évident que Washington n’a pas à assumer cette « responsabilité » dans la vision d’Obama ; aucune explication, aucun commentaire.
S’agissant de démocratie, Obama a déclaré que « nous ne nous permettrions pas de décider de l’issue d’une élection pacifique » – comme ce fût le cas en janvier 2006, quand avec détermination Washington a pris la décision de punir sévèrement les Palestiniens parce que le résultat d’une élection non violente ne lui plaisait pas, apparemment avec l’approbation d’Obama si l’on en juge par ses propos avant son entrée en fonction et par ses acte depuis lors.
Obama s’est poliment abstenu de tout commentaire sur son hôte, le président Moubarak, l’un des dictateurs les plus tyranniques de la région, bien qu’il ait eu quelques mots révélateurs à son égard. Alors qu’il s’apprêtait à monter à bord de son avion à destination de l’Arabie saoudite et de l’Égypte, les deux États arabes «modérés », Obama a fait savoir : « Je ferai part des préoccupations américaines concernant les droits humains en Égypte, mais je ne critiquerai pas Moubarak de manière trop virulente, parce que ce dernier est une « force pour la stabilité et le progrès » au Moyen-Orient… Obama a ajouté qu’il ne considérait pas Moubarak comme un dirigeant autoritaire. « Je ne cherche pas à coller des étiquettes aux gens ». Le président a noté que des critiques avaient été formulées « sur la manière dont la politique fonctionne en Égypte », mais il a également déclaré que Moubarak avait été pour les États-Unis « Un allié fidèle, et ce à biens des égards. »
Lorsqu’un politicien utilise le mot « gens », il faut s’attendre à de la duplicité, voire pire, qui se profile à l’horizon. En dehors de ce contexte, on parle d’ « individus », et même souvent de « méchants », et il est tout à fait justifié d’utiliser des étiquettes pour les désigner. Obama a cependant raison de ne pas avoir utilisé le mot « autoritaire », qui est une étiquette bien trop douce pour son ami.
Le soutien à la démocratie, ainsi qu’aux droits humains, suit, comme toujours, un schéma que les chercheurs ont maintes fois mis en évidence, à savoir une corrélation étroite avec les objectifs stratégiques et économiques. On comprendra aisément pourquoi ceux qui ne sont pas complètement aveuglés par une doctrine rigide considèrent le plaidoyer d’Obama en faveur des droits humains et de la démocratie comme une plaisanterie de mauvais goût.
[Note : Tous les éléments de cet article sont tirés du nouveau livre de Noam Chomsky, Hopes and Prospects, et font l’objet d’une note de bas de page].
Noam Chomsky, un habitué de TomDispatch, est professeur émérite au département de linguistique et de philosophie du Massachusetts Institute of Technology et professeur lauréat de linguistique [Le titre de professeur lauréat est décerné aux universitaires les plus éminents en reconnaissance de leurs réalisations et de leur contribution exceptionnelle à leur domaine d’études et à leur université, NdT] et titulaire de la chaire Agnese Nelms Haury dans le cadre du programme sur l’environnement et la justice sociale à l’université de l’Arizona. Il est l’auteur de nombreux ouvrages politiques à succès, traduits dans de nombreuses langues, dont les plus récents sont Optimism Over Despair, The Precipice et, avec Marv Waterstone, Consequences of Capitalism. Son dernier ouvrage s’intitule Notes on Resistance.
Source : https://tomdispatch.com/a-middle-east-peace-that-could-happen-but-wont/ 05-05-2024
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises










