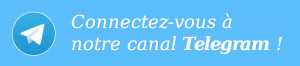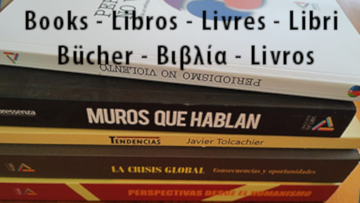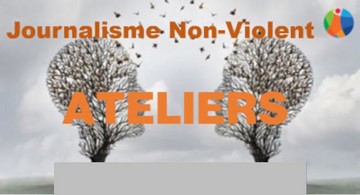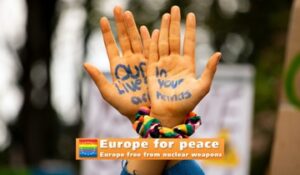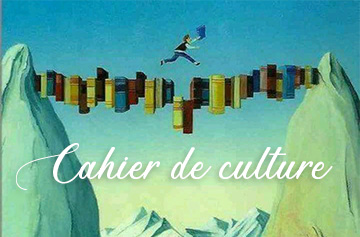Les États occidentaux et leurs alliés — un septième de la population mondiale — représentent en gros les deux tiers des dépenses militaires planétaires. L’industrie de l’armement s’impose en Allemagne ; les économistes prédisent « des canons plutôt que du beurre ».
La part des États occidentaux et de leurs alliés dans les dépenses militaires mondiales, environ les deux tiers, représente le double de celle du monde non occidental ; et elle continue à croître. Ces données proviennent d’une nouvelle étude publiée par le Sipri (Institut international de recherche sur la paix de Stockholm) le 29 avril 2024. D’après ce document, les dépenses militaires mondiales ont atteint l’an dernier une valeur record de 2 443 milliards de dollars US. La part des États-Unis dans ce montant s’établit à 37 %, celle des pays européens à 24 % ; à quoi s’ajoutent les dépenses des alliés les plus proches, tels que le Japon. Sur la liste des États ayant dans le monde les plus grosses dépenses militaires, l’Allemagne se situe au septième rang. Mais du fait qu’elle s’est massivement équipée cette année, elle pourrait bien passer à la cinquième place. Cette militarisation à marche forcée de l’Ouest survient dans une période où l’influence économique, et aujourd’hui politique, des puissances transatlantiques marque le pas – une évolution qui pourrait même ne plus être endiguée autrement que par la force. Par ailleurs, en Allemagne, on voit l’industrie de l’armement et le budget de la défense gagner en poids politique — aux dépens des postes budgétaire civils.
Les coûts de la militarisation
Il ressort d’une étude publiée lundi dernier par le Sipri que les dépenses militaires mondiales ne cessent de croître et que leur grande majorité est le fait des États occidentaux. D’après ce document, en 2023, la part des USA s’élève à elle seule à 37 % des 2 443 milliards de dollars US de dépenses militaires mondiales, soit 916 milliards de dollars US. D’après les calculs du Sipri, ces dépenses se chiffrent pour l’ensemble des États membres de l’Otan à 1 341 milliards de dollars US — soit plus de 55 % de l’ensemble des dépenses militaires mondiales[1]. Pour sa part, l’Europe a engagé l’an dernier 24 % de toutes les dépenses qui ont été investies dans le monde entier dans les forces armées nationales des différents pays. À elles seules, l’Europe de l’Ouest et l’Europe centrale ont mis 407 milliards de dollars US dans les budgets militaires, soit un bon tiers de plus que la République populaire de Chine, dont le Sipri chiffre les dépenses militaires pour 2023, y compris les fonds hors budget militaire officiel, à un peu plus de 296 milliards de dollars US. À quoi s’ajoutent encore les États partenaires des occidentaux : le Japon et la Corée du Sud, respectivement aux 10ème et 11ème place du classement mondial avec des budgets militaires de respectivement 50,2 et 47,9 milliards de dollars US, ou l’Australie qui arrive en 13ème place avec 32,3 milliards de dollars US.
Ascension
Dans le classement Sipri actuel, l’Allemagne occupe la septième place — derrière les USA, la Chine, la Russie (109 milliards de dollars US), l’Inde (83,6 milliards de dollars US), l’Arabie saoudite (75,8 milliards de dollars US) et la Grande-Bretagne (74,9 milliards de dollars US). Le Sipri chiffre les dépenses militaires allemandes à environ 66,8 milliards de dollars US — plus que celles de la France (61,3 milliards de dollars US). N’oublions pas qu’elles vont augmenter. D’après les données du ministère de la Défense allemande, vont s’ajouter cette année au budget militaire de 51,9 milliards d’euros, 19,8 milliards d’euros de dépenses patrimoniales, qu’il convient, de l’avis de la Cour des comptes fédérale, de désigner sous le terme de « dépenses particulières ».[2] Ainsi, officiellement, les dépenses militaires allemandes vont atteindre cette année 71,7 milliards d’euros, alors que cela ne correspond pas encore aux dépenses militaires réelles : le compte rendu que Berlin envoie chaque année à l’OTAN prend en compte des dépenses hors budget militaire et se trouve donc régulièrement au-dessus du budget militaire officiel. Mais cette année, compte tenu du cours actuel du change, celui-ci s’élève à 76,5 milliards de dollars US, ce qui mettrait l’Allemagne à la cinquième place mondiale, devant l’Arabie saoudite.
L’Europe locomotive de l’armement
Il y a un moment déjà que le rôle moteur de l’Ouest et notamment de l’Europe dans ce réarmement mondial est manifeste. C’est ainsi que, entre 2014 et 2023, d’après le Sipri, les dépenses militaires des USA ont augmenté de 9,9 %, celles de l’Allemagne de 48 %, et celles de l’Europe, de 62 %. Les États européens occupent aussi dans le commerce mondial des armes une place prépondérante. Entre 2019 et 2023, la France a été le deuxième exportateur d’armes mondial ; l’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne et l’Espagne occupaient, quant à elles, les places cinq à huit. En outre, entre 2019 et 2023, l’Europe a été la seule grande région dont les importations d’armes ont augmenté massivement — de pas moins de 94 % — par rapport à la période 2014-2018.[3] De plus, entre 2019 et 2023, certains alliés parmi les plus importants de l’Ouest ont augmenté significativement leurs importations de matériel militaire — la Corée du Sud (+ 6,5 %), les Philippines (+ 105 %) et le Japon (+ 155 %). D’après les données du Sipri, les carnets de commande des arsenaux américains et européens, qui chiffrent l’armement des années à venir à partir de données réelles, sont nettement en avance.[4]
Le déclin de l’Ouest
Les États occidentaux renforcent leurs arsenaux à un moment où leur influence économique marque le pas et commence à avoir des effets concrets sur leur influence politique. Si, en 2000, ils représentaient encore 56,36 % des performances économiques mondiales — calculé selon la parité de pouvoir d’achat —, ce chiffre est descendu aujourd’hui à 40,62 % et, selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI), il va encore continuer à baisser tandis que la part du Sud global, qui est déjà passée à 59,38 %, continue à augmenter. Pour la première fois en 2021, les résultats économiques des pays du G7, qui se prennent pour le « comité de pilotage de la politique mondiale », se sont avérés inférieurs à ceux des BRICS (30,7 % contre 31,5 %) et ne cessent de reculer depuis lors ; ajoutons que les BRICS se sont élargis le 1er janvier 2024. La Banque de France prévoit qu’en 2027 les BRICS + représenteront 37,6 % de la production mondiale tandis que le G7 ne produira plus que 28,2 %.[5] C’est aussi sa perte d’influence politique qui a empêché l’Ouest jusqu’à maintenant d’obliger les pays du Sud global à s’associer à leur politique de sanctions contre la Russie. Il se pourrait bien qu’il ne leur reste bientôt plus que le recours aux armes pour compenser leur perte d’influence.
Le poids de l’industrie de l’armement
Comme l’attestent les chiffres du Sipri, cette augmentation massive des capacités militaires, qui est indispensable à la réalisation de ce projet, a été résolument accélérée ; elle a aussi, bien sûr, des effets dans la politique intérieure des États occidentaux. En Allemagne, par exemple, l’industrie de l’armement ne faisait plus partie, depuis des décennies, des secteurs locomotives de l’économie nationale. Mais les choses commencent à changer. Pour la première fois en mai de l’an dernier, un groupe industriel de fabrication d’armes, Rheinmetall, est entré dans l’indice boursier de référence DAX — un symbole de l’influence grandissante de l’industrie allemande de l’armement.[6] Rheinmetall a fait passer son chiffre d’affaires à 7,2 milliards d’euros en 2023 et part du principe que d’ici à 2026 il aura atteint un chiffre d’affaires de 13 à 14 milliards d’euros. Certes, il est encore à des années-lumière de multinationales de premier ordre tel que Volkswagen avec son chiffre d’affaires de 322 milliards d’euros, mais il approche de sa perspective, accéder à la première division de l’industrie allemande. Petit à petit, avec son poids économique, l’industrie allemande de l’armement augmente aussi son influence politique.
Des canons plutôt que du beurre
Parallèlement, les dépenses militaires repoussent les autres postes de dépenses dans le budget de l’État. C’est ainsi que le budget de la Défense, avec ses 10,9 %, est aujourd’hui le deuxième plus gros poste juste après celui consacré au Travail et au Social.[7] Mais dans ces chiffres ne sont pas incluses les dépenses justifiées par « le patrimoine de droit public ». Si on les prend en compte, la part du budget militaire passe à 15 %. Sur le temps long, cela se fera aux dépens des postes budgétaires civils de l’État. Il y a peu de temps, le président de l’institut Ifo, Clement Fuest, constatait : « Canon et beurre — ce serait bien si cela marchait. Mais c’est un pays de Cocagne. Ça ne marche pas. » Fuest a prédit « Des canons, mais pas de beurre ».[8]
Notes
[1] Ces données et les suivantes sont tirées de : Nan Tian, Diego Lopes da Silva, Xiao Liang, Lorenzo Scarazzato, Trends in World Military Expenditure, 2023, Sipri, Fact Sheet, Solna, April 2024.
[2] Pistorius au Bundestag: „Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif“. bmvg.de 01.02.2024. S. auch „Deutschland kriegstauglich machen“.
[3], [4] S. dazu Rüstungstreiber Europa.
[5] Expansion of BRICS: what are the potential consequences for the global economy? banque-france.fr 13.02.2024.
[6] Rheinmetall steigt in den DAX auf. tagesschau.de 04.03.2023. S. auch Kampfpanzer statt Dialyse.
[7] Bundeshaushalt digital. bundeshaushalt.de.
[8] Raphaël Schmeller: Ampel zerlegt Sozialstaat. junge Welt 24.02.2024. S. auch Der Wille zum Weltkrieg.
Traduit de l’allemand par Didier Aviat