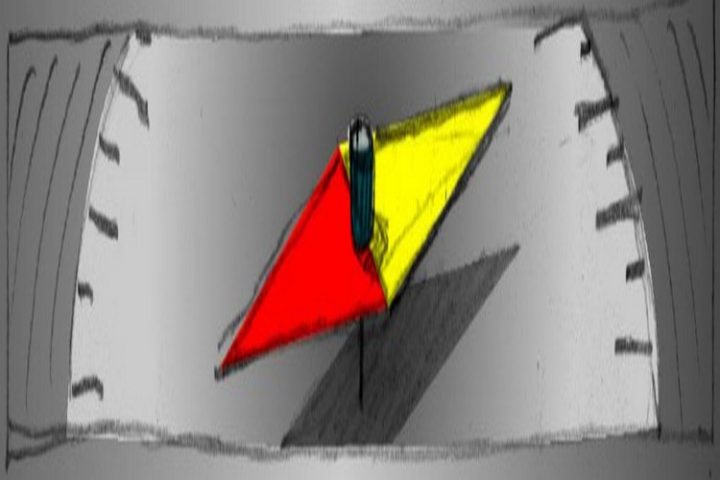Par Bernard Friot pour Le Monde Diplomatique
Dans « Le Monde diplomatique », le sociologue Bernard Friot affirme que la logique actuelle du système de retraite, loin d’être obsolète, comme on voudrait le faire croire, mériterait au contraire d’être étendue, et permet d’imaginer une société où le travail serait libéré à la fois du marché de l’emploi et de l’emprise de la finance (lire « Retraites, un trésor impensé »). Il détaille ici sa proposition.
Les réformes de la protection sociale menées depuis les années 1980 dans l’Union européenne sont souvent définies comme libérales, sur le modèle anglo-saxon. S’agissant des pensions de retraite, par exemple, les autorités européennes s’attaqueraient aux régimes en répartition pour les remplacer par des régimes en capitalisation. Cette hypothèse est à la fois juste et fausse.
Il est évident que les élites réformatrices promeuvent la capitalisation, malgré une base initiale très faible (1). Mais pas jusqu’à réduire les régimes nationaux en répartition à un niveau résiduel à l’anglaise. Les élites réformatrices veulent promouvoir la capitalisation, mais l’échec anglais en la matière est tel qu’il n’est pas attractif pour ces réformateurs, qui incriminent en particulier l’horizon trop incertain des salariés britanniques du fait de l’insuffisance du régime public de pensions. C’est donc plutôt un régime à forte composante de répartition qui est promu par l’Union européenne, étant entendu qu’il doit s’agir d’une répartition favorable à la capitalisation : ce sont très précisément les qualités que présente le régime suédois issu des réformes des années 1990. Cette promotion d’un modèle nordique n’est pas isolée : sur le terrain très décisif de la réforme du marché du travail, c’est le modèle danois de laflexicurity qui est préconisé. Dans le champ du travail, les réformateurs européens s’inspirent davantage des pays scandinaves que des pays anglo-saxons, peut-être parce que leur modèle est plus apte à sauver la mise d’un capitalisme en crise.
C’est ici qu’il importe de sortir de l’opposition binaire entre répartition et capitalisation. Ceux qui s’opposent à la promotion de la capitalisation en « défendant la répartition » pensent que la répartition est l’alternative à la capitalisation. C’est oublier qu’il y a des formes contradictoires de régimes en répartition, et que la répartition peut être la condition de la capitalisation. Il faut donc se garder d’une opposition à la réforme qui serait menée « en défense de la répartition » sans préciser laquelle ! Répartir, c’est une technique : on transforme immédiatement des contributions en prestations, sans passer par l’épargne. Ce contenantpeut avoir des significations très différentes selon son contenu, et c’est pourquoi la question centrale est : que répartit-on ? Sont en conflit aujourd’hui le salaire et le revenu.
Répartir du salaire, c’est financer des pensions qui sont la continuation du salaire ; répartir du revenu, c’est financer des pensions qui sont tirées d’un patrimoine constitué de la somme des cotisations passées du retraité. Le critère du salaire continué, c’est le taux de remplacement du dernier salaire par la première pension. Le critère du revenu différé, c’est le taux de rendement des cotisations. Dans le premier cas, la pension est, comme tout salaire, la reconnaissance de la qualification actuelle du retraité. Dans le second cas, le retraité est un inactif qui récupère sa prévoyance passée. L’enjeu actuel des réformateurs est de passer du salaire continué, qui est la réalité de la plupart des systèmes de pension en Europe, au revenu différé, qui caractérise les réformes italienne et suédoise des dernières années. On est toujours en répartition, mais elle a complètement changé de sens. Voyons comment s’exprime cette contradiction aujourd’hui entre :
— la pension comme revenu différé : « J’ai cotisé, j’ai droit (à récupérer mes cotisations passées par le biais des cotisations actuelles des actifs) » et
— la pension comme salaire continué : « J’ai une qualification, j’ai droit (au salaire à vie) ».
Dans les deux cas, nous sommes en répartition, mais il s’agit de deux régimes antagonistes. Examinons la chaîne des mots dans l’un et l’autre cas.
Soit (revenu différé) c’est la solidarité entre générations qui est au cœur des représentations de la retraite. L’emploi, le marché du travail, sont les seules institutions légitimes pour transformer les activités en travail. Le retraité ne travaille pas, il a des activités utiles qui ne génèrent aucune valeur économique. Ce sont les actifs qui financent les inactifs. Le travailleur est titulaire d’un gagne-pain dont il tire une prévoyance pour le moment où, sans emploi, il dépendra de la valeur créée par ceux qui ont un emploi. Ce revenu (ce n’est pas un salaire puisque le salaire rémunère les emplois) est différé, non pas au sens où chacun récupère ses cotisations passées, mais au sens où il n’a pas tout dépensé de son salaire lorsqu’il était actif, en affectant une partie aux pensions de la génération précédente : il attend en retour (c’est le pacte générationnel au cœur du lien social) que la génération après lui se comporte de même. Nous sommes ici en pleine aliénation : les institutions du capital (emploi et propriété lucrative) sont légitimées, la situation de mineur social du travailleur nié comme seul producteur et posé comme titulaire d’un gagne-pain est intériorisée, le rapport entre générations devient le cœur des rapports sociaux.
Soit (salaire continué) le retraité est enfin titulaire de sa qualification, exprimée dans le caractère irrévocable de son salaire. Il n’a plus besoin de passer par l’emploi pour travailler, le salaire à vie est l’institution qui abolit le marché du travail et convertit les activités utiles en travail. Les 13% du PIB affectés aux pensions correspondent à la valeur attribuée au travail des pensionnés. Ce qui distingue un retraité d’un employé, ce n’est pas la génération (selon une naturalisation de la caractéristique biographique qu’est l’âge, comme le fait le capitalisme pour le genre, la nationalité, etc.), c’est le fait que le retraité travaille parce qu’il a un salaire à vie, alors que l’employé travaille parce qu’il a un emploi. Alors que le discours générationnel invente un rapport social imaginaire dans de dramatiques distinctions entre salariés, le salaire continué met à nu le rapport social capitaliste en le subvertissant et en montrant que l’emploi et la propriété lucrative peuvent être dépassés par le salaire universel.
On ne le répétera jamais assez : les réformateurs poursuivent un projet politique sous couvert d’impératifs gestionnaires, et c’est sur les enjeux politiques de la réforme que la controverse doit porter, à condition de voir ce qu’a de révolutionnaire le déjà-là de la pension comme salaire continué.
2. En quoi le salaire à vie se différencie-t-il du projet de revenu minimum garanti ?
Nous retrouvons ici l’opposition déjà esquissée – et à mon sens au cœur du conflit de classes aujourd’hui – entre salaire et revenu. Elle nous offre un exemple incisif de la guerre des mots.
Poser le salaire comme un revenu a été une entreprise fondamentale des économistes, classiques et plus encore néo-classiques. Le revenu, c’est-à-dire le flux de ressources que l’on tire d’un stock patrimonial, trouve son expression (et sa légitimité) dans le droit de propriété lucrative : je dispose d’un patrimoine que je ne consomme pas afin d’en tirer un revenu. Accumuler des titres financiers me donne le droit de ponctionner, sous forme de monnaie, le produit d’une partie du travail d’autrui. Chaque dégonflement de bulle (et chaque période d’austérité consécutive à une création intempestive de monnaie pour sauver le taux de profit des détenteurs de titres financiers) nous rappelle que la prétendue « monnaie virtuelle » est un oxymore : pas plus qu’un titre financier n’est un réservoir de valeur, il ne peut générer de la monnaie. Sa conversion en monnaie suppose que celle-ci soit déjà là, comme expression de la valeur attribuée au travail en train de se mettre en œuvre. Les prétendus « investisseurs » n’apportent absolument rien : ils disposent d’un droit de propriété lucrative qui leur permet de ponctionner, sous forme de monnaie, un partie de la valeur ajoutée en train d’être produite.
L’abolition ou le renforcement de ce droit est au cœur de la contradiction entre salaire et revenu. Car la naturalisation de ce rapport social particulièrement violent qu’est la propriété lucrative repose, depuis l’invention de l’économie politique et plus particulièrement depuis sa dérive en science économique, sur l’assimilation du salaire à un revenu : celui que le titulaire d’un « capital humain » tire de ce stock qu’il ne consomme pas pour lui-même et qu’il met en valeur sur le « marché du travail ». Le salaire, c’est la chose la plus évidente pour tout manuel de science économique, est le revenu du travail. L’évidence de la chose pose comme tout aussi évidente l’existence d’un revenu du capital tout court. Rente de la terre, profit du capital et salaire du travail : le « revenu » a perdu toute épaisseur politique, c’est une désignation générique qui permet de mettre travail et capital sur le même plan et de naturaliser le droit de propriété lucrative en lisant toute ressource comme ce que l’on tire d’un capital lors d’un échange marchand.
Marx a fait une critique décisive de cette saga des économistes en posant le salaire comme le prix de la force de travail et le profit comme l’extraction de la survaleur non pas sur un marché mais lors de la production, une production menée selon la dictature de la valeur travail : des marchandises mesurées par leur temps de travail abstrait de production. Mais l’usage qu’a fait le mouvement ouvrier de cette critique a conduit à des représentations ambiguës. D’une part on observe une tendance à naturaliser cette force de travail en la sortant du rapport de production capitaliste pour en faire l’équivalent de la capacité créatrice dont est porteuse toute personne (de ce fait, un artisan, un fonctionnaire, qui ne relèvent pourtant pas du marché du travail et ne produisent pas de marchandises, seront dits avoir une force de travail). D’où une grande vulnérabilité à la thématique du revenu et à une représentation du travailleur en écho à la saga économiste : ma force de travail est mon gagne pain dont je tire un revenu. D’autre part, le salaire étant le prix de cette force de travail, sa mesure est celle des consommations nécessaires à sa reproduction. D’où une lecture du salaire en termes de besoins, de pouvoir d’achat ; d’où également une lecture de la cotisation sociale comme permettant la couverture collective de besoins de reproduction de la force de travail que chaque capitaliste pris individuellement, cherchant à ne couvrir que les besoins de présence hic et nunc du travailleur sur son poste de travail, néglige au risque de mettre en cause les intérêts de classe du capital (enfants, éducation, …) : la sécurité sociale, dans cette perspective, fait partie du prix de la force de travail. Cela conduit les opposants à la réforme des pensions à une lecture aliénée du salaire qui les empêche de sortir du cadre de pensée de la réforme, comme nous l’avons vu au point précédent.
Le revenu minimum garanti s’inscrit dans cette représentation aliénée. Certes, son caractère garanti en fait un attribut de la personne, alors que la logique du marché du travail suppose que ce sont les postes de travail, et non les personnes, qui sont les supports des droits salariaux. Mais précisément il ne s’agit pas d’un droit salarial, au sens où salaire à la qualification et cotisations sociales ont construit le salaire comme affirmation de la qualité des personnes comme seules productrices, contre le marché du travail et le droit de propriété lucrative. Il s’agit au contraire d’un droit au revenu minimum, qui confirme ces deux institutions du capital. Revenu, il est, selon ses promoteurs, tiré du patrimoine collectif constitué par le travail des générations passées ou par le travail informel que ne peut pas s’approprier le capital : nous ne sortons pas du droit de propriété lucrative. Minimum, il nous renvoie d’une part à la représentation aliénée des personnes comme des êtres de besoin qui est au cœur de leur disqualification dans le capitalisme, et il nécessite d’autre part un « second chèque », celui que chacun ira chercher sur le marché du travail s’il ne se contente pas du minimum. Loin d’être amoindri comme le prétendent ceux qui estiment que le premier chèque donnera un pouvoir de négociation face aux employeurs, le marché du travail sera renforcé par cette allocation forfaitaire qui fera partie, avec le droit individuel à la formation, le droit à un régime complémentaire de santé et le droit au reclassement, de la panoplie des « droits portables » que les travailleurs transporteront avec eux de job en job, panoplie flexicuritaire qu’esquisse le catastrophique accord de janvier 2008 dit « de modernisation du marché du travail ».
Le salaire universel l’est au double sens de pour tous (chacun, de sa première entrée dans un collectif de travail à sa mort, a droit à une qualification et au salaire irrévocable qui va avec) et pour tout (l’investissement est financé par une part socialisée du salaire, ponctionnée sur la valeur ajoutée par une cotisation économique). Il se substitue au marché du travail et au droit de propriété lucrative. C’est un droit politique qui récuse l’imposture du capital comme acteur économique et qui qualifie les personnes, les posant comme les seules productrices et faisant des producteurs des acteurs politiques. Le salaire universel donne au travail la charge politique que le capitalisme lui refuse.
(1) En 1990, lorsque le commissaire à la concurrence de l’époque entreprend de promouvoir une directive unifiant le marché européen des fonds de pensions, ceux-ci ne représentent que 12% des pensions, 88% étant assuré par les régimes nationaux en répartition.