Un film de Laurence Petit–Jouvet
Photos et texte : lalignedecouleur.com
Vivre en France lorsqu’on est perçu comme arabe, noir ou asiatique. Des hommes et des femmes, français de culture française, parlent chacun dans une «lettre filmée» de leur expérience singulière, intime et sociale, d’être regardés comme non-blancs et d’avoir à penser à leur «couleur».
Extraits

«Ce qui est drôle, c’est que même dans le doublage où l’on n’entend que les voix, la question de ma différence se pose encore. Je suis employée le plus souvent pour doubler des actrices d’origine asiatique. Au gré des films, je puis être chinoise, japonaise, vietnamienne ou coréenne…»

«A vous qui, sur le tournage de mon dernier film, n’avez pas voulu comprendre que j’étais la réalisatrice, vous n’avez parlé qu’à mon cadreur en persistant à me prendre pour l’assistante. Je voudrais vous raconter…»

«Tout avait commencé pour moi dès la maternité. La sage-femme avait dit à ma mère que j’avais la jaunisse. Maman lui avait répondu : Madame, il est plutôt métis !»

«Entrer au conseil municipal n’était pas l’étape la plus difficile. Savez-vous que beaucoup encore, ont du mal à accepter qu’un Français au nom et au faciès maghrébin brigue des fonctions républicaines ?»

«Quelles que soient ma personnalité ou mes aspirations, je porte une étiquette avec tous les stéréotypes de l’homme asiatique : sage, travailleur, petit, asexué, souvent informaticien ou combattant d’arts martiaux, escroc ou exploité, toujours réservé, jamais séducteur!»
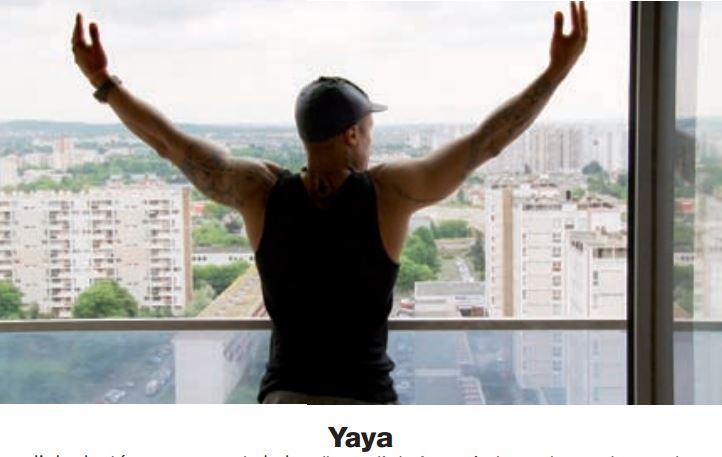
«J’ai raboté mon accent de banlieue, j’ai changé de code vestimentaire. Peut-être faudrait-il aussi que je change de couleur de peau ?»

«Si pendant longtemps j’ai souffert de mes cheveux, petit à petit j’apprends et j’arrive à les aimer, et à m’aimer. C’est ce que je veux pour toi, mon trésor : assume ta beauté.»

«Je suis né à Montreuil, originaire des Antilles, donc français depuis 4 siècles. Malgré ça on m’a toujours pris pour un Arabe.»

«Personne dans la rue n’a protesté. Les gens nous regardaient comme à un spectacle. Forcément nous étions coupables de quelque chose pour être traités ainsi. Aujourd’hui je vais bien…»

«Il y avait notre France à nous, celle de toutes les couleurs, que certains appelaient «ghetto» pour nous dénigrer. Et puis, il y avait la France de l’autre côté du pont, celle des riches, tous blancs, qu’on trouvait moroses. Père, te souviens-tu de cette journée lorsque tu m’avais accompagnée à l’école, de l’autre côté du pont ?…»

Malika «Une fille sera d’emblée vue comme une pauvre fille arabe, victime de ses grands frères, de son père, de sa culture, voire de sa religion. Moi j’ai toujours dit Non à ce statut de victime.» Quelle a été la graine à l’origine de ce film ?
.
Entretien avec Laurence Petit-Jouvet
Quelle a été la graine à l’origine de ce film ?
Il y a plusieurs années, à l’occasion d’un atelier vidéo que j’animais avec des habitants, j’avais rencontré Michaël qui avait fait de hautes études de commerce et créé son entreprise. Il m’avait expliqué calmement qu’il avait bâti son projet professionnel autour d’une idée simple : il travaillait par téléphone pour que ses interlocuteurs ne voient pas qu’il était noir. Sa société prospérait, il gagnait très bien sa vie et avait donc une belle voiture. Problème : il était contrôlé régulièrement par la police, parce qu’un Noir dans une belle voiture… c’est suspect. Cela se passait à cinq minutes de chez moi et je n’ai jamais oublié ce jeune homme.
LA LIGNE DE COULEUR s’inscrit dans les pas de votre précédent film CORRESPONDANCES qui était aussi composé de «lettres filmées».
La «lettre filmée» est un formidable véhicule de récits personnels et authentiques, un accès à une intimité offerte. Comme pour CORRESPONDANCES, l’idée de départ était de proposer à des personnes d’écrire un texte qui dise «je», adressé au destinataire de leur choix, en les incitant à creuser sous la surface du simple témoignage. Peut-être que leur lettre serait l’occasion de déterrer un souvenir d’enfance, de raconter une expérience étrange ou cruelle, de libérer un cri, de livrer une confidence… Ensuite, je me suis tenue à travailler avec leurs mots propres, respectés à la lettre. C’est le grain de cette parole, surgie grâce à ce mode de fabrication participative qui donne, je crois, sa spécificité au film. Leurs lettres sont des miroirs dans lesquels ils se regardent, mais dans lesquels nous pouvons nous regarder aussi.
Comment s’est fait le choix des personnages ?
Le repérage a duré plus d’un an pendant lequel je me suis aventurée dans des mondes très divers. J’ai recherché avant tout des personnes qui me permettraient d’aborder la problématique de la couleur de peau sous des biais variés et inattendus. Il ne s’agissait pas d’enfoncer des portes ouvertes; et il fallait éviter à tout prix le mur des lamentations si déprimant – «Je suis noir donc je ne trouve pas de boulot» – qui aurait enfermé les personnes dans des rôles de victimes. Plus que la discrimination raciale qui transforme le racisme en injustice, c’est l’assignation raciale qui m’intéressait, la question des regards sur l’autre et sur la différence, ceux qui font particulièrement mal parce qu’ils sont insidieux, latents, souvent inconscients, mais tellement agissants pour ceux qui les subissent. J’ai demandé à chacun de se pencher sur cet aspect de sa vie – être français et regardé comme non-blanc – d’une façon qui l’intéressait parce qu’elle serait nouvelle pour lui ou elle; je ne voulais pas qu’ils répètent ce qu’ils avaient l’habitude de raconter. Et de fait je me suis retrouvée avec les plus courageux, les plus sensibles aussi, ceux qui, à fleur de peau, ont osé aller considérer cette partie d’eux-même qu’ils ne peuvent changer, leur corps, leur visage, leur «couleur».
Ils sont tous français de culture française.
Oui, pour bien apercevoir ce que produit l’assignation raciale, il était important que les personnages ne soient ni des étrangers, ni des cas sociaux, ceci afin de faire tomber les défenses habituelles telles que «Oui, il a une autre couleur de peau, mais… il mange et pense différemment aussi» ou bien «Oui…, mais il est tellement pauvre et inintégré aussi».
Pourquoi avez-vous fait le choix de rassembler dans un même film des personnes perçues comme noires, arabes ou asiatiques ?
Lorsque j’ai croisé dans un livre (“Les nouvelles frontières de la société française” de Didier Fassin) le concept de «blanchité» qui vient des Etats-Unis, j’ai trouvé l’idée du film. J’ai compris qu’en rapprochant les expériences des non-blancs de différentes «couleurs», cela ferait apparaître quelque chose de notre société. Aujourd’hui, le fait d’être regardé comme non-blanc est toujours susceptible d’avoir des effets sur les relations quotidiennes (trouver un travail, louer un appartement, avoir accès à un stage, entrer dans un club, parler à un agent de police, etc, etc.) et être perçu comme blanc procure indéniablement des avantages, même si cela ne se dit pas explicitement. De la même manière que les membres d’un groupe majoritaire pensent qu’ils n’ont pas d’accent lorsqu’ils parlent, les Blancs n’ont pas à penser à leur «couleur», c’est d’ailleurs leur premier privilège. Malgré son omniprésence dans la vie des personnes, la «blanchité» de la société française rend le «blanc» neutre, perçu comme la normalité.
Pour arranger le tout, les incessantes réactivations du «problème immigré» ou du «problème étranger» aggravent encore la suspicion dont font l’objet ces Français regardés comme non-blancs. Elles rouvrent régulièrement des blessures identitaires, car ceux qui les vivent sont toujours considérés comme s’ils venaient d’ailleurs et donc pas entièrement d’ici, obligés d’apporter régulièrement la preuve de leur nationalité française.
Est-ce que LA LIGNE DE COULEUR s’attaque à un tabou français ?
Le décalage entre le discours officiel de la République qui se veut universaliste – égalitaire – “color blind”, et le traitement qui est fait à ces citoyens français est plus cruellement ressenti quand les promesses d’ascension sociale au mérite s’avèrent, dans la réalité, non tenues. L’injustice, lorsqu’elle surgit, est d’autant plus douloureuse pour ces personnes qu’elle renvoie à leur corps, là pour toujours.
La frontière de la racialisation, cette LIGNE DE COULEUR invisible qui traverse notre société en agissant comme une évidence, est souvent noyée dans des débats vite hystériques tels que ceux sur l’identité, les quotas, les statistiques ethniques… Les personnes concernées y sont réduites à des sans-voix anonymes.
D’ailleurs souvent, celles-ci ne sont pas bienvenues lorsqu’elles racontent ce qu’elles vivent : elles inventent, elles fabulent… Pire ! en dénonçant, elles aggravent. C’est pourquoi, lorsque je leur ai ouvert cet espace de parole, j’ai senti un immense besoin de dire, ce qui est si souvent nié, tu, banalisé… l’effacement de leurs expériences faisant parfois écho, pour ces descendants d’immigrés, au silence historique qui a entouré les violences subies par leurs ancêtres durant les années de déshumanisation et de domination qu’ont été l’esclavage et le colonialisme.
Les auteurs des lettres pouvaient s’ils le souhaitaient, s’adresser à un être imaginaire ou disparu.
Oui, comme dans CORRESPONDANCES, c’était un bon moyen de libérer les pensées et les émotions. Jérémie, par exemple, s’est emparé de cette proposition pour s’adresser à son grand-père décédé qui l’avait sauvé en quelque sorte. Enfant adopté du Sri Lanka, Jérémie s’est construit narcissiquement en grande partie grâce à cet homme qui l’avait toujours considéré comme son petit-fils.
«Ma couleur de peau n’avait pas d’importance pour toi, lui écrit-il, tu ne la voyais même pas.» La réalisation de sa lettre a donné lieu à une mobilisation très chaleureuse de toute sa famille, cela m’a beaucoup touchée.
Mais parce que Jérémie a la peau noire, il a subi de nombreux contrôles de police, souvent humiliants, parfois violents. Pour moi ces «contrôles au faciès» sont juste une honte, une tache scandaleuse et incompréhensible qui fait de mon pays une province arriérée. Mon compagnon, blanc, n’a jamais été contrôlé par la police, ni moi. Or certaines catégories de la population subissent très régulièrement ces agressions : pertes de temps, fouilles au corps, insultes… Il fallait que le film aborde ce grave problème et j’ai choisi Jérémie, justement, petit-fils d’un des fondateurs de l’Europe avec Jean Monnet, grand bourgeois enterré au Père Lachaise, pour montrer que ces «contrôles au faciès» peuvent toucher toutes les classes sociales.
Il y aussi cette autre lettre étonnante de cette comédienne au visage asiatique.
Je voulais absolument qu’il y ait un comédien ou une comédienne dans le film car ce sont eux qui reçoivent de plein fouet les stéréotypes sur le front des représentations. Avec Yumi, cela m’intéressait de montrer où va se loger l’assignation raciale dans l’inconscient collectif. Yumi a fait les plus grandes écoles de théâtre, elle parle beaucoup mieux que moi le français, avec une diction parfaite, et pourtant on ne l’emploie dans le doublage que pour faire la voix d’actrices d’origine asiatique. Ce côté presque surréaliste m’a plu.
Vous touchez à cet éternel «retour de la race» qui dérange.
Ce film atterrit dans un monde tendu, on le sait, les questions raciales en France échauffent rapidement les esprits. Après la Seconde Guerre mondiale, on avait voulu croire le terme de «race» définitivement enterré dans les poubelles de l’histoire. La pensée racialiste était réservée au monde anglo-saxon, les problèmes raciaux existaient chez les autres, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud… C’est seulement dans les années 90 que la discrimination raciale a été reconnue officiellement en France, que l’appellation «minorités visibles» a commencé à être utilisée, lorsque les nouvelles générations nées en France des récentes immigrations sont vraiment apparues sur le marché du travail. La frontière intérieure de la racialisation n’a pas surgi à ce moment-là, elle agissait déjà pour les immigrés depuis longtemps, elle est juste devenue visible.
Si on ne peut pas tout expliquer aujourd’hui par l’Histoire de France et son passé colonial, car la société n’a pas cessé heureusement de se transformer depuis, on ne peut pas non plus ignorer le poids de l’imaginaire colonial. La reproduction dans la France contemporaine de certaines pratiques, formes de pensées et représentations, sont héritées de ce passé d’infériorisation raciale qui étaient inscrites sur le papier dans le fonctionnement même de la colonisation.
De temps en temps, un scandale raciste occupe la une d’un journal, une petite fille lance une banane à une ministre noire, un rapprochement est osé entre une «bavure policière raciste impunie» aux Etats-Unis et une autre ici, des émeutes sont qualifiées de «raciales», un lien est fait entre un acte de violence commis et la violence subie quotidiennement par certaines catégories de la population… Et puis plus rien, ou presque. C’est évidemment ce qui constitue le hors-champ de ce film.
Quelles sont finalement les raisons profondes pour lesquelles vous avez voulu faire ce film ?
Je ne pourrai pas vivre bien dans ce pays tant que La France sera «le pays des vigiles les plus diplômés du monde» comme le dit Yaya dans le film. A cela, le pays où je vis et moi-même avons beaucoup à perdre. Car non seulement les talentueux vigiles bien formés aux bonnes écoles françaises partent enrichir d’autres territoires, mais le spectre des injustices et des souffrances qui vont avec pèsent aussi sur nous tous comme un mauvais cancer.
Faire la lumière sur cette frontière est pour moi un enjeu politique car il faut la voir clairement pour la remettre en cause. Le choix de porter le regard sur elle n’est pas neutre, c’est un parti pris. Il ne s’agit pas ici de renforcer la racialisation des rapports sociaux, ni au contraire de promouvoir un monde sans couleurs qui nous priverait de leur richesse et de leur beauté. Il s’agit de participer à ma façon à l’inéluctable mouvement de l’humanité, pour que les couleurs de peau finissent par perdre un jour leur dimension de marqueur social, source d’inégalités. Faire l’éloge de la diversité de notre société multicolore et métissée, ce qu’elle est dans les faits – et ce dont je me réjouis.
Parlons enfin de la réalisation de ce film, comment êtes-vous passée de la lettre écrite au cinéma ?
Mon intention était de rendre audibles ces voix en combinant la profondeur de la «lettre filmée» et des partis pris d’écriture, en images, en sons et en musiques pour que les paroles soient portées mais aussi débordées par ce qui advient à l’écran. Recherche de métaphores, rencontre du passé et du présent, du «in» et du «off»… Toutes sortes de mises en scène étaient envisageables en fonction de la teneur de la lettre et de la personnalité de son auteur. Et puisque chacun nous conduit dans une intimité très différente, en parlant d’un endroit très différent, il fallait à chaque fois opter pour des filmages très différents (gros plans charnels pour Fatouma avec sa fille, photos noir & blanc pour Alice perdue dans la fête irréelle, travelling moto pour les échappées matinales de Jean-Michel…). L’enjeu final était ensuite de faire de cette mosaïque de formes éclatées un seul film. Pour bâtir ce nouveau film, je me suis appuyée sur l’expérience de CORRESPONDANCES qui était déjà une création partagée, développée dans le même cadre d’une coproduction avec Passeurs d’images à Arcadi. Ici encore, chaque personnage est auteur de sa lettre, coauteur du film entier, et il joue devant la caméra son propre rôle. C’est ce mode de réalisation participative et cette éthique qui ont permis un tel engagement de la part de chacun.
Avec quelle équipe avez-vous travaillé ?
En grande partie avec les mêmes personnes que pour CORRESPONDANCES : Claire Childéric la chef opératrice, Pascal Ribier l’ingénieur du son, Martin Wheeler le compositeur de la musique originale, Jean-Marc Schick le mixeur… les fidèles avec qui j’aime travailler. Cette fois-ci, j’ai en outre demandé à Caroline Detournay de monter le film et à Olivier Marquézy, inventeur de génériques, de me fabriquer une LIGNE qui passe au milieu d’une foule multicolore. Avec Fatouma Diallo Jean Michel Petit-Charles Yumi Fujimori Malika Mansouri Mehdi Bigaderne Yaya Moore Sanaa Saitouli Alice Diop Patrice Taraoré Rui Wang Jérémie Gaudet liste artistique.
.
BIOGRAPHIE
A l’Université, Laurence Petit-Jouvet étudie la Géographie et a la chance de se trouver à Jussieu à la fin des années soixante-dix, au moment où s’invente une nouvelle Géographie anti-conservatrice. Comme sujet de mémoire, elle choisit “Hollywood” et en profite pour s’échapper à Los Angeles, mener l’enquête dans le milieu du cinéma. Encore une année d’études en Journalisme à New York University et elle décroche son premier travail, “nègre” pour un célèbre journaliste d’Europe 1. Très vite, elle comprend qu’elle ne veut pas vivre du journalisme et décide d’explorer le champ du cinéma documentaire. Elle devient auteur-réalisatrice sans passer par une école, en développant un langage dans lequel s’inscrit en creux son histoire. Depuis 1989 elle travaille essentiellement sur ses propres films, des documentaires de création qu’elle écrit et réalise; depuis peu produit et distribue. Dans ses films on peut lire voyages, migrations culturelles, marges artistiques, identités singulières, exils intérieurs, altérité…
.
FILMOGRAPHIE DE LAURENCE PETIT–JOUVET
2014 La ligne de couleur – 79’ 2010
Correspondances – 58’ 2003
J’ai rêvé d’une grande étendue d’eau – 53’ 2002
Chicago improvisations – 83’ 2001
Off the road – 72’ 1998
Regards de femmes – 26’ 1997
Bams et Moumy, jeunes filles africaines de Paris – 26’ 1996
Allo la vie – 52’ 1995
Femmes assises sous le couteau – 26’
Les détectives – 52’ 1992
L’arbre dans la ville – 13’ 1990
Le Pays Perdu – 52’
.
Liste technique
Réalisation : Laurence Petit-Jouvet
Image : Claire Childéric
Son : Pascal Ribier
Montage image : Caroline Detournay
Montage son : Didier Cattin
Musique originale : Martin Wheeler
Mixage et bruitage : Jean-Marc Schick
Etalonnage : Eric Salleron
Conception générique : Olivier Marquézy
Assistant à la réalisation : Véronique Petit
Production déléguée : Avril
Productrice déléguée : Laurence Petit-Jouvet














