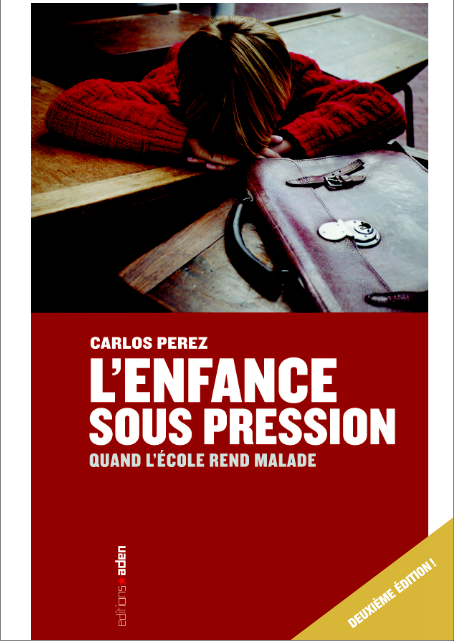Par Grégoire Lalieu et Mohuäd Salhi
La question fera sans doute sourire les adeptes de l’école buissonnière. Et pourtant, elle est très sérieuse. Stress, exclusion, dopage… L’école serait la cause de nombreux troubles chez nos enfants. Athlète de haut niveau, Carlos Perez anime un centre sportif dans un quartier populaire de Bruxelles. Sur le terrain, il a noué des liens privilégiés avec les familles, partageant leurs préoccupations. Il a alors pu constater que l’école était devenue un facteur déterminant dans les troubles qui frappaient les enfants. Carlos Perez a tiré un livre de cette expérience, L’enfance sous pression, qui vient d’être réédité. Il revient pour nous sur les problèmes qui traversent le système éducatif.
Dans votre ouvrage « L’enfance sous pression » vous pointez du doigt la productivité obsessionnelle qu’on impose à l’enfant. Les méthodes de l’entreprise et leurs objectifs de rendement se sont-ils immiscés dans le système éducatif ?
Effectivement, les méthodes industrielles ont été incorporées à l’école, avec les mêmes causes et les mêmes effets. On y retrouve donc ces trois piliers propres au monde de l’entreprise : concurrence, restructuration et compétitivité. Cela se traduit dans le cadre scolaire par les filières de tri et de relégation. Et ce n’est pas sans danger. L’OCDE indique que dans l’industrie, on dénombre 360 millions de dépressifs qui prennent des neuroleptiques. Malheureusement, l’école suit la même tendance.
Vous dîtes que notre système éducatif fait tout pour améliorer le rendement. Pourtant, les professeurs et les parents se plaignent que les élèves font de plus en plus de fautes d’orthographe. Ne pensez-vous pas que, paradoxalement, le niveau baisse ?
Je ne suis pas du tout d’accord avec ce constat. Plusieurs spécialistes se sont penchés sur la question et ont conclu que malgré certaines idées reçues, le niveau ne baissait, bien du contraire. Les enfants d’aujourd’hui ont développé d’importantes capacités d’adaptation à l’environnement dans lequel ils évoluent. Ils maîtrisent de plus en plus tôt toutes les nouvelles technologies. Le problème est qu’il y a tellement d’outils différents que les enfants doivent être très flexibles. Il est difficile de s’adapter à tout.
C’est donc la grille d’évaluation qui n’est pas bonne lorsqu’on pense que le niveau baisse ?
Forcément, si on prend une grille d’évaluation qui date de deux siècles, l’orthographe sera le facteur le plus déterminant. Mais les enfants d’aujourd’hui, s’ils ont une moins bonne orthographe, ont une meilleure conscience du texte, un meilleur esprit de synthèse, etc. Il ne faut pas oublier non plus qu’autrefois, seule l’élite avait accès à l’école. Aujourd’hui, elle est ouverte aux masses. Donc, les évaluations ne sont pas stables, elles changent tout le temps. Le niveau ne baisse pas ou n’augmente pas, il évolue.
Comment le modèle compétitif de l’industrie s’est-il installé dans les écoles ?
Par des réformes successives. On s’est attaqué au socle de base de l’école en réformant la pédagogie par objectifs et par compétences. La compétence est un élément typique de l’industrie. On s’en sert pour améliorer la production de chaque ouvrier. Ce modèle basé sur la compétence a d’abord été incorporé dans l’enseignement technique et professionnel puis en humanité. Il est ensuite passé dans le primaire jusqu’à s’immiscer dans les écoles maternelles.
Les Etats-Unis ont démarré cette logique en lançant une grande réforme baptisée « Le pays en danger » dans les années 80. Elle consistait à relever le niveau de l’enseignement qu’on estimait en baisse. Il fallait figurer parmi les premiers au niveau mondial. Dans ce cadre-là, les méthodes utilisées avaient pour seul but d’augmenter la productivité sans pour autant augmenter les budgets.
Et comment se traduit concrètement cette volonté d’être plus productif ? On donne plus de devoirs aux élèves, ils doivent apprendre plus de matières ?
Le programme scolaire est plus lourd effectivement. Mais à côté de ça, il y a moins de professeurs, moins de moyens et plus d’élèves par classe. Comme dans l’entreprise, il faut être hyper-productif mais aux moindres coûts. Si bien que ce système génère un stress important chez les enfants. Et pour beaucoup de professeurs, ce n’est pas évident non plus. Je me suis rendu compte de cette situation lorsque les parents du quartier venaient me trouver pour parler des difficultés qu’ils rencontraient avec leurs enfants. On retrouvait les mêmes troubles pour tous. De là, mon analyse s’est portée sur l’école et ses dysfonctionnements. C’est le premier déterminant pour les enfants. C’est l’endroit où ils passent le plus de temps.
L’OCDE a dressé un classement des pays avec les meilleurs systèmes d’éducation. Vous avez observé qu’hormis la Finlande, les pays qui arrivent en tête de ce classement sont aussi ceux où les enfants consomment le plus de Rilatine, un psychostimulant qu’on administre aux enfants hyperactifs mais qui feraient des ravages. L’armée US refuse d’ailleurs d’enrôler des jeunes qui ont subi ce traitement durant l’enfance. Est-on en train de doper nos enfants pour qu’ils soient plus compétitifs ?
Oui, on assiste à un dopage généralisé. A part la Finlande, les dix premiers pays de ce classement PISA sont ceux où il y a le plus de problèmes de santé, de dépressions mentales et de suicides chez les jeunes. Ce classement a jeté les bases d’une compétition internationale acharnée entre les écoles. C’est comme ISO 2000 pour les entreprises, c’est un baromètre de la compétitivité.
Quels critères sont pris en compte pour ce classement ?
Il peut y avoir des critères valables mais j’y vois deux grands problèmes. Tout d’abord, la finalité productiviste du classement : il faut rehausser le niveau dans le cadre d’une compétition. Ensuite, il y a un critère fondamental qui n’apparaît nulle part dans le classement PISA : la santé de l’enfant. A mes yeux, l’enquête perd ainsi directement de sa valeur. Il y a juste cette obsession du niveau. Jusqu’où va-t-on l’augmenter ? Dans quel but ? Est-ce utile à l’élève ou à la réputation de l’école ?
Il semble que les écoles sont de moins en moins des lieux d’éducation visant à donner aux enfants les outils nécessaires pour se débrouiller dans la vie. Mais plutôt des ateliers où l’on forme la future main-d’œuvre des entreprises.
En effet, nous vivons dans une méritocratie utilitariste. L’école d’aujourd’hui sert à ce qu’on soit employable tout simplement. Mais ce ne sont pas les valeurs premières de l’enseignement. Ce problème de formatage inquiète à juste titre les progressistes. Toutefois, il ne faut pas s’enfermer dedans non plus. La question de la santé ne doit pas devenir secondaire. En tant que sportif au contact des parents et des enfants, je peux vous dire que ce sont deux problèmes liés. La santé doit devenir une référence au sein de l’école.
Justement, vous qui êtes sur le terrain et qui avez un contact privilégié avec les familles, pouvez-vous nous dire comment les parents perçoivent la situation ?
Naturellement, les parents s’inquiètent de l’avenir de leur enfant. La plupart souhaite que l’enfant aille le plus loin et le plus haut possible dans le cadre scolaire car on nous promet que c’est l’outil indispensable pour s’émanciper. Les parents sont donc pris dans un engrenage, ils n’ont pas le choix et doivent subir ce rouleau-compresseur qu’est le système éducatif.
Sentent-ils le malaise de leur enfant ?
C’est terrible… Bien évidemment, ils le ressentent. Ce sont eux qui récupèrent l’enfant après l’école. Ils sentent le décrochage et le prennent de plein fouet. Ils le vivent comme un traumatisme. Ils savent que s’ils ne réussissent pas, leur enfant ne trouvera pas sa place dans la société. Je l’ai vécu, mon père l’a vécu et mon fils est en train de le vivre. Comment ne pas mal le vivre ?
Il faut arrêter de marginaliser les individus d’un système. Il faut les rendre utiles à la société et non les jeter comme des bons à rien. On avait catalogué mon fils comme hyperactif. Il a été éjecté progressivement du système éducatif. On a voulu lui donner de la Rilatine et on nous a proposé toutes sortes de solutions qui n’avaient aucun lien avec l’enseignement. C’est une constante dans le système éducatif : quand il y a un problème, on l’externalise. Le problème vient nécessairement de l’enfant, de son environnement ou de ses proches. C’est triste. Aujourd’hui, l’enseignement est comme un train. Si on n’arrive pas à monter dans le wagon, on reste sur le quai. L’enseignement n’a pas le temps.
Dans votre livre, vous parlez aussi de certains pays scandinaves où la situation de l’enseignement est meilleure. Pourquoi la Belgique n’adopte pas les mêmes méthodes ?
Parce qu’on a peur. On n’ose pas réformer toute l’institution, alors on vient avec des petites réformes cosmétiques qui ne règlent pas le fond du problème.
Au cœur des dernières réformes entreprises, il y a l’enjeu de la mixité sociale sur lequel les ministres butent régulièrement. Les parents obligés de camper devant des écoles les veilles d’inscriptions peuvent en témoigner. Comment expliquez-vous cet échec ?
Les ministres butent et buteront encore dans cinq ou dix ans tout comme les Etats-Unis ont buté ces cinquante dernières années. Car ils n’entreprennent que des réformes périphériques à l’enseignement. Ce n’est pas en mélangeant les pauvres et les riches dans un même sac qu’on règlera le problème de la discrimination. La mixité sociale est un leurre, il faut aller au fond des choses, s’attaquer aux véritables raisons de l’inégalité. Il faudrait aussi une déségrégation de l’espace urbain pour que l’école puisse fonctionner correctement. On ne peut pas séparer systématiquement l’école de la société.
De plus, ces réformes sur la mixité sociale sont lâches car elles tendent à culpabiliser les classes moyennes. Je ne veux pas porter un jugement sur ces parents qui ne veulent pas mettre leur enfant dans une « école à problèmes ». Les écoles peuvent être à discrimination positive mais il faut dès lors mettre les moyens nécessaires pour que ça réussisse. Il peut y avoir un professeur d’origine marocaine avec dix élèves d’origine marocaine, il n’y a aucune raison qu’ils ne réussissent pas à partir du moment où il y a une pédagogie non-discriminante.
Quelle alternative à ce marché scolaire ?
Il faut régler le problème de l’intérieur en éliminant le tri, la sélection et la relégation, le redoublement, les classes de niveau, les conseils de classe qui se travestissent en conseils d’orientation, les notations… Il faut bien comprendre qu’on ne trie pas les enfants. Et pourtant, l’enseignement d’aujourd’hui est un génocide pédagogique. Nous avons besoin d’un changement radical comme celui nécessaire pour éliminer le racisme aujourd’hui et comme celui qui est venu à bout de l’esclavagisme hier.
Quels moyens pourrait-on mettre en place concrètement ?
Il faut une école formative, pédagogique. Les élèves doivent pouvoir travailler par quatre ou cinq en ateliers réduits avec ces mêmes méthodologies que j’ai pu observer en Finlande. Là-bas, les jeunes communiquent entre eux. Ici, les classes sont cloisonnées et l’élève cantonné à son pupitre. Le professeur aussi est cloisonné. Il n’y a pas non plus de véritable courroie de transmission entre l’enseignant et les parents. A Cuba par exemple, il y a un lien très fort entre l’enfant et le professeur qui suit ses élèves du primaire jusqu’au secondaire. En outre, il connait bien les parents.
Il faut aussi une école de production intégrale où le sport et la culture font partie intégrante du programme. Aujourd’hui, on éjecte toutes ces activités qui peuvent faire aimer l’école à l’enfant et qui sont importantes pour son développement. Evidemment, cela demande des moyens. Mais c’est une vision de la société. Soit elle est au service de l’humain, soit elle est au service de l’économie.
A propos des deux pays que vous citez en exemple, la Finlande et Cuba, les moyens mis à disposition de l’éducation y sont plus importants ?
A Cuba, les ressources humaines, ou forces sociales comme on les appelle, sont bien plus nombreuses qu’ici en Belgique. Ces pays ont mis en place une coopération qui vient tant de l’extérieur que de l’intérieur. Bien sûr, pour que la coopération de l’extérieur opère, il faut le soutien des familles. Or, en Belgique, la fracture entre les familles d’un côté et l’école de l’autre se ressent fortement dans certains milieux. Des parents ont peur de l’école car ils ont peur de l’échec.
Vous avez mis sur pied un projet d’émancipation par le sport. Pouvez-vous nous expliquer ce concept ?
Cela va faire trente ans que nous avons créé le centre sportif Fire Gym. Au début, il était assez spécialisé sur les athlètes de haut niveau. Il l’est toujours, de nombreux champions passent par chez nous comme Lorenzo Javier, champion du monde de kickboxing des poids-lourds ou Sabatin Derebey, triple champion du monde de Jiu Jitsu brésilien. La liste est longue.
Mais peu de temps après la création du centre, nous avons eu beaucoup de demandes dans le quartier pour organiser des activités avec les jeunes. Des liens particuliers se sont tissés et j’ai pu constater des troubles récurrents. De là nous avons développé une analyse des problèmes de santé liés au système éducatif. Et nous avons entrepris beaucoup d’actions pour soutenir notre combat pour le bien-être des enfants.
Quel genre d’actions avez-vous mené ?
Pour les chèques sport par exemple. C’était une aide financière de l’Etat pour promouvoir le sport mais qui a été supprimée. Pour les maintenir, nous avons lancé une campagne dans les médias et organisé plusieurs manifestations. Nous n’avons pas vraiment eu gain de cause mais nous sommes quand même parvenus à faire passer l’aide financière pour le sport par les CPAS (Centre Public d’Aide Sociale).
Nous avons aussi créé une association, « Les parents luttant contre l’échec scolaire et le décrochage scolaire » qui a été fort médiatisée. Nous avons notamment fait venir au parlement Claude Anttila, une experte du ministère de l’Education finlandais. Elle nous a permis de faire connaitre les bienfaits du système éducatif dans son pays. Toujours contre le décrochage scolaire, nous avons organisé une marche avec 500 enfants à Bruxelles.
Bref, Fire Gym est parvenu à se faire une place dans l’agenda politique. Nous avons ainsi obtenu pour les parents un droit de regard sur les copies d’examens de leurs enfants. Nous avons aussi contribué à ce que les enfants dyslexiques puissent être accompagnés.
Fire Gym a trente ans aujourd’hui. Comment voyez-vous les choses pour la suite ?
Nous allons continuer à taper sur le même clou. Nous restons convaincus que l’enseignement n’a pas besoin de réformes mais de révolutions. Notre prochaine étape et de faire adopter le mi-temps pédagogique. Le matin est ainsi consacré à l’apprentissage des matières scientifiques mais l’après-midi se fait sans cartable. L’objectif est de réinstaurer sérieusement les activités culturelles et sportives à l’école.
C’est déjà le cas dans certains pays comme l’Allemagne, non ?
Ce n’est pas un très bon exemple car le sport y est externalisé. Les élèves peuvent exercer une activité mais à eux de choisir le sport et le club. C’est donc compliqué pour les parents qui doivent aller chercher leurs enfants pour les conduire ensuite au sport. Je pense plutôt que le sport doit faire partie intégrante du système pédagogique. Des entraîneurs comme moi devraient faire partie de l’Education.
Vous avez été deux fois vice-champion d’Europe de culturisme. Aujourd’hui vous entraînez des athlètes de haut niveau. Qu’est-ce qui a amené le grand sportif que vous êtes à s’engager dans ce combat pour une école plus saine et plus juste ?
L’exclusion. L’exclusion que j’ai subie, que mes parents ont subie et que mon fils a subie. Il y a dans notre société une tendance macabre à hiérarchiser les êtres humains et à exclure ceux qui ne conviennent pas. On les exclut de l’école, du travail, etc.
Sur base de quels critères ?
Mes parents manquaient d’outils pour pouvoir réussir quand ils sont arrivés ici. Sur les plans politique, professionnel, éducatif… Même pour le logement. Ils nous manquaient beaucoup de choses quand j’étais petit. Et c’était comme ça pour toute la classe ouvrière.
Puis, avec mes frères et sœurs, nous avons pu nous-mêmes goûter très tôt à cette dure réalité en étant relégués dans le professionnel à l’école et en commençant à travailler à 14 ans. Quand tu vois par la suite que les choses commencent à se reproduire avec tes enfants, tu te poses des questions et tu as envie de faire quelque chose. Donc, soit tu essaies de t’en sortir individuellement, soit tu essaies de trouver des solutions plus politiques, de manière collective. C’est la deuxième voie que j’ai choisie. Le fait d’avoir un centre comme Fire Gym m’a permis de rencontrer d’autres gens, de partager nos problèmes. Et très vite s’est posée la question de l’école, le plus grand déterminant dans la vie des enfants et la première source de préoccupations pour les enfants.
Et quelle aide apporte le sport dans tout ça ?
Le sport en soi ne permet pas de lutter contre l’exclusion. Mais c’est un moyen pour les jeunes de créer des liens sociaux. Ça débouche sur un travail et un réflexion collectifs qui peuvent être à la base de combats politiques pour l’émancipation.
Dessins : Titom
Pour voir l’association de Carlos Perez Fire Gym et commander son livre
Source : http://www.michelcollon.info/L-ecole-nuit-elle-gravement-a-la.html